Paris et Modiano agissent en miroirs réciproques.
Dans son discours de réception du prix Nobel de littérature, en décembre 2014, Patrick Modiano esquissait un autoportrait discret, à la lumière de Paris. Depuis près de cinquante ans, l’écrivain semble à la fois un piéton et un scribe de la capitale – une figure effacée dont le travail, dit-il, serait d’« explorer ce que Baudelaire appelait les plis sinueux des grandes capitales » : et ces sinuosités traquées ont les contours de la mémoire et de ses spectres. Ainsi, dit-il, « la grande ville, en l’occurrence Paris, ma ville natale, est liée à mes premières impressions d’enfance et ces impressions étaient si fortes que, depuis, je n’ai jamais cessé d’explorer les « mystères de Paris ». La phrase capture le retour obstiné de l’auteur vers l’énigme, vers cet indéfini qui ne cesse de revenir, comme une hantise. La ville, tout comme l’œuvre de Modiano, est peuplée de revenants. Il y a là un jeu spéculaire : Paris et Modiano agissent en réciproques miroirs.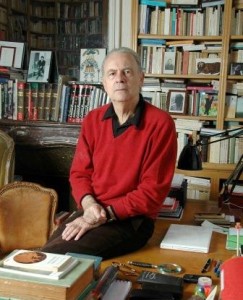
Dans son plus récent roman, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, paru quelques jours avant l’annonce du Nobel, Patrick Modiano met à jour ces strates de la ville qui trahissent en réalité une topographie personnelle, et les diagonales du temps : « Quarante ans plus tard, au XXIe siècle, un après-midi, en taxi, il traversait par hasard le quartier. La voiture s’était arrêtée dans un embouteillage, au coin du boulevard de Clichy et de la rue de Coustou. Pendant quelques minutes, il n’avait rien reconnu, comme s’il avait été frappé d’amnésie et qu’il n’était plus qu’un étranger dans sa propre ville. Mais pour lui cela n’avait aucune importance. Les façades d’immeubles et les carrefours étaient devenus, au fil des années, un paysage intérieur qui avait fini par recouvrir le Paris trop lisse et empaillé du présent. » La ville est à la fois irréelle et mécanisme de remémoration, afin de retrouver le souvenir d’anonymes engloutis par l’histoire, des figures qui « ne se détachent pas de certaines rues de Paris, de certains paysages de banlieue, où j’ai découvert, par hasard qu’elles avaient habité ». Mais le hasard est suscité par cette façon qu’a le héros de Modiano de hanter les lieux, comme pour s’en halluciner – de se servir des noms comme de mantra, ou comme tracé onirique.
« On ne retourne pas souvent dans les quartiers du sud. C’est une zone qui a fini par devenir un paysage intérieur, au point qu’on s’étonne que des noms comme Tombe Issoire, Glacière, Montsouris, le Château de la reine blanche, figurent dans la réalité, en toutes lettres sur des plans de Paris. Je ne suis jamais revenu rue de l’Aude. Sauf dans mes rêves. » C’est aussi de la sorte qu’il décrit les retours imaginaires de l’écrivain juif Joseph Roth, chantre d’un empire austro-hongrois défait. Le retour est impossible car il ne s’agit pas d’un retour géographique mais temporaire – et détourné par le rêve. Paris est à la fois minutieuse et rêvée. « J’étais sûr, par exemple, d’avoir vécu dans le Paris de l’Occupation puisque je me souvenais de certains personnages de cette époque et de détails infimes et troublants, de ceux qu’aucun livre d’histoire ne mentionne », écrit-il dans Livret de famille. Mais il se glisse toujours une menace – la présence inquiétante du passé, qui guette. Les Champs-Élysées sont le nœud de cette topographie d’une terreur – l’avenue bordée de cinéma et de café, est percée de son artère adjacente, la rue Lauriston dont le 93 était le haut-lieu du Gang de Bony-Laffont et de la torture de ces voyous supplétifs de la Gestapo.
C’est pourquoi il ne peut y avoir de nostalgie chez Modiano mais bien plutôt une mélancolie, l’impossibilité pour le sujet de s’imaginer séparé du passé et donc de faire le deuil, comme le définit Freud dans Deuil et Mélancolie. S’il est un texte du deuil impossible, incisé dans la topographie de Paris, entre le boulevard Ornano et la rue de Picpus, c’est sans doute Dora Bruder.
Dans Mal d’archive, en 1995, Jacques Derrida s’interrogeait sur la signification de l’attrait des archives en fin de millénaire – cette fièvre, ce mal d’archives est la réponse aux déportations consignées, à la chirurgie du crime de masse : les archives du mal.
« On ne renonce jamais, c’est l’inconscient même, à s’approprier un pouvoir sur le document, sur sa détention, sa rétention ou son interprétation. » Et Dora Bruder, paru en deux années plus tard, saisit cette façon de refuser que les vies aient été réduites à ces archives sans âme : cette quête refuse à ce qu’une autorité administrative ne puisse jamais épuiser la vie d’un être. Et Paris est complice de Modiano : « J’ai traversé les jardins. Était-ce la rencontre de ce fantôme ? (…) dans la lumière de fin d’après-midi, il m’a semblé que les années se confondaient et que le temps devenait transparent. » Dans le Paris de Modiano, les spectres n’attendent pas la nuit tombée pour sortir. Ils sont comme la Gradiva qu’analyse Freud en 1907, des fantômes de la mi-journée, ceux des véritables hantises.
Paris est aussi le lieu du palimpseste. Pas seulement entre fantômes et vivants mais aussi entre anonymes et nommés : les fantômes sont aussi des êtres à arracher de l’anonymat – des destins à ressusciter, tout en sachant bien que l’immense majorité demeurera engloutie, sans nom. « Edgar Poe, dans sa nouvelle L’homme des foules a été l’un des premiers à évoquer toutes ces vagues humaines qu’il observe derrière les vitres d’un café et qui se succèdent interminablement sur les trottoirs. Il repère un vieil homme à l’aspect étrange et il le suit pendant la nuit dans différents quartiers de Londres pour en savoir plus long sur lui. Mais l’inconnu est l’homme des foules et il est vain de le suivre, car il restera toujours un anonyme, et l’on n’apprendra jamais rien sur lui. Il n’a pas d’existence individuelle. »
Il s’agit donc de retrouver les existences individuelles – au gré de déambulations, mais aussi grâce aux « vieux annuaires de Paris, surtout ceux où les noms sont répertoriés par rues avec les numéros des immeubles. J’avais l’impression, page après page, d’avoir sous les yeux une radiographie de la ville, mais d’une ville engloutie, comme l’Atlantide, et de respirer l’odeur du temps. » Dans La Petite Bijou, en 1999, Modiano décrit les émanations des feuilles humides du bois de Boulogne, un lieu en lisière de Paris, tout comme les quartiers du 16e arrondissement où les fantômes sont comme en satellite.
Mais ce qui capture le temps est sans doute une autre texture olfactive – celle de l’éther, respiré après avoir été renversée par une voiture. Le même épisode est répété, sur le mode auto- biographique, dans Un pédigrée. Il y a quelque chose de l’éther dans le Paris de Modiano : entre anesthésie et drogue, une ville pour mémoire.
Source Arche Magazine



Poster un Commentaire