Son of Saul, drame hongrois coécrit[1] et réalisé par László Nemes, est sorti en 2015. Sélectionné en compétition au Festival de Cannes 2015, il remporte le Grand prix. Il est également sélectionné pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère à la 88e Cérémonie des Oscars qui aura lieu dimanche 28 février. Ce choix s’explique par l’accueil très favorable de la critique internationale, y compris américaine, et Stéphane Bailargeon pronostique dans Le Devoir que Son of Saul, qu’il qualifie de One-Man Shoah, l’emportera cette année selon toute vraisemblance dans la catégorie du meilleur film étranger, l’œuvre étant à ses yeux une réussite quasi parfaite.

C’est bien la première fois qu’une représentation fictionnelle de l’holocauste est adoubée par Claude Lanzmann. Lui qui s’est toujours opposé avec fermeté aux fictions sur la Shoah a salué là une œuvre exceptionnelle, déclarant dans Télérama que Le fils de Saul était l’anti-Liste de Schindler, ajoutant : C’est un film pur, intelligent […] Une sépulture pour les juifs de Hongrie.
Lors de l’annonce de la sélection, le 16 avril 2015, Thierry Frémaux, le délégué artistique du Festival, avait prévenu que le film diviserait et ferait polémique : accueilli par un concert de louanges, Son of Saul retint toutefois quelques voix discordantes: le journal Libération regretta ce consensus et l’absence de tout débat autour du film, et Les Cahiers du Cinéma lui reprochèrent la stratégie d’immersion qui en fait, à notre sens, toute la force.
SONDERKOMMANDO A AUSCHWITZ

László Nemes commença le développement du film en 2011 lors de la 22e session de la Résidence de la Cinéfondation, section du Festival de Cannes consacrée aux étudiants, cette résidence artistique devant permettre aux cinéastes débutants d’apprendre à bien rédiger un scénario et à consulter des médias cinéphiles. Le film avait alors pour titre provisoire S.K. et il montrait, en octobre 1944, deux journées de la vie de Saul Ausländer, prisonnier juif hongrois à Auschwitz.
Saul fait partie du Sonderkommando de l’un des fours crématoires d’Auschwitz-Birkenau, groupe d’ouvriers strictement séparés du reste du camp et qui, tout en attendant leur propre exécution à tout moment, sont forcés de prendre part au processus technique de la Solution finale, au cœur de la zone noire de l’extermination et de l’effacement de ses preuves.
Ces Sonderkommandos furent rarement montrés au cinéma avec autant de réalisme, mais souvenons-nous que déjà dans Shoah, Lanzmann retrouvait sept membres de ces unités triplement condamnées à mort, en tant que juifs, en tant qu’ouvriers des usines de la mort et en tant que témoins de l’holocauste.
Saul croit reconnaître son fils dans un enfant mort, et décide de tenter de le sauver de l’incinération et d’entrer en contact avec un rabbin, avec qui il l’enterrera selon le rite approprié. Entre-temps le Sonderkommando désespéré se prépare à se révolter et à saccager le crématorium, mais Saul se détournera d’eux, ayant pour seule obsession de mener à bien son projet d’enterrer ce fils dont il n’a pas su s’occuper de son vivant.
Immersion en apnée dans la monstrueuse routine d’Auschwitz, ce film semblait taillé pour raviver des querelles toujours à vif sur une question esthétique et morale, s’agissant de filmer l’infilmable, ambition dont personne n’est jamais sorti indemne. Le parti pris de Nemes consistant à éviter au film de trébucher sur l’obstacle esthétique de belles images qui induiraient mensonge et interprétation, le tout premier plan donne d’emblée la clé, une image fixe et floue laissant deviner le vert printanier d’une forêt ou d’un champ, alors qu’en arrière-plan, une silhouette s’approche jusqu’à ce que le point se fasse sur le visage de Saul, incarné par le génial Géza Röhrig.
KAPOS ET CRÉMATORIUM
Pendant près de deux heures, ce visage en gros plan ne quitte plus l’écran et ce que regardent les spectateurs, c’est uniquement ce que voit ce Juif hongrois chargé, avec ses camarades d’infortune, d’accueillir les convois de déportés et de les rassurer, invitant hommes, femmes, enfants à ôter leurs vêtements afin de prendre une bonne douche, leur promettant qu’ensuite un café ou un thé leur sera servi, alors qu’ils seront immédiatement gazés ; encadrés par les kapos, ces esclaves récupèrent les vêtements, déblaient les cadavres, nettoient les lieux avant de passer au crématorium où ils emplissent les fours de charbon, puis de corps, pour, en fin de course, éparpiller leurs cendres dans la rivière voisine.

La caméra embarquée suit les pas de Saul, le jeune juif étant au cœur de chaque plan-séquence, chargé qu’il est de déblayer les corps, objets dans les bouches des Allemands, jusqu’aux fours crématoires, le spectateur devenant Saul dans ce périple aux rebondissements incessants, embarqué avec lui dans l’expérience immersive du système génocidaire nazi, se trouvant rivé au héros, épousant le point de vue de cet homme contraint d’assister les nazis dans leur entreprise de massacre et ne voyant plus que ce qu’il voit, le reste étant rejeté hors champ ou flou. Un spectateur scotché à son siège, subjugué par la justesse du point de vue, la vérité de chaque plan, le jeu des acteurs, touché à jamais par l’équilibre d’émotions complexes, et renvoyé à ses propres contradictions : son désir de regarder malgré tout ce qui ne peut sans doute être vu qu’à travers quatre photos floues prises secrètement à Auschwitz-Birkenau en 1944 par un certain Alex, Juif grec enrôlé dans les Sonderkommandos et mort dans le camp, témoignage dérisoire et majeur qui ne montre presque rien et dit absolument tout sur le traumatisme de la Shoah, douleur atavique qui s’est transmise de survivants à descendants, trou noir en forme de point d’interrogation sur la nature du mal que le jeune réalisateur hongrois né en 1977 à Budapest tente de concrétiser, par le biais de ce dernier témoignage de condamnés à mort, ces quatre photographies prises de l’intérieur du camp d’Auschwitz-Birkenau par les prisonniers eux-mêmes, membres de ces commandos spéciaux, à propos desquels Primo Levi écrivit : On reste stupéfait devant ce paroxysme de perfidie et de haine : c’était aux juifs de mettre les juifs dans les fours, il fallait démontrer que les juifs […] se pliaient à toutes les humiliations, allant jusqu’à se détruire eux-mêmes.
HORS-CHAMP DE LA PERCEPTION DE SAUL
Toute cette mécanique de l’extermination industrielle, nous la connaissons par la littérature, les documentaires, les témoignages, mais là où le cinéma de Nemes offre une perspective inédite, c’est dans sa mise en scène expérimentale qui cadre au plus juste, sans hésiter à flouter tout ce qui est hors champ de la perception de Saul : c’est dans ce hors-champ que l’enfer se déchaîne, évoqué par une bande-son terrifiante où les bruits de l’industrie meurtrière se mêlent à une Babel des langues, à des gémissements, des bruits de coups, le personnage central semblant tenir hors de portée de sa conscience ces cris incessants, ces odeurs putrides et la vision des corps nus baignant dans le sang et les excréments, car il vit désormais dans un au-delà de l’humain.
Le réalisateur évite le voyeurisme malsain qu’un tel projet aurait pu comporter, s’arrêtant à la distance nécessaire : ainsi, jamais la porte de la chambre à gaz ne sera franchie et nous nous arrêtons avec Saul, chargés de reconstruire les bribes manquantes à partir de ces fragments de réalité.
La photographie du chef-opérateur Matyas Erdély, désaturée, presque monochrome, participe à la réussite du film, au même titre que l’utilisation étouffante du format 1.37.
En instituant ce procédé, et en s’y tenant scrupuleusement jusqu’aux ultimes secondes, Nemes réalise un film irréprochable, balayant les critiques soulevées sur l’irreprésentabilité de la Shoah, des textes de Jacques Rivette sur l’abjection du travelling de Kapo à l’indignation suscitée par la Vie est belle de Roberto Benigni ou encore du vacarme suscité par la colorisation des images d’archives des camps, de celui entourant la sortie de la Liste de Schindler de Steven Spielberg, autant de polémiques virulentes qui accueillirent aussi La Trêve, dernier film de Francesco Rosi d’après le roman de Primo Levi, ou encore La Rafle, de Rose Bosch en 2010.
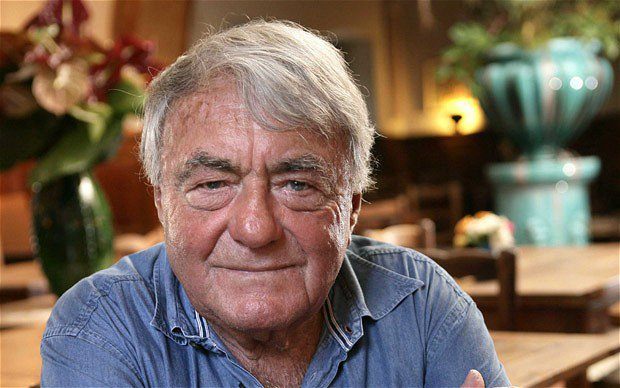
Soulignons encore que le prestigieux concours hollywoodien met aussi à l’honneur Claude Lanzmann, Spectres of the Shoah, film en lice dans la Catégorie des Courts Documentaires : en mêlant des entretiens avec Lanzmann à des extraits inédits de ses archives, le britannique Adam Benzine aide à comprendre le long et patient parcours du journaliste français qui consacra douze années de sa vie à Shoah, paru en 1985, et resté trente ans après monument de mémoire sur la destruction des juifs dans l’Europe nazifiée.
Claude Lanzmann, qui a maintenant 90 ans et devrait assister à la Cérémonie des Oscar dimanche, a souvent raconté que rien ne le prédestinait à devenir cinéaste : il était journaliste avant de se lancer dans ce projet fou de film-synthèse sur une des catastrophes fondamentales du XXe siècle. Un premier film, Pourquoi Israël, réalisé en 1972, l’avait introduit à la technique qu’il reproduira dans Shoah où sont retranscrits des extraits d’interviews avec les témoins, victimes ou bourreaux, les rushes tournés dans quatorze pays totalisant 350 heures, montrant son obsession pour les faits, sa recherche des détails, sa volonté d’exposer les rouages et les techniques de la mise à mort.
Sarah CATTAN
[1] Avec Clara Royer



Ce n’est pas un thème neuf au cinéma. En trame centrale, peut-être, je ne sais pas, mais dans Exodus (1960?) il en était déjà question. Un jeune rescapé des camps (Sal Mineo), dans une violence intérieure qu’il ne maîtrisait pas, et qu’on comprendra plus tard, cherche à rejoindre la haganah (je crois que c’est ça). Au cours de son « entretien d’embauche », si j’ose dire, il finit par avouer qu’il s’est livré à cette sinistre besogne. C’est ce qu’il y avait de plus bouleversant dans ce film, ce qui m’a plus plus touché. Mais ce film reste malgré tout une belle image d’Epinal car l’histoire est trop connue, trop romantique et romanesque à souhait (à part la première partie). Trop hollywoodien. Pleins de bons sentiments: une américaine esseulée (vient de perdre son mari) cherche à donner un sens à sa vie en voulant adopter une jeune juive, rescapée, elle aussi des camps… mais cette jeune et belle jeune fille n’est pas venue dans de terribles conditions en « Israël » pour en repartir, pour aller en Amérique faire le bonheur d’une dame américaine charmante, adorable et riche. La belle américaine (tout le monde est beau et bon dans ce film) finira pas tomber amoureuse et du pays et du beau sabra qu’était Paul Newman. Prévisible. Elle ne s’est pas amouraché du plus moche. Happy end, tout le monde va rester en Israël dont on assistera à la naissance au cours du film.