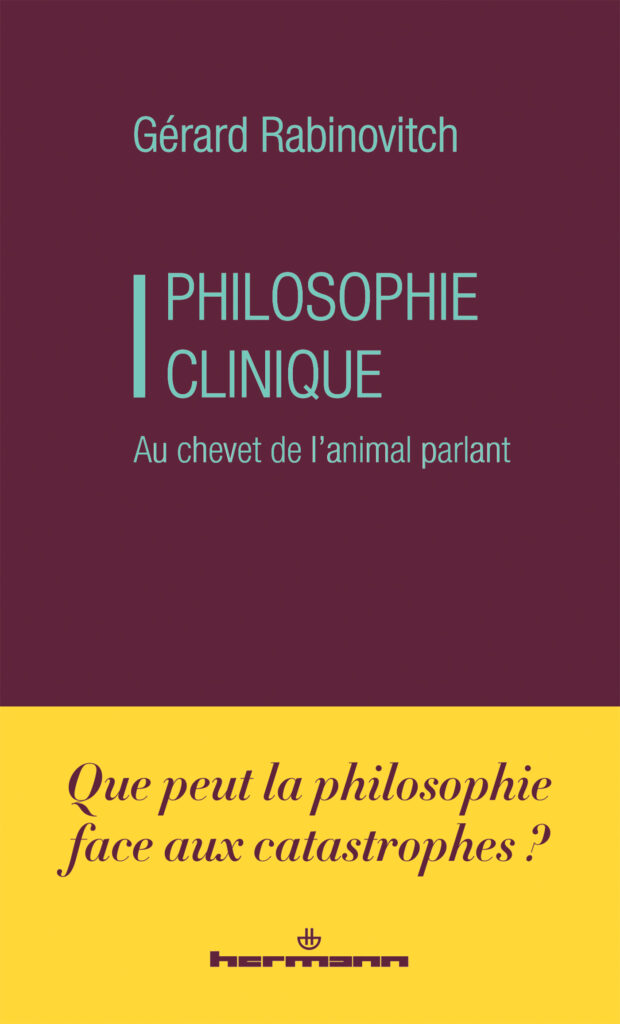
« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant.
La main du songeur vibre et tremble en l’écrivant ;
La plume, qui d’une aile allongeait l’envergure,
Frémit sur le papier quand sort cette figure,
Le mot, le terme, type qu’on ne sait d’où venu,
Face de l’invisible, aspect de l’inconnu ;
Créé, par qui ? forgé par qui ? jailli de l’ombre ;
Montant et descendant dans notre tête sombre,
Trouvant toujours le sens comme l’eau le niveau ;
Formule des lueurs flottantes du cerveau.
Oui, vous tous, comprenez que les mots sont des choses…
Les mots heurtent le front comme l’eau le récif ;
Ils fourmillent, ouvrant dans notre esprit pensif
Des griffes ou des mains, et quelques-uns des ailes ;
Comme en un âtre noir errent des étincelles.
Rêveurs, tristes, joyeux, amers, sinistres, doux,
Sombre peuple, les mots vont et viennent en nous. »
Victor Hugo, Les Contemplations, I, VIII (1856)
***
Le langage, l’alphabet, les Juifs furent les premiers à en démontrer l’importance ultime, la toute-puissance, pourrait-on dire.
Car, en effet, pourrait-on penser, agir, hors du langage ? Peut-on s’extraire du langage ? Et pouvons-nous nous en défaire, pour espérer penser autrement ? On croit penser disait Meschonnic, on est pensé par les mots.
Le langage cumule le paradoxe de pouvoir d’un maigre alphabet de seulement quelques lettres construire un univers plein, cohérent, total, une genèse infinie, ou au contraire détruire jusqu’à néant le monde et sa création.
Claude Vigée raconte à propos du langage cette anecdote :
« Les sages racontent que D-ieu, désireux de créer le monde, mais ne sachant comment s’y prendre, convoque les 22 lettres de base de l’alphabet. Il les fait défiler une à une devant son trône en commençant par la dernière Tav (à l’inverse de l’écriture hébraïque) – La lettre Tav symbolisant dans la Bible et la Kabbale la fin du monde, elle ne pourrait donc être utilisée pour créer. Pour différentes raisons, D-ieu récuse toutes les autres lettres sauf le « Beth » (qui signifie la maison), et possède la valeur numérique 2. Il est le signe de la dualité, du conflit de la guerre entre les sexes et les nations, mais il est aussi la matière première avec laquelle on peut construire les choses dans leur réalité. C’est donc avec le Beth que D-ieu bâtira ce monde forcément imparfait, agité, violent, boiteux. Ensuite D-ieu, peu rassuré, s’adresse à la première lettre de l’alphabet, l’Aleph, qui est muette en hébreu. Sur cette lettre, il décide de faire reposer l’édifice total de son Grand Œuvre cosmique.
Ces lettres où le monde s’engendre ne sont pas simplement des signes qui se réfèrent à lui : elles participent de la substance même de notre monde.
Cette parabole merveilleuse est au fond très inquiétante si l’on réfléchit à ses conséquences. En parlant, en écrivant, en agitant à la légère les lettres, les mots, les phrases et les livres, on remue le monde entier ; on le descelle à sa base, en ébranlant le silence fondateur de l’Aleph primordial qui constitue son assise[1]. »
Qui parle au fond ? qui nous parle ? et de quels mots sommes-nous les enfants, les esclaves, ou les bâtisseurs ?
Comme pour ses précédents ouvrages, le récent essai du philosophe Gérard Rabinovitch ne nous autorise ni l’immobilité ni le sommeil. Pour penser, il faut tout repenser, et la langue qui véhicule ce monde et tous ceux qui nous précèdent puis nous succéderont, cette langue qui tonne aujourd’hui avec fracas à nos oreilles distraites, est au centre de cet ouvrage.
Dans sa « Philosophie clinique, au chevet de l’animal parlant », il se fait élève de Benjamin Gross, de Gershom Scholem, du Maharal de Prague ; disciple de Walter Benjamin, de Léo Strauss et de Sigmund Freud ; s’accompagne de Wilhem Von Humbolt, Jean-Pierre Faye, Victor Klemperer, George Orwell, Maurice Blanchot, Max Horkheimer, Thomas Mann ; et revendique pour compagnons, les poètes et les humoristes authentiques.
Depuis ces contrées dont il rapporte des merveilles d’érudition, telles des étincelles crépitantes, Gérard Rabinovitch engage son essai sur le socle antique de la définition de l’homme telle que les penseurs de la Grèce antique de leur côté et la Tradition juive du sien l’ont formulée. Animal parlant pour les Grecs, vivant parlant pour les Hébreux. Dans l’une et l’autre formulation, l’humain y est caractérisé de l’usage unique de la parole. C’est par elle que l’homme se distingue du règne animal et s’élève au-dessus de celui-ci, sans pour autant renier sa propre « animalité ». La parole n’est pas que « communication », échange de « signaux » comme chez les animaux, voire dans certaines variétés de plantes. Gérard Rabinovitch met devant nous la triple (au moins) dimension de la parole : politique avec Aristote, psychique avec Freud, mystique avec la Kabbale. Soulignant que l’homme se singularise par elle et non se spécifie par le caractère « social » de la relation avec ses semblables. `
D’une façon tout à fait inhabituelle dans l’ordinaire des références universitaires, il met en avant, comme ressources pertinentes pour son argumentation, des citations du Tanakh, du Talmud, et des auteurs juifs : les Kabbalistes, le Maharal de Prague, Franz Rosenzweig, Franz Mauthner, etc. Il fait, là, une démonstration à laquelle il tient, de la légitimité des « humanités bibliques et juives » en parallèle et en croisement de celles des « humanités gréco-latines », pour penser la condition humaine.
Et c’est à partir de ce spectre de lumière que Gérard Rabinovitch peut se permettre de jauger ces hébétés de ce qu’il nomme – comme un sobriquet – le « sociologisme » contemporain : tous descendants lointains et inflationnistes en publications, dévoyés dans la transmission de l’entendement humaniste des « maitres anciens » d’Athènes et Jérusalem, lorsque la définition de l’homme comme « animal parlant » céda la prééminence à celle d’« animal social ».
Joliment – et sans doute en clin d’œil – Gérard Rabinovitch reprend à son compte la formule célèbre d’Ahad Ha’am (Asher Zvi Ginzberg) : Lo zé hadereh (« Ce n’est pas le bon chemin »), pour la transposer à l’Histoire de la pensée occidentale. Le « mauvais chemin », c’est d’avoir essentialisé l’humain d’être un « animal social » : « animal socialis », suite au passage du grec au latin de la notion aristotélicienne d’« animal politique ». Une transformation au détriment de celle d’« animal parlant », le zoon phonanta des Grecs, ou de « vivant parlant », le hai medaber des Hébreux.
Les conséquences de ce déroutement, et de l’alignement sur la définition de l’humain comme « animal social », a trouvé ses rebonds dans la postérité du mouvement des Lumières. Dans le libéralisme, le marxisme, le positivisme, les sciences sociales naissantes, dont les auteurs – à quelques exceptions près – n’ont d’attention qu’à la seule condition « sociale » et « socio-économique » comme lien humain. Gérard Rabinovitch en montre en creux l’impasse épistémologique aux conséquences éthiques dramatiques. Il y décèle un processus de « domestication » des humains. Une démonstration éloquente dans le bref rappel des opérations lexicales et sémantiques qui se sont produites et installées au cours du XIXème siècle – dans l’« Ombre des Lumières » selon l’expression qui lui appartient : antisémitisme, eugénisme, euthanasie, raison instrumentale, rhétoriques propagandistes, etc. Dans lesquelles tout était déjà dit et écrit, cinquante ans avant que les nazis viennent « y faire leur nid », pour en faire les actions instituées des appareils d’État.
La parole précède pour le meilleur ou pour le pire l’institutionnalisation de ses énoncés, telle est l’avertissement de Gérard Rabinovitch. D’où son appel à la vigilance au « Bien dire ».
Car le risque de catastrophes éthico narratives se fait encore plus présent, dans l’omnipotence du « sociologisme » comme matrice empoisonnée des discours de la connaissance. Il y fait « asile d’ignorance » sur l’essentialité de la parole pour l’humain, tout en investissant le langage commun de ses seules productions de sens. Cette emprise, il la voit, par exemple, s’épanouir dans « la mièvrerie vénéneuse » de l’opposition essentialisée entre « dominants » et « dominés ». Mais qui reste aveugle à la reproduction en pire chez les dits « dominés » d’une domination plus brutale encore…
Autre exemple qu’il donne, dans le domaine de l’humour qu’il a déjà théorisé : la généralisation de l’appellation d’« humoriste ». Le nom renvoyant maintenant à l’unique registre d’activité sociale d’amuseurs. Et dont a été effacé l’opposition éthique originelle entre rires d’autodérision empathique et rires agressifs de railleries et de sarcasmes, où le nom d’humour avait été forgé. Rendant alors illisible la distinction éthique pourtant foncière qui sépare un Dieudonné, un Meurice, d’un Raymond Devos…
Dans – autre exemple encore – la notion de « genre » qui prétend faire de la sexuation une seule construction sociale ! À l’encontre des évidences anatomiques, somatiques, hormonales, psychiques… Etc.
Pour ce philosophe hors des sentiers communs, battus de mille pas tonnant, toutes les « rebellitudes » contemporaines ne sont que des appels à un Pouvoir cruel…
Si nous sommes, tous tout entiers nous-mêmes le contenu du langage[2], alors la lecture d’un tel ouvrage non seulement s’impose, mais nous donne cette chance inouïe de savoir enfin ce que l’on dit, à qui, et surtout de comprendre ce qui creuse, entaille, ravine, mais ne s’entend pas aussi clairement que l’on voudrait croire.
© Daniella Pinkstein
Notes
[1] « Dans le silence de l’Aleph », Albin Michel.
[2] Henri Meschonnic, « Pour la poétique », Gallimard.



Poster un Commentaire