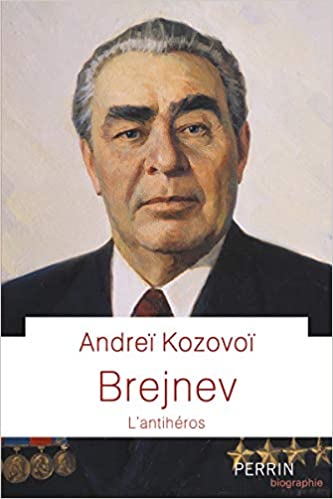
Léonid Brejnev est un personnage central de la deuxième partie du XXe siècle. Dans les années 1960 et 1970, il fut l’un des maîtres du monde, incarnation de « l’ogre soviétique ». Son nom même évoquait une forme du mal absolu: le totalitarisme et l’expansionnisme de l’URSS, l’imminence d’une guerre nucléaire. Cette passionnante biographie lève une partie du mystère sur un personnage dont la silhouette a si longtemps hanté les cauchemars des « hommes libres ». A l’heure où de nombreux esprits s’inquiètent d’un renaissance de tentations totalitaires sous certaines formes au sein même des nations occidentales, un retour sur ce phénomène et celui qui en fut pendant vingt ans l’expression même, mérite le détour.
Le mot qui s’impose à propos de Léonid Brejnev est celui de médiocrité. Né en 1906 en Ukraine, technicien des équipements agricoles, il fut avant tout un apparatchik du parti communiste auquel il adhéra à la fin des années 1920 et dont il a gravi les échelons. Mobilisé, il a fait la « guerre patriotique » en tant que colonel, sans héroïsme ni faits particulièrement signalés – contrairement à une légende mensongère. Repéré par Staline pour son orthodoxie irréprochable, son ascension dans la hiérarchie du parti communiste lui vaut d’être nommé à des postes dirigeants en Ukraine et en Moldavie. Il se place alors dans le sillage d’un autre leader soviétique: Khrouchtchev.
Marié à 21 ans, père de plusieurs enfants, Brejnev est un séducteur, un homme à femmes, un enjôleur au contact facile qui joue de son charme. Grand amateur de chasse, il n’a rien d’un intellectuel, ni d’un fanatique. Il ne lit pas, n’écrit pas, ne se passionne pas pour la théorie marxiste-léniniste et ne manifeste aucun zèle dans la répression sanglante et les épurations staliniennes. L’idéologie n’est pas son fort, encore moins le doute et la réflexion. Le secret de sa réussite tient à son conformisme impeccable et soumission à l’ordre établi. Il suit la ligne et prend du galon. En 1956, il prend part à la déstalinisation auprès de Khrouchtchev en tant que « titulaire du présidium du comité central ». Pourtant, il supporte mal le tempérament autoritaire et les manières brutales voire caractérielles de ce dernier. En octobre 1964, il prend part à une conjuration pour pousser Khrouchtchev à la démission et devient premier secrétaire du parti communiste d’URSS, c’est-à-dire premier dirigeant du pays.
Comment un régime totalitaire pourra-t-il s’accommoder d’une leader aussi terne à sa tête? « Comment peut-il y avoir un culte de la personnalité sans personnalité » s’interroge-t-on à Moscou. Brejnev esquisse une réhabilitation de Staline dont il loue « la sagesse ». Toujours par orthodoxie, il se fait un devoir de préserver l’héritage de ce dernier, issu de la victoire de 1945. Aussi, le leader soviétique suit l’avis de ceux qui le poussent à réprimer sévèrement le printemps de Prague en 1968, cette tentative désespérée des Tchécoslovaques pour se libérer de la tyrannie communiste. Dans une logique de préservation de l’ordre établi et de « souveraineté limitée », les armées du « pacte de Varsovie » (URSS et ses satellites) interviennent pour restaurer une impitoyable dictature marxiste.
Pourtant, avec son premier ministre Kossyguine, il consacre l’essentiel de son énergie à la détente avec le monde occidental – après deux décennies de guerre froide. A ses yeux, le salut de l’URSS, y compris sur le plan économique, passe par cette politique. Brejnev établit des relations personnelles étroites et confiantes avec Georges Pompidou – la France étant à ses yeux la tête de pont privilégiée vers l’Ouest – , avec l’Allemand Willy Brandt et surtout, le président américain Richard Nixon. Brejnev vit dans la hantise permanente d’un affrontement militaire avec l’Ouest. La détente se traduit par la signature d’importants accords de désarmement nucléaire. Tel est son objectif essentiel. Les rapports de puissance l’emportent sur l’idéologie, comme en témoignent ses relations conflictuelles avec la Chine communiste de Mao, dont le sanguinaire « Grand bond en avant » – qu’il condamne – fait des dizaines de millions de victimes.
La mort de Pompidou et la démission de Richard Nixon le déstabilisent. Il ne supporte pas Jimmy Carter, à compter de 1976, son idéalisme et ses « ingérences » en matière de droit de l’homme. Le régime soviétique réprime impitoyablement tout ce qui lui tient tête : l’auteur de l’Archipel du Goulag, le grand Soljenitsyne et le physicien Sakharov, critique du système totalitaire, font l’objet de persécutions permanentes avec une poignée de dissidents. Il s’oppose par tous moyens au départ des Juifs qui veulent s’installer en Israël. Puis sous la pression de la bureaucratie soviétique, en particulier d’Andropov, chef du KGB, il ordonne en 1979 l’invasion de l’Afghanistan, considéré comme une chasse gardée de l’URSS, sans avoir anticipé la vigueur des réactions occidentales. Sur fond de vertigineux déclin économique, l’effondrement de la détente, le boycott des jeux olympiques de Moscou par les Etats-Unis et une partie de leurs alliés précipitent l’échec de Léonid Brejnev, qui décédera deux ans plus tard.
L’échec de Brejnev signe l’échec du système totalitaire, fondé sur le culte de la personnalité, le parti unique, le bannissement du dialogue et la diabolisation de toute forme de discussion et de dissidence, le bannissement de la liberté et la sublimation de l’autoritarisme. En ces temps de grand trouble des esprits et d’incertitude sur l’avenir, puissions-nous, aujourd’hui, ne jamais oublier cette sanglante et vertigineuse faillite.
Brejnev, l’antihéros. Andreï Kozovoï. Perrin. 2021
© Maxime Tandonnet


Poster un Commentaire