
A Paris, Tel Aviv ou Haïfa, le café est ce lieu sacré qui, pour un citadin, occupe une place centrale dans la vie professionnelle et privée. Pour nombre d’entre nous, la vie urbaine, ce n’est pas seulement l’agitation et la pollution des rues, c’est aussi le café, sa terrasse, ce lieu public qu’on habite quelques instants et qu’on quitte, une extension du bureau ou du domicile, un lieu de passage ou un lieu de rendez-vous dont l’atmosphère est différente mais familière.
L’air de la ville n’est plus le même depuis que les vitrines des cafés sont aveugles. Où se rencontrer quand on est citadin sinon dans un bistrot ? On y retrouve ses copains pour éviter d’avoir à grimper les étages quand les appartements sont haut perchés et petits ou bruyants, c’est un endroit à mi-chemin, on y fait une pause après les courses ou on s’installe en terrasse avec un bouquin au soleil printanier.
En plus, un changement de décor pour le prix d’un café, loin du bureau et de l’ordinateur, c’est plus abordable que le restaurant. Actuellement, l’employé et l’ouvrier qui travaillent toute la journée loin de chez eux en sont réduits à boire le café sur un banc ou sur une borne, dans le froid à Paris… ou parfois, sous une pluie diluvienne à Haïfa ! On peut même y rencontrer un inconnu, une inconnue…
On découvre donc cette année qu’à Paris, Haïfa ou Tel-Aviv, la vie sans les cafés n’est plus la même. Dans certains quartiers de Paris, surtout les quartiers touristiques, des rues entières sont désertes, vidées, rideaux métalliques baissés. Certains ont définitivement mis la clé sous la porte et affichent « A vendre », ou « A louer ».
Nous habitons une rue longue et étroite au centre de Paris, tout près du Marais. Notre café préféré est au carrefour. C’est un vrai bistrot parisien qui a conservé son comptoir en bois vernis avec suffisamment de tabourets hauts pour les habitués qui viennent échangent entre eux Libé et le Parisien en prenant un café, et des tables carrées sur un sol en damier rouge et beige. Au bar, notre copain Juan, un Cubain, officie en ciselant la menthe pour les cocktails. Il nous fait la bise quand on arrive s’il n’y a pas trop de monde et de temps à autre, nous offre le café.
Enfin, ça, c’était avant – le monde d’avant, si vous voulez. A présent, Juan est rentré à Cuba, et cette fois définitivement. Désormais, plus question de faire la bise à personne. Et le café est fermé.
Notre café a baissé le rideau depuis la fin du mois d’octobre, comme tous les autres cafés et restaurants de la rue. Toutes les vitrines sont condamnées, ce qui fait une rue sinistrée. Or ce matin, les guirlandes lumineuses de notre cher bistrot étaient allumées et derrière la porte entrouverte, on distinguait une lampe allumée. On s’est approchés, et aussitôt, notre copain Daniel, le patron, est sorti pour nous dire bonjour en agitant la main en l’air. Il y a deux mois, il nous tendait joyeusement le poing et on faisait pareil. Le sourire large, le visage rond et le regard direct, l’air moins décontracté, mais on sait que l’époque lui donne du souci.
« Non, dit-il en hochant la tête, l’air sombre, on ne va pas rouvrir pour le moment, on aimerait bien mais aucune chance. Je vais voir si la banque va consentir à nous renouveler le prêt, je le saurai ce soir. » Il nous avait raconté en avril, pendant le premier confinement, que lui et son associé devaient finir de rembourser leur prêt cette année-là — fin 2020 — après vingt ans… « L’Etat fait ce qu’il peut, il nous verse la moitié de nos frais — qui représentent en gros 250 000 euros par mois, mais nous payons le reste et nous n’avons plus de trésorerie…
Alors on va voir la réponse de la banque, fait-il avec un petit sourire. Et pour les employés, l’Etat paye 80%, mais nous avons les 20% restants à charge, bien sûr, l’URSSAF… ». Les employés sont moins nombreux qu’avant le premier confinement, Kevin, David et Michel sont là, mais Isma est parti pour lancer son entreprise Uber. »
Daniel allume un cigarillo ; je recule à cause de la fumée et de l’odeur.
« Et si la terrasse avait pu rester ouverte, avec le chauffage, ai-je demandé, car c’est une question que nous nous posons beaucoup. Cela vous aurait aidés ?
— Oui, bien sûr. On ne fait que 40% de notre trésorerie avec la terrasse, mais c’était mieux que rien…
— C’est bête…
— Oui, mais attends, ce n’est pas possible. En réalité, c’est ici qu’on se contamine, dans les cafés, les restaurants.
— Ici ? Chez vous ? dis-je incrédule. Même en terrasse ?
— Et comment ! Ici on a tous été atteints…
— Quoi ?
— Oui, on l’a tous attrapé, le virus, renchérit Daniel. Je ne sais pas comment, malgré tous les soins qu’on a pris, on l’a tous eu. On l’a attrapé au moment de la fermeture et on a tous été malades la première semaine. Mes employés l’ont eu pas trop grave, assez bénin, mais moi, ça a été terrible, j’ai failli y rester… je ne sais comment je suis encore là, » raconte notre bistrotier. Je regarde le gaillard solide, massif, des biceps, un poitrail.
A présent qu’il a commencé à raconter, il ne s’arrête plus. « Je suis tombé malade le 4 novembre et le 12, j’ai appelé les urgences. Je n’arrivais plus à respirer, et j’ai eu le cœur qui s’est emballé… et pourtant je suis costaud. J’ai pris ma douche avant d’appeler les urgences, et là, j’ai perdu connaissance… je suis resté dans les pommes dix heures, et quand je me suis réveillé par terre, j’étais gelé.
Comme j’ai fait l’armée et que je suis un sportif, j’ai réussi à mobiliser mes forces pour atteindre le téléphone je ne sais pas comment, et j’ai appelé les urgences ; ensuite je me suis traîné jusqu’à la porte pour qu’ils puissent entrer, parce que j’étais seul chez moi. J’avais aussi demandé à ma femme de ne pas m’appeler parce que je dormais beaucoup depuis une semaine.
« … Voilà. J’étais toujours contagieux le 28… il y a une semaine, poursuit-il (on a reculé d’un pas supplémentaire). Et j’ai encore les poumons striés. Je le sens quand je fais mes pompes. Je ne sais pas comment on peut le transmettre, ce virus, la sueur sur les mains ou autre chose… mais regarde, dit-il en soufflant la fumée du cigarillo sur la vitrine de son café : regarde jusqu’où va notre haleine. »
Son visage habituellement un peu poupin sous le cheveux roux drus est tendu, on sent quelque chose de sombre qui est nouveau chez lui.
« Et comme j’ai 49 ans, je dois attendre d’avoir 50 ans, donc l’an prochain, pour être vacciné…. Parce qu’en plus, on n’est même pas sûr que je sois protégé contre une récidive, ni contrer toutes les formes, ni pour combien de temps, et je ne peux pas me permettre de remettre ça. Oui, vivement le vaccin pour qu’on puisse redémarrer… »
Quelqu’un s’arrête pour parler à Daniel, un voisin. « Ça y est ? Tu vas mieux ? »
« Au revoir, bonne année et bonne santé à tous… y compris à Juan à Cuba, dis-je.
— Merci, je transmettrai. Là-bas ils n’ont toujours pas le virus, mais son gîte est vide à cause du confinement… A bientôt, vous deux, ajoute-t-il en agitant la main en l’air. « Et faites attention à vous. »
Edith Ochs est journaliste et se consacre plus particulièrement, depuis quelques années, aux questions touchant à l’antisémitisme. Blogueuse au Huffington Post et collaboratrice à Causeur, Edith est également auteur, ayant écrit notamment (avec Bernard Nantet) « Les Falasha, la tribu retrouvée » ( Payot, et en Poche) et « Les Fils de la sagesse – les Ismaéliens et l’Aga Khan » (Lattès, épuisé), traductrice (près de 200 romans traduit de l’anglais) et a contribué, entre autres, au Dictionnaire des Femmes et au Dictionnaire des intellectuels juifs depuis 1945.

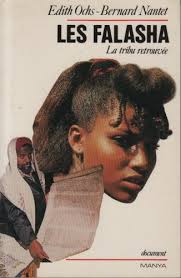


Poster un Commentaire