
Réflexions à partir de l’ouvrage de Yosef Hayim Yerushalmi : ZAKHOR
La mémoire collective du peuple juif provient-elle de l’écriture de son histoire, ou est-ce sa mémoire qui lui tient lieu d’histoire ? C’est la question centrale que pose l’ouvrage Zakhor, Histoire juive et mémoire juive, du grand historien américain Yosef Hayim Yerushalmi (1932-2009). Cet ouvrage, réunion de quatre conférences prononcées par l’auteur, paru pour la première fois en anglais en 1982 et aussitôt traduit en français en 1984, a connu un retentissement considérable au niveau international, et a eu des retombées significatives dans diverses disciplines des sciences de l’homme et de la société. Le travail présenté ici tente d’en donner un aperçu en faisant ressortir la pertinence de la question pour comprendre les tensions sociales contemporaines qui agitent la société israélienne.
La question posée pourrait être reformulée de la façon suivante : Comment le peuple juif a réussi à se perpétuer au cours du temps, sachant, d’une part, que son histoire s’est passée pour l’essentiel en exil, depuis la destruction du Second Temple en l’an 70 de l’ère courante et, d’autre part, que la plupart des grands événements qui ont marqué cet exil n’ont pas reçu en leur temps une trace écrite par des historiens, hormis bien sûr les deux exceptionnels travaux de Flavius Josèphe, témoin de la prise de sa ville natale, Jérusalem, par les Romains : La Guerre des Juifs contre Rome, et l’histoire du peuple juif dans les Antiquités Judaïques.
A la différence de la profusion des récits historiques qu’on trouve dans la Bible hébraïque (Tanakh), les diverses périodes qui ont succédé à la période biblique, successivement celles du judaïsme rabbinique, du judaïsme médiéval, puis du judaïsme de la réforme, la chronologie historique des événements marquants de la vie du peuple juif en exil, n’a pas été au centre des préoccupations des juifs de l’exil. Certes, il n’en est plus de même aujourd’hui, mais l’absence de chronologie historique est longtemps restée une caractéristique du judaïsme de l’exil. Pour le dire autrement, l’écriture de l’histoire juive post-biblique s’est longtemps arrêtée à ce qu’en disait la Bible hébraïque, livre canonisé dès la fin du 1er siècle de l’ère courante. L’historiographie juive est ainsi restée presque exclusivement muette, après l’exil à Babylone qui a suivi la destruction du Second Temple, tandis que la mémoire juive collective, qui n’a jamais cessé d’être fortement présente, s’est nourrie quasi exclusivement des événements survenus avant cette destruction.
Yerushalmi distingue en fait quatre périodes, pour examiner en détail la question des liens entre histoire et mémoire du peuple juif : I / les périodes biblique et rabbinique, II / le Moyen-Âge, III / l’Expulsion d’Espagne, et IV / l’époque moderne.
1/ Histoire et mémoire dans le judaïsme biblique et rabbinique
Le lien entre histoire et mémoire n’est pas le même selon les deux périodes biblique et rabbinique. Au cours de la période biblique des deux Premiers Temples, mémoire juive et histoire juive antique étaient parfaitement liés. Le texte de la Bible hébraïque, livre matriciel du judaïsme, est saturé de récits historiques relatant différents épisodes, depuis les Patriarches, le séjour en Egypte, l’Alliance du Sinaï, la traversée du désert, la conquête de la terre de Canaan, puis la mise en place des institutions gouvernant le pays (Juges, Rois, Prêtres), en passant par le regard critique des prodigieux témoins que furent les Prophètes. La Bible hébraïque est ainsi saturée d’histoire et c’est cette histoire qui alimentera toute la mémoire juive ultérieure. Yerushalmi rappelle en ces termes l’événement fondateur : « Quand Moïse porte aux Hébreux réduits en esclavage, l’annonce de leur délivrance, il ne vient pas au nom du Créateur du Ciel et de la Terre, mais en messager du « Dieu de nos pères », c’est à dire du Dieu de l’histoire. Quand Dieu apparait à tout le peuple dans le Sinaï, il ne dit rien de son essence, ni de ses attributs, mais il se présente simplement comme le Dieu de l’histoire qui a fait naître le peuple juif : Je suis יהוה, ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Egypte, de la maison des esclaves » (Exode, 20, 2). Au total, on peut dire, sans grand risque de se tromper, que l’injonction de se souvenir de ce moment fondateur a servi de ralliement identitaire pour tout un peuple. Bien entendu, l’injonction de se souvenir ne concernait pas tous les détails du passé ; le principe de sélection est en fait très spécifique : le peuple juif doit se souvenir, avant toute chose, des interventions de Dieu dans l’histoire, et des réactions humaines, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Yerushalmi explicite clairement le principe de sélection implicite à la Bible : « Le plus grand danger n’est pas l’oubli de ce qui advint dans le passé, mais bien plutôt l’oubli de l’essentiel, à savoir comment le passé advint« .
Pour se souvenir de ce qui advint dans le passé, les rites associés aux fêtes de pèlerinage, servent de sources permanentes de rappel. Trois de ces fêtes, Pessah, Shavouot et Souccot, célèbrent, chacune à leur manière, l’Exode hors d’Egypte et le séjour de 40 ans dans le désert. De plus, le narratif (Aggada) qu’on trouve en abondance dans la Bible, offre de remarquables condensés d’histoire, comme par exemple celui explicité dans Deutéronome (26, 5-9). Cette histoire a été écrite par des prêtres et des prophètes, parmi lesquels figure Moïse, le plus grand d’entre eux. De plus, même si le personnage central dans les différents narratifs se rapporte au divin, il n’en reste pas moins vrai que c’est la dimension profondément humaine de ces récits historiques, qui en est la caractéristique incontestée.
Mais après la destruction du Second Temple par l’empire romain en l’an 70 de l’ère courante, les récits historiques se firent beaucoup plus rares dans le judaïsme rabbinique. Comme si la multiplicité d’événement que les juifs d’exil traversaient, se réduisait au souvenir d’événements antiques, que leurs ancêtres avaient déjà vécu, depuis la sortie d’Egypte. L’injonction hébraïque Zakhor (Souviens-toi !), qui fournit le titre de l’ouvrage, figure ainsi plus de 160 fois dans la Bible ! Le souvenir de l’histoire antique est certainement une des clés pour expliquer le fait que les juifs ont survécu aux événements les plus dramatiques, alors même que l’histoire de ces événements n’était pas écrite par ceux qui les subissaient. L’explication essentielle tient finalement en des mots simples : les récits de leur origine, leur ont servi de canevas historique de ce qu’ils vivaient présentement. La mémoire juive s’est trouvée ainsi condensée dans la Bible.
Ainsi, pour les Juifs de l’exil, c’est-à-dire de l’après Second Temple, le souvenir des événements antiques a longtemps tenu lieu de substitut à l’histoire présente. Ce n’est pas à travers l’historiographie, science de l’écriture des événements, que la mémoire collective du peuple juif a été sollicitée. C’est ce qu’exprime fort bien Yerushalmi : « Ce fut l’Israël antique qui, le premier, donna sens à l’histoire : les Cieux racontaient la gloire de Dieu, tandis que l’histoire des hommes révélait Sa volonté et Ses desseins. La rencontre de l’homme et du divin quitta le royaume de la nature et du cosmos pour s’inscrire dans le plan de l’histoire, désormais pensée en termes de défi lancé par Dieu et de réponses apportées par l’homme. L’histoire devenait le lieu d’affrontement entre la volonté divine d’un Créateur omnipotent et le libre-arbitre laissé à Sa créature, à savoir l’homme. » Cette prééminence accordée au passé antique a longtemps prévalu et prévaut encore, nonobstant la tension permanente entre obéissance et révolte qu’on trouve de manière permanente dans la Bible, au point que cette tension est presque devenue une marque distinctive du judaïsme !
Au total, pour les Sages du judaïsme rabbinique, l’historiographie de la Bible ne serait rien d’autre que l’expression d’une conscience que le cours de l’Histoire a un sens, et que ce sens se situe au fondement même de l’identité juive. Cette conscience a été d’autant plus présente que l’histoire antique du peuple juif a très tôt été inscrite dans ces écritures, considérées comme étant sacrées ou saintes, et ayant comme vertu de fournir une identité originelle.
Mais, la question demeure : pourquoi, après avoir établi le canon biblique à la fin du 1er siècle, les Juifs cessèrent pratiquement d’écrire de l’histoire, à quelques exceptions notables près ? Le Judaïsme rabbinique qui a succédé au Judaïsme biblique a certes produit une prodigieuse littérature d’exégèse, d’herméneutique, de philosophie et de pensée, mais pas du tout de chronique historique. De plus, alors que la Bible, ne dit rien ou presque rien sur Dieu avant qu’Il ne créât le monde, la littérature rabbinique entretient un genre assez différent, notamment dans la littérature Midrachique, où les explicitations du projet divin prennent des formes les plus diverses. Mais, si l’écriture des événements que les Juifs vivaient, a été étrangère à leurs préoccupations, la recherche du sens que pouvaient avoir les événements antiques, a été leur souci premier, nourri par une imagination des plus fécondes.
Autre caractéristique importante, étrangère à toute tentative historiographique, les rabbins n’ont cessé de jouer avec le temps. Alors que les récits de la Bible ont la spécificité de respecter la chronologie des événements, les textes rabbiniques ignorent totalement les repères chronologiques. L’analyse textuelle et intertextuelle des commentaires de la Torah remplace l’histoire des événements, marquant en quelque sorte, l’immense différence entre voir et concevoir, différence que le judaïsme n’a cessé de cultiver par la suite ! Pour les Sages, être spectateur d’un événement ne garantit pas d’en saisir la portée ! Pour illustrer, Yerushalmi rappelle un épisode qui figure dans le Traité Talmudique Menahot (29 b) où Moïse, revenu quelques millénaires plus tard, assister à un cours du grand Sage que fut Rabbi Akiba, paraît très embarrassé, car il ne comprend rien aux arguments avancés par Rabbi Akiba. Le déroulement de cet épisode imaginaire permet néanmoins à Moïse de retrouver confiance. D’une part, Rabbi Akiba répète à ses disciples que la foi juive repose fondamentalement sur l’axiome de base que la Torah écrite et la Torah orale ont toutes deux été révélées à Moïse par Dieu, au mont Sinaï. D’autre part, à la demande de l’un des élèves qui demande à Rabbi Akiba d’où il tire cet argument, l’enseignant répond qu’il le tire de la parole de Moïse ! Voilà de quoi rassurer Moïse ! Ce récit imaginaire nous montre que dans le monde rabbinique, non seulement des scènes distantes entre elles de plusieurs millénaires, peuvent coexister, mais surtout, que leur coexistence a un sens important à découvrir, sans qu’il ne soit ni anormal, ni illogique, de procéder à la recherche de ce sens ! Autrement dit, l’argutie talmudique s’est beaucoup enrichie de Moïse à Akiba, mais elle est restée chevillée à la foi juive initiale.
Les rabbins se sont ainsi totalement absorbés dans une exploration continue du sens des écrits de la Bible, s’efforçant de l’interpréter en des termes les plus divers, avec l’espoir que cela ait un sens non seulement pour eux et leurs condisciples, mais également pour les générations futures. Mais, ces mêmes rabbins du judaïsme rabbinique n’ont accordé que peu d’attention aux événements post-bibliques, et notamment ceux de leur propre temps. La raison qu’en donne Yerushalmi est éclairante. Pour les rabbins, la Bible n’était pas seulement le livre de l’histoire advenue. C’était également la révélation de toute l’histoire à venir. Ils étaient ainsi persuadés que l’histoire avait une fin – en l’occurrence l’établissement du royaume de Dieu sur terre, annonciateur de l’ère de la rédemption. Dans l’attente de l’accomplissement divin de cette fin, le rôle essentiel était dévolu au peuple juif, allié de Dieu selon une alliance éternelle, bien que les hébreux de l’antiquité aient été souvent en rébellion contre Dieu : « La Bible avait appris aux rabbins que pour prendre le pouls de l’histoire, il ne faut pas écouter les manifestations en surface, mais entendre une histoire invisible qui avait plus de réalité que les rythmes bruyants des événements qui abusent un monde aveugle ! »
Quant au sens qu’ils donnaient à la rédemption, c’est-à-dire la fin de l’Histoire, les Sages talmudistes faisaient preuve d’une certaine prudence. D’abord, ils ont constaté que les tentatives d’accélérer l’advenue du messie avaient fini dans le discrédit, car les soulèvements contre Rome s’étaient achevés par des désastres et des désillusions. De plus, ils ont compris que si le combat physique contre de plus puissants qu’eux était perdu d’avance, il fallait développer la force de l’esprit pour sauver l’héritage. Mais, leur foi en la venue du Messie ne fut pas ébranlée pour autant, même si le temps de sa venue était laissé à la seule décision divine.
Au total, ce n’est donc que par abus de terminologie qu’un même terme – celui d’histoire – est utilisé pour désigner, aussi bien les événements passés dont traitent les historiens, que le sens que la tradition juive accorde au projet divin. C’est ainsi que, dans le judaïsme rabbinique qui allait longtemps imprégner la vie des Juifs dans le monde entier, l’histoire présente cessa de s’écrire, même si demeura la croyance de base que l’histoire avait un sens.
2/ Histoire et mémoire au Moyen-Âge
Tout comme lors de la période du judaïsme rabbinique, l’histoire présente n’a jamais été le principal vecteur de la mémoire juive au Moyen Âge. D’une part, la vie spirituelle et la créativité des communautés étaient nourries par l’étude talmudique. D’autre part, la mémoire juive au Moyen-Âge passait par des canaux autres que l’histoire présente, essentiellement les fêtes, les rites et la liturgie. Le temps présent était d’autant mieux associé au temps passé, que la lecture hebdomadaire de la Torah (Paracha de la semaine) et des commentaires que les Sages du judaïsme rabbinique lui avaient consacrés, permettaient de vivre le temps présent, comme s’il était fondu dans les temps antiques. La mise par écrit de la Torah orale, réalisée dans les traités de la Michna, du Talmud et du Midrach durant la période rabbinique antérieure, permettait ainsi une transmission intergénérationnelle de la mémoire juive au travers d’une chaîne ininterrompue d’enseignements et d’échanges.
A défaut d’historiographie, le Moyen-Âge a été néanmoins très riche dans d’autres genres de littérature, notamment la codification de la Loi juive, et la philosophie du judaïsme. Quatre objectifs distincts étaient en fait poursuivis par les auteurs juifs au Moyen-Âge : i/ Réfuter des thèses inamicales, objets de débats contradictoires entre juifs et chrétiens, comme ce fut le cas lors des disputations de Paris (1240) et de Barcelone (1263) ; ii/ Apporter des réponses fermes à ceux des Juifs qui niaient la validité de la Torah orale (karaïtes). Par exemple, les Treize Articles de Foi de Maïmonide, ont été une tentative pour doter le judaïsme d’une dimension théologique stricte pour ne pas dire dogmatique, à l’instar des deux autres monothéismes ; iii/ Rassembler les commandements de la Loi juive (Halakha) que l’on trouve éparpillés dans la Torah écrite et la Torah orale, afin d’aboutir à une codification juridique unifiée, et d’éviter de se perdre dans les méandres du Talmud. Le premier code de loi Halakhique a ainsi été le Michné Torah de Maïmonide ; iv/ Réconcilier la doctrine juive avec la pensée philosophique grecque, notamment celle d’Aristote, ce qui a été réalisé par Maïmonide dans son œuvre magistrale Moré Névoukhim (Guide des Égarés).
Au total, les savants Juifs du Moyen-Âge, stimulés par leur familiarité avec la culture arabe, qui permettait l’accès aux textes grecs, ont ouvert de nouvelles voies en philosophie, en science, en linguistique, et en poésie, mais pas en histoire. Une génération avant Maïmonide, le poète judéo-espagnol Moshé ibn Ezra avait déjà déploré l’absence d’écrits historiques, comme si les événements de l’époque n’étaient que des reproductions d’un canevas conceptuel établi depuis la période rabbinique, canevas selon lequel les persécutions et souffrances des juifs du Moyen-Âge ne seraient finalement que le résultat de l’exil opéré après la destruction du Second Temple, et de la perte de souveraineté nationale. Aussi réductrice qu’elle soit, une telle conception permettait néanmoins de réduire la peur éprouvée lors des événements les plus terribles, comme par exemple celui des croisades chrétiennes. Vivre les drames présents avec des lunettes éclairant des événements très anciens, rend la vie plus supportable ! Ainsi, l’oppresseur du Moyen-Âge ne serait autre que la figure familière du méchant Haman du Livre biblique d’Esther.
Certes, dans les grandes périodes de tension messianique, un regain d’intérêt s’observait pour les événements contemporains. Mais la discussion portait le plus souvent sur les liens qu’on pouvait faire avec des textes bibliques. Par exemple, le livre biblique de Daniel, prévoit quatre empires universels devant précéder l’avènement de l’ère messianique. Toute la question était alors de savoir si l’existence de ces empires était déjà avérée, ou si elle ne devait survenir que dans le futur ! Une autre tradition a servi la même fonction : il était coutumier de penser que l’avènement du messianisme serait précédé de l’affrontement final entre les pouvoirs maléfiques de deux puissances universelles, symbolisées par les deux noms propres Gog et Magog figurant dans le livre d’Ézéchiel. Restait à savoir quelles étaient ces puissances universelles, et là encore les postulants ne manquaient pas. Pour illustrer, Martin Buber a montré que les guerres napoléoniennes furent interprétées dans certains milieux hassidiques d’Europe orientale comme des guerres de type Gog et Magog.
De même, la symbolique numérique cherchait à découvrir des liens à la succession d’événements dramatiques. Par exemple, le nombre 7 était revêtu de diverses significations, au-delà du nombre de jours qu’il a fallu à Dieu pour sa Création. Il était directement ou indirectement associé à des événements marquants. Pour ne donner que quelques exemples, le Premier Temple aurait duré 427 ans, nombre qui est un multiple de 7 ; sa construction prit 7 ans, son siège dura 21 ans (autre multiple de 7) avant sa disparition effective ; la construction du Second Temple dura aussi 21 ans et il disparut après 7 ans de siège par l’armée Romaine. Cette schématologie numérique, traduit selon Yerushalmi « un intérêt très superficiel pour les événements eux-mêmes, mais un profond désir de débrouiller leur sens et leur place dans l’écheveau de l’histoire« . Tout cela montre que si une partie de la littérature juive du Moyen-Âge s’est intéressée à des événements historiques, ce n’est qu’en y voyant des signes précurseurs de la fin des temps. Ainsi, un livre historique important aux yeux des juifs médiévaux, signalé plus haut, est le Yosippon, écrit en hébreu par un Juif d’Italie du sud vers le milieu du 10ème siècle, qui relate l’histoire du peuple juif pendant l’époque du Second Temple. Quelques autres livres d’histoire sont également signalés par Yerushalmi, dont deux d’entre eux ont particulièrement retenu son attention : i/ Chroniques juives de la première croisade, écrites en hébreu au 11ème siècle et redécouvertes bien plus tard ; ii/ Le Livre de la Tradition (Sefer Ha-Qabbalah) d’Abraham Ibn Daoud, philosophe espagnol, qui a décrit le transfert des centres spirituels et culturels juifs, d’abord de la Babylonie vers l’Egypte, puis vers l’Afrique du Nord, ensuite vers la péninsule ibérique, et enfin de l’Espagne musulmane vers l’Espagne chrétienne.
Enfin, Yerushalmi note que les souvenirs que libéraient les rites et la liturgie, n’étaient pas objets d’intelligence, mais d’évocation et d’identification. De ce fait, la mémoire ne servait pas seulement pour se souvenir d’événements spécifiques, elle servait également à réactualiser le passé.
3/ Au lendemain de l’expulsion d’Espagne
L’expulsion des Juifs d’Espagne de 1492 n’était certainement pas la première expulsion que les Juifs aient subie. Elle a néanmoins marqué un événement radicalement nouveau : les Juifs d’Espagne se sont trouvés tout d’un coup déracinés d’un territoire où ils étaient établis depuis les premiers siècles de l’ère chrétienne, car issus de l’une des branches de la vaste diaspora juive disséminée dans tout l’Empire romain après la destruction du Second Temple. Ce déracinement a constitué une véritable tragédie, notamment parce que l’Espagne a longtemps été un havre de créativité pour les Juifs. Tout d’un coup, une partie de l’Europe occidentale se vidait de ses juifs !
L’importance de cet événement, suivi quatre ans après, par l’expulsion des Juifs du Portugal, a conduit à une résurgence au 16ème siècle d’un certain nombre d’écrits d’histoire, sans précédents au Moyen-Âge. Yerushalmi note ainsi l’apparition de dix œuvres historiques écrites en moins d’un siècle dont l’intérêt ne vient pas seulement des données historiques que l’on y trouve, ou de l’éclairage que chaque œuvre porte sur l’époque à laquelle elle fut écrite, mais surtout de l’éclairage que ces travaux apportent sur le rapport des Juifs au savoir historique en général. Pour la première fois depuis l’Antiquité, des auteurs juifs analysaient des événements historiques de grande importance. L’expulsion des Juifs d’Espagne de 1492 a eu lieu dans le calendrier hébraïque le 9 Av 5252, marquant une fois encore la fatalité du 9 Av, date où les deux Temples ont été détruits ! Un nouveau genre littéraire fut ainsi impulsé, marqué notamment par deux livres importants : 1. Shevet Yehuda (Le Sceptre de Juda) du rabbin, philosophe et historien espagnol, Salomon Ibn Varga (1460-1554), émigré au Portugal après l’expulsion d’Espagne de 1492, et converti de force au christianisme en 1497. Ce livre, qui raconte le massacre des juifs portugais convertis, a été l’objet d’une grande attention de Yerushalmi dans ses travaux. L’analyse des souffrances dues à l’expulsion des juifs est conduite via une suite de dialogues fictifs jalonnant les récits historiques des persécutions passées, pour montrer que cette réalité s’insère dans le canevas d’une histoire globale des persécutions. 2. Sefer ha Yuhasin (Livre des généalogies) du mathématicien et astronome Abraham Zacuto (1450-1515). C’est une histoire érudite des grands rabbins, avec des informations sur les événements de l’histoire juive, depuis la création du monde jusqu’à l’année 1500.
Les écrivains juifs du 16ème siècle voulaient comprendre pourquoi les juifs baignaient dans de tels bouleversements et le sens qu’ils pouvaient avoir. Mais si l’histoire juive a fait un bond en avant, au lendemain de l’expulsion d’Espagne, notamment si on la compare à ce qui l’a précédé, elle reste une tentative un peu ratée d’historiographie, même si elle témoigne du nouvel intérêt que des historiens juifs accordaient à des événements ayant marqué leur existence. Cette historiographie juive n’a en effet pas atteint le niveau d’analyse critique qui fut celui des meilleurs ouvrages d’histoire générale de cette époque. De plus, la critique ne concerne pas seulement la question d’archives insuffisantes, elle résiderait plutôt dans la réponse que ces travaux apportaient. Car, une fois encore, leur réponse revenait à souligner le lien entre la situation décrite et le passé antique ! C’est comme si la mémoire ineffable du passé antique cachait le sens de l’histoire présente qu’ils vivaient. La conclusion de Yerushalmi à l’égard de la tentative d’historiographie juive au 16ème siècle est donc plutôt négative : loin d’être la preuve qu’un intérêt véritable pour comprendre l’histoire de leur temps s’était répandu parmi les Juifs du 16ème siècle, il souligne combien les attitudes traditionnelles à l’égard de l’histoire se perpétuaient. Les vecteurs de la mémoire juive demeuraient, en quelque sorte, inchangés.
Un autre phénomène important est à rappeler. A la fin du 16ème siècle, un certain nombre de Juifs qui cherchaient encore le sens des souffrances historiques de leur peuple et de la durée de son exil, se sont reportés sur la kabbale d’Isaac Louria (1534-1574) et de ses disciples, élaborée à Safed en Galilée. Yerushalmi en présente une version assez négative : « Un peuple qui n’avait pas encore rêvé de se définir par des catégories historiques positives, paraissait trouver les clefs de son histoire dans un impressionnant mythe métahistorique, au caractère gnostique prononcé« . Selon ce mythe, tout le mal présent dans le monde, y compris bien sûr celui de l’exil des Juifs et de leur dispersion en Diaspora, plongerait ses racines dans le commencement de l’histoire. L’origine se trouverait dans une tragique « brisure des vases« , où se serait trouvée condensée la lumière divine. Cette brisure se serait produite à la création même du cosmos, et depuis, le monde serait plongé dans l’obscurité due à l’absence de lumière divine. Le monde serait donc en exil de lui-même, et seule la rédemption divine pourra l’en extraire. L’originalité de la théorie lourianique tient au fait que le premier acte de la divinité transcendante – ce que les kabbalistes appellent En Sof (l’Infini) – ne serait pas l’acte de révélation et d’émanation, mais, bien au contraire, un acte de restriction divine (Tsimtsoum) et il appartient à l’homme le soin de faire revenir Dieu. Ainsi, selon le Lourianisme, les malheurs d’Israël symboliseraient un conflit au cœur même de la création, empêchant la tentative du ciel de réaliser son infinie bienveillance !
Yerushalmi note que la juxtaposition au même moment des deux mouvements, que sont la tentative d’historiographie du 16ème siècle et la Kabbale d’Isaac Louria, est un fait dont on ne peut sous-estimer les conséquences si l’on veut comprendre les diverses facettes de la mentalité juive. Selon Yerushalmi, « l’accueil que le monde juif réserva à la kabbale de Louria est significatif du fait qu’il n’était pas préparé à accepter l’histoire en des termes immanents« . Comme si, avec la tragédie de l’expulsion d’Espagne, l’histoire juive était devenue opaque et ne pouvait plus donner un sens, sauf à l’enrober d’une interprétation mythique !
4/ Notre époque et ses dilemmes. Malaise dans l’historiographie
On pourrait penser que l’historiographie juive moderne débute avec le mouvement de la Haskala (Lumières Juives), mais ce serait erroné pour deux raisons. La première est que la nécessité pour les Juifs d’écrire l’histoire des événements qu’ils vivent, était loin d’être partagée par tous les protagonistes de la Haskala (Maskilim). La deuxième est que la conception de l’histoire que retenaient les Maskilim était plus proche de l’histoire biblique que de la recherche historiographique proprement dite.
Yerushalmi attribue plutôt à la Wissenschaft des Judentums (Science du Judaïsme), mouvement né en Allemagne, la paternité de l’historiographie juive. Les noms de Frankel, Geiger, Munk, Steinschneider et surtout Leopold Zunz (1794-1886) y sont associés, avec la création en 1819 de la Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden (Société pour la culture et la science des Juifs). Pour la première fois, ce n’était plus à l’histoire de prouver qu’elle pouvait être utile au judaïsme, mais au judaïsme de prouver sa validité par l’histoire.
Ainsi, l’interaction la plus générale et la plus profonde de la pensée juive avec la modernité, se fit grâce au nouvel intérêt que la pensée juive de la modernité a éprouvé pour l’historicisme, et à l’ouverture que la Wissenschaft à très tôt manifestée pour divers domaines d’activité culturelle et intellectuelle. Les conséquences furent également différentes de ce qu’on avait observé au Moyen-Âge, où les philosophes juifs, Maïmonide au premier chef, voulaient réconcilier le judaïsme révélé avec la vérité grecque. A l’époque moderne, l’historiographie juive ne s’embarrasse plus de cette réconciliation ; elle se fait quasiment en rupture avec la tradition juive. Dès lors, ce qu’est le judaïsme n’est plus une certitude partagée par tous les Juifs. Mais, cette rupture avec l’intimité de l’existence d’autrefois, ce qu’on désigne communément comme étant la tradition, s’est faite, sans créer véritablement un nouvel éthos.
Notamment, un point faible de la Wissenschaft doit être souligné. A quelques rares exceptions près, les chercheurs liés à la Wissenschaft des Judentums acceptèrent volontiers de renoncer à la notion de nation juive. Ils reconstruisirent un passé juif d’où l’élément national avait presque disparu. Face à ce manque, on comprend que les nouvelles idéologies juives de la fin du 19ème siècle, notamment le sionisme, aient ressenti un réel besoin d’en appeler à l’histoire nationale pour l’avenir du peuple juif. Au 20ème siècle, des perspectives et des voies entièrement nouvelles ont été tracées par des historiens de l’après Wissenschaft, et Yerushalmi cite, entre autres, les noms de Simon Doubnov en Europe orientale, de Salo Baron aux Etats-Unis, et d’une pléiade d’universitaires travaillant dans les Départements d’Etudes Juives des grandes universités de par le monde.
Enfin, et ce sera notre conclusion, il faut noter une tension spécifique, inhérente à l’historiographie juive contemporaine. Comme elle ne retient pas les prémisses qui furent dans le passé à la base des conceptions juives de l’histoire, en s’y opposant même sur des éléments cruciaux, elle institue une sécularisation de l’histoire juive. C’est sur cette dernière que repose l’historiographie juive contemporaine. Pour illustrer, les deux présupposés cardinaux que dénie l’historiographie juive contemporaine, sont, d’une part, celui que la conception juive traditionnelle considère comme étant le plus essentiel, à savoir la croyance en une divine Providence et, d’autre part, celui lié à l’idée que l’histoire du judaïsme est unique du fait de la révélation divine originelle. La remise en question de ces deux présupposés conduit parfois à considérer que l’historiographie juive contemporaine est la croyance des Juifs qui n’ont plus la foi. C’est pourquoi la conception traditionnelle d’une histoire juive providentielle demeure ancrée aujourd’hui encore chez nombre de croyants qui sont hostiles à la conception d’une démocratie moderne, alors même que celle-ci est l’objet des revendications d’autres citoyens. Ce sont là quelques pistes pour expliquer les fortes tensions qu’on observe dans la société israélienne. Néanmoins, pour ne pas dépasser les limites assignées à ce travail, nous ne développerons pas davantage ici ces aspects, sinon en renvoyant le lecteur à deux types de travaux. D’une part, au très intéressant ouvrage d’entretiens que l’historienne Sylvie Anne Goldberg a consacrés à Yosef Hayim Yerushalmi. D’autre part à différents travaux personnels. La perspective qu’il paraît souhaitable de développer dans un travail ultérieur de plus grande ampleur, consisterait alors à analyser les conflits de la société israélienne autour des différentes conceptions de trois notions de base : exil, retour, rédemption. Car, ce serait là qu’histoire et mémoire juive s’entremêlent une fois encore pour conduire à des conflits internes à la société israélienne. C’est la raison pour laquelle le préalable d’un décryptage du livre captivant de Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor, nous est apparu indispensable.
© David Encaoua
____________
Bibliographie
Baer, Yitzhak F., Galout, L’imaginaire de l’exil dans le Judaïsme, Préface de Yosef Hayim Yerushalmi, traduit de l’allemand par Marc de Launay, Calmann-Lévy, Paris, 2000
Berlin, Isaïah, Trois essais sur la condition juive, traduit de l’anglais, Calmann-Lévy, Paris 1973
Buber, Martin, Gog et Magog : Chronique de l’épopée napoléonienne, traduit de l’allemand par J. Loewenson-Lavi, Gallimard, 1958.
Doubnov, Simon, Diaspora présenté par Stéphane Dufoix. In : Diasporas. Histoire et sociétés, n°5, 2004, https://www.persee.fr/doc/diasp_1637-5823_2004_num_5_1_968
Encaoua, David, Les divisions de la société israélienne, analysées du point de vue du judaïsme, Tribune Juive, 7 octobre 2023, https://www.tribunejuive.info/2024/05/22/david-encaoua-les-divisions-de-la-societe-israelienne-analysees-du-point-de-vue-du-judaisme/
Encaoua, David, Traversées du Judaïsme au regard des Enjeux Contemporains, Harmattan, Paris, 2024
Encaoua, David, Le Judaïsme sous le regard de la science, Sifriatenou, https://sifriatenou.com/2023/05/31/trautmann-waller-celine-philologie-allemande-et-tradition-juive-le-parcours-intellectuel-de-leopold-zunz/
Encaoua, David, Le Tournant Théologique des Treize Articles de Foi de Maïmonide, https://www.adathshalom.org/author/david-encaoua/
Encaoua, David, Quelles incidences des sionismes sur la société israélienne ? Ops & Blogs, The Times of Israël, documents 1 à 4, https://frblogs.timesofisrael.com/author/david-encaoua/
Goldberg, Sylvie Anne, Penser l’histoire juive au début du XXe siècle, Cahiers du monde russe, 41/4, octobre décembre 2000, https://journals.openedition.org/monderusse/57?file=1
Idel, Moshé, Messianisme et Mystique, traduction de l’hébreu par Catherine Chalier, Cerf, Paris, 1992.
Scholem, Gershom, Le Messianisme juif. Essais sur la spiritualité du Judaïsme, traduction par Bernard Dupuy, Les belles Lettres, Paris, 2016.
Scholem, Gershom, Fidélité et Utopie, Essais sur le Judaïsme Contemporain, traduit par Marguerite Delmotte et Bernard Dupuy, Calmann-Lévy, Paris, 1978
Strauss, Léo, Pourquoi nous restons juifs, Révélation biblique et philosophie, traduit de l’anglais par Olivier Sedeyn, Editions de La Table Ronde, Paris, 2001
Yehoshua, Abraham B., Pour une normalité juive, traduit de l’hébreu par Eglal Errera et Amit Rotbard, Liana Levi, Paris, 1992
Yerushalmi, Yosef Hayim, Zakhor, Histoire juive et mémoire juive, traduit de l’anglais par Éric Vigne, Éditions La Découverte, Paris, 1984
Yerushalmi, Yosef Hayim, Sefardica, Essais sur l’histoire des Juifs, des marranes & des nouveaux chrétiens d’origine hispano-portugaise, Préface de Yosef Kaplan, traduit de l’anglais par Cyril Aslanoff, Paul Teyssier, Jean Letrouit & Inès Garcia, Editions Chandeigne, Paris, 1998
Yerushalmi, Yosef Hayim, Transmettre l’histoire juive, Entretiens avec Sylvie Anne Goldberg, Albin Michel, Paris, 2012.
A propos de l’auteur:
Professeur de Sciences Économiques à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne pendant plus de trente-cinq ans, David Encaoua, issu d’une famille de juges rabbiniques d’origine hispano-maghrébine, se consacre à l’exploration de la pensée juive, combinant des textes de la tradition et des travaux universitaires d’Études Juives.



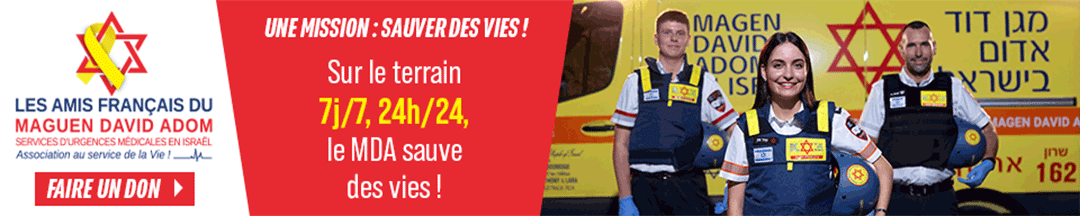
Poster un Commentaire