
Le tribunal judiciaire de Paris a-t-il outrepassé ses prérogatives en ordonnant l’exécution provisoire de l’inéligibilité de Marine Le Pen ? Trois jours après une décision du Conseil constitutionnel posant des limites strictes à cette mesure, la justice pénale a choisi de passer outre, explique Jean-Éric Schoetll, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, auteur de « La Démocratie au péril des prétoires : De l’État de droit au gouvernement des juges » (Gallimard). Une décision juridiquement discutable, politiquement lourde, qui soulève de sérieuses questions sur le respect du droit d’éligibilité, la souveraineté populaire… et la tentation d’un gouvernement des juges.
Procès des assistants des eurodéputés du RN : la fuite en avant des juges. L’exécution provisoire de l’inéligibilité ordonnée contre Marine Le Pen par le tribunal correctionnel de Paris, décidée le 31 mars dans l’affaire des assistants des eurodéputés du Rassemblement national, est contestable à divers égards. Elle est d’abord contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2025 (QPC n° 2025-1129).
CE QU’A DIT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Étaient contestés, dans l’affaire jugée par le Conseil constitutionnel, deux articles du code électoral portant l’un sur l’inéligibilité aux élections municipales des individus privés d’éligibilité, l’autre sur sa conséquence (la déchéance immédiate du mandat en cours). En s’en tenant strictement aux dispositions en cause, on pouvait certes constater que les deux articles soumis à l’appréciation du Conseil constitutionnel n’avaient pas de rapport direct avec l’éligibilité à une élection présidentielle.
Toutefois, pour mesurer la portée de la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars, et ses incidences sur la décision rendue trois jours plus tard par le tribunal judiciaire de Paris, on ne pouvait se borner à ce constat. Ce qui était essentiellement en jeu, dans les deux affaires, c’était l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité. Lorsque celle-ci est prononcée par le juge, elle est d’effet immédiat : l’intéressé ne peut plus se porter candidat à une élection et ses mandats électoraux (autres que parlementaires), s’il en exerce, s’interrompent. Et ce, alors même qu’il n’est pas définitivement jugé. Le droit au recours et le droit d’éligibilité en sont nécessairement affectés.
La question de l’inéligibilité à titre provisoire d’un élu municipal est englobée par celle, plus générale, de l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité. Cette question touche tous les mandats électifs, avec cette différence que la déchéance du mandat parlementaire par suite de l’inéligibilité n’est, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, jamais prononcée avant condamnation définitive.
ORDONNER L’EXÉCUTION PROVISOIRE DE L’INÉLIGIBILITÉ
Le Conseil devait se prononcer sur le point de savoir si l’exécution provisoire d’une inéligibilité était conforme à la nature des mandats politiques et plus particulièrement à la liberté de l’électeur. Au-delà de l’effet immédiat de l’inéligibilité sur l’exercice d’un mandat, était en cause son effet immédiat sur la possibilité de se présenter à une élection future.
La faculté, pour le juge pénal, d’ordonner l’exécution provisoire de l’inéligibilité résulte, que ce soit pour la poursuite du mandat ou pour le droit de se présenter à une élection, des dispositions combinées de l’article 131-26-2 du Code pénal (trouvant son origine dans la loi Sapin 2), qui punit de la peine complémentaire « automatique » d’inéligibilité des manquements à la probité comme le détournement de fonds publics et la prise illégale d’intérêts, et de l’article 471 du code de procédure pénale, qui permet de donner un effet immédiat aux peines complémentaires.
La réponse apportée par le Conseil avait donc une portée dépassant celle du sort des mandats en cours des élus municipaux. Elle concernait notamment l’élection présidentielle. La loi organique du 6 novembre 1962 relative à l’élection présidentielle prévoit en effet qu’un candidat inéligible ne peut être candidat à cette élection. Elle le fait par renvoi à l’article L199 du code électoral, aux termes duquel : « Sont inéligibles les personnes désignées à l’article L. 6 et celles privées de leur droit d’éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ». Le Conseil constitutionnel a statué au regard notamment « du droit d’éligibilité, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 3 de la Constitution ».
Le cœur de sa décision tient dans une réserve d’interprétation explicite, de portée « directive » : « Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure (l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité) est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ». Il résulte de ses termes mêmes que cette réserve d’interprétation s’applique non seulement aux mandats en cours, mais encore aux élections futures. Quel sens aurait sinon la référence à la liberté des électeurs ?
Conformément à sa jurisprudence antérieure, le Conseil constitutionnel ne censure pas, dans son principe, l’exécution provisoire de l’inéligibilité. Cette mesure, considère-t-il, a pour objet de prévenir la récidive, de garantir la bonne exécution des décisions de justice et de contribuer à « renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants ». Mais il assortit cette bénédiction d’une sérieuse réserve d’interprétation.
CONSÉQUENCES DISPROPORTIONNÉES SUR LA LIBERTÉ DE L’ÉLECTEUR
Eu égard à cette réserve, le tribunal judiciaire de Paris ne pouvait éviter de se prononcer sur le point de savoir si l’exécution provisoire de l’inéligibilité de Marine Le Pen et de ses coprévenus emportait de conséquences disproportionnées sur la liberté de l’électeur lors des prochains scrutins, notamment à l’élection présidentielle. Et poser cette question, c’est y répondre : l’exécution provisoire de l’inéligibilité de Marine Le Pen emporte manifestement des conséquences disproportionnées sur la liberté de l’électeur, car elle prive des millions de nos concitoyens de leur candidate naturelle à la principale élection du pays.
Déjà discutable quant à ses finalités (prévenir la récidive ? sauvegarder l’ordre public ?), l’exécution provisoire de l’inéligibilité méconnaît la réserve d’interprétation émise par le Conseil. Elle va en effet à l’encontre de la « liberté de l’électeur » que la réserve d’interprétation vise précisément à garantir. Elle contrevient, ce faisant, à l’autorité conférée par l’article 62 de la Constitution à la chose jugée par le Conseil constitutionnel.
La décision du tribunal judiciaire de Paris est également contestable du point de vue de la souveraineté populaire et de l’universalité du suffrage. En démocratie, c’est en effet à l’électeur de dire qui est digne de ses suffrages. Nous basculerions dans le gouvernement des juges si nous admettions que le peuple est incapable de discernement moral et qu’il appartient en conséquence à la magistrature de filtrer les candidats selon l’idée qu’elle se fait de leur vertu.
Le 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a pris le risque de se rebeller contre le Conseil constitutionnel, comme celui de déstabiliser la vie politique du pays en frustrant et en indignant une partie importante de ce « peuple français » au nom duquel il statuait.
© Jean-Éric Schoettl

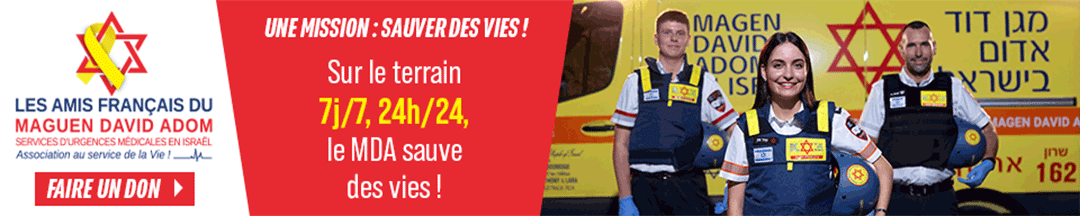
Poster un Commentaire