
La quantité d’études sur Kafka est incommensurable. Ce qui les caractérise en règle générale est leur diversité qui dépend des préoccupations personnelles de leurs auteurs– celles, en particulier, d’auteurs célèbres. Rien de surprenant à cela, car les romans les plus connus de l’écrivain juif tchèque ne sont pas faciles à décrypter.
C’est ainsi que Walter Benjamin découvre chez Kafka une forme de messianisme, Hannah Arendt voit dans le Procès le tableau du totalitarisme. Max Brod, l’ami le plus proche de Kafka, et son biographe, qui a publié ses manuscrits en dépit de la demande de l’auteur de les brûler, insiste, quant à lui, sur la profonde religiosité de son ami. Nul doute qu’il soit à la fois possible et hasardeux de varier les lectures sur Kafka —qui d’athée s’est rapproché de la foi et s’est mis à étudier le Talmud ; qui d’antisioniste a fini par vouloir émigrer en Palestine — d’arriver à un portrait-robot de son œuvre à supposer qu’elle traduit son état d’esprit du moment. La langue et le style des romans de Kafka intéressent, à juste titre, de nombreux spécialistes. La liste des interprétations est impressionnante tout comme la complexité de cet immense écrivain. C’est pourquoi une perspective supplémentaire qui a peut-être été négligée sera l’occasion ici d’une lecture inédite.
Car les interprétations du Procès de Kafka ne m’ont satisfaite qu’à moitié d’autant que le manuscrit n’était pas achevé lorsque l’auteur l’a remis à Brod avant sa mort. Ce n’est pas qu’il manque de thèses et d’hypothèses convaincantes à son sujet. Que n’y découvre-t-on point ? On y décerne souvent l’illustration de la persécution aveugle des Juifs sous la forme d’une parabole comique. Mais, la majorité des critiques juifs depuis la deuxième guerre mondiale y voient la prophétie de la Shoah. Primo Levi, à qui l’éditeur Giulio Einaudi a demandé de traduire Le Procès en 1983 [1], dit qu’en traduisant il revivait son incarcération à Auschwitz, ses peurs les plus intimes, et qu’il est retombé en dépression. Il avait le sentiment que c’est à lui qu’on avait intenté ce procès.
Ce qui m’interpelle dans ce roman, outre ce qui a déjà été dit et redit, est le sens de la culpabilité que K. semble accepter d’office.
Le récit commence par l’arrestation d’un homme, travailleur modèle et intègre qu’on accuse d’être coupable sans lui dire de quoi. On va lui faire un procès, mais en attendant on le laisse libre. Le pauvre K., complètement désemparé, est soumis à des spectacles absurdes et effrayants. D’autres personnages entrent en scène dans un climat surréaliste. Les avocats, grotesques pour le moins, ne sont d’aucun secours à K. Un prêtre dans une cathédrale désespère K. encore davantage.
L’avant-veille de son anniversaire, K. est interpellé par deux hommes qui le massacrent littéralement, en dehors de la ville, sans résistance de sa part, avec un couperet de boucher.
Pourquoi se laisse-t-il faire ? Pourquoi ne proteste-t-il pas ? Les Juifs vivent encore à Prague et en Allemagne où, à tort ou à raison, ils se sentent chez eux. Le manuscrit date de 1915. Durant La Grande Guerre les Juifs combattaient aux côtés des Allemands. Brod a publié le roman, (même s’il y a fait de menus remaniements), en 1925. Les camps de la mort n’existent pas encore. L’antisémitisme gronde, il est vrai, mais pas sous cette forme inhumaine.
Comment expliquer dès lors le comportement de K. ? Il est clair qu’il accepte d’être coupable. C’est ce que l’auteur semble dire au lecteur. Cela signifie–t-il qu’en tant que Juif il a intériorisé la culpabilité qui est attribuée aux Juifs en Occident depuis l’accusation du déicide ?
Ce n’est pas le cas des Juifs orthodoxes attachés indiscutablement à leur religion et revendiquant leur différence. Il s’agirait d’une catégorie de Juifs écartelés entre leur ethnie et leur désir d’échapper à leur particularisme. Dans Réflexions sur la question juive, Sartre les appelle Juifs inauthentiques :
« Beaucoup de Juifs inauthentiques jouent à n’être pas Juifs… car… ils vivent leur situation de Juifs en la fuyant – ils ont choisi de la nier… le Juif, parce qu’il se sait regardé, prend les devants et essaie de se regarder avec les yeux des autres… Le rationalisme des Juifs est une passion, la passion de l’universel. »[2]
Or, certains Juifs qu’avec Sartre j’appellerai « universalistes », y compris des Israéliens, vilipendent la guerre à Gaza, accusent les soldats d’exactions, de génocide et d’autres méfaits après l’indicible pogrom du 7 octobre 2023 commis par Hamas contre hommes, femmes, enfants innocents. La prise en otages de femmes avec des bébés dans les bras.
Nous avions l’habitude de supposer que l’attitude de ces Juifs qui manifestent avec l’ennemi traduisait la haine de soi.
Le dénouement du Procès de Kafka semble nous en apprendre tout autre chose. Plutôt que la haine de soi, nous découvrons là un phénomène que Sigmund Freud s’est déjà approprié.
Dans un essai manuscrit sur le Moïse de Sigmund Freud (il avait déjà publié un ouvrage sur Moïse et Nietzsche de Freud en 1987), le regretté professeur de philosophie, Jacob Golomb trace le portrait de Freud qui, contrairement aux intellectuels juifs de son temps, dépourvus d’identité, est, lui, un Juif fier. L’hypothèse de Golomb propose que Freud a inventé un Moïse qui n’était pas juif et qu’il a été assassiné pour avoir embrassé la religion monothéiste. D’après Golomb, Freud, dans son incarnation en Moïse, arrive à réconcilier sa marginalité existentielle et celle de son judaïsme.
Tous les Juifs ne sont pas Freud, et les Juifs marginaux adoptent le point de vue de ceux qui leur sont hostiles. K. en était un. Il a endossé le crime qu’on lui imputait. Les Juifs marginaux, de nos jours, agissent de même.
© Thérèse Malachy-Krol
L’Université Hébraïque de Jérusalem
Notes
[1] In Stefano Bellin “Primo Levi and Franz Kafka: An Unheimlich Encaunter,” (216) p.139- -p.159
[2] Sartre (Jean-Paul) Réflexions sur la question juive Gallimard, 1954, p. 67
© Thérèse Malachy
Spécialiste de la littérature et du théâtre français à l’Université hébraïque de Jérusalem, Thérèse Malachy-Krol est une des rares survivantes qui puisse encore témoigner de ce qu’elle a connu dans cette ville, symbole de l’extermination massive des Juifs, mais aussi de leur révolte héroïque.
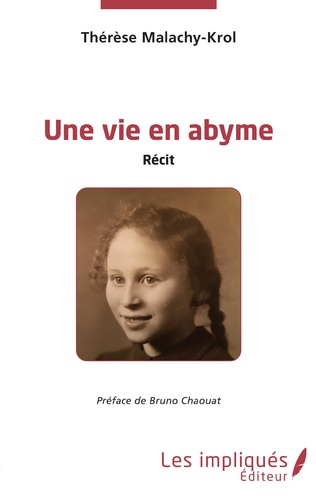
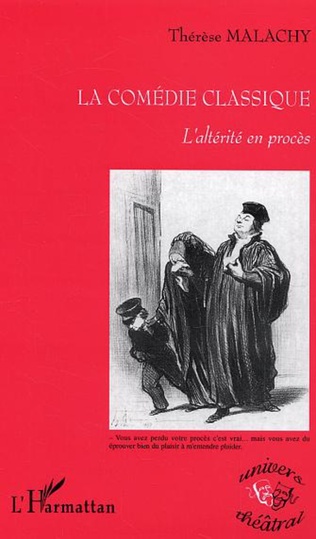

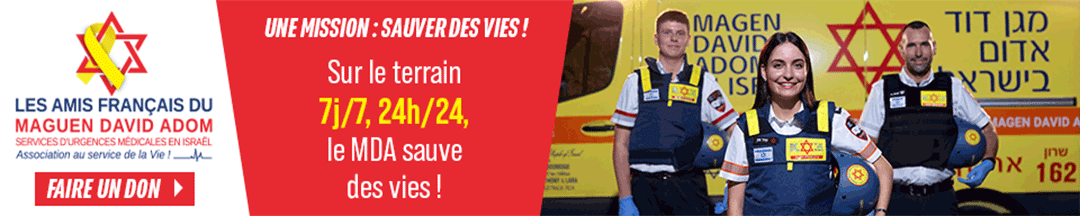
Poster un Commentaire