
Au lendemain du 7 octobre, ils furent nombreux, caméra à l’épaule, réalisateurs israéliens ou de diaspora, à s’être rendus, en équipe restreinte, urgence et pudeur faisant, sur les lieux du crime. Bouzaglo et son caméraman sont, eux, retournés à Sderot et les revoilà nous offrant un ovni dans la production sur le sujet, un film intimiste sur la guerre, comprendre « un film sur la guerre mais vue du dedans », et choisissant les mêmes acteurs, telle une suite de Bab El Ward.
La tragédie que d’aucuns ont nommé Pogrom lorsque d’autres la qualifiaient d’innommable, nous allons la vivre dans le modeste appartement des Vaknin, Albert ( Albert Iluz) et Annette, (Annette Cohen), déjà familiers depuis « Bal El Ward » en 2022, ce couple qui, alors que nous venions de passer shabbat chez eux avec Elia, le fils chéri, passé avec ses amis avant d’aller au Festival Nova, est réveillé à l’aube par l’alerte rouge, cette alerte devenue au fil des ans partie du décor mais qui, cette fois, sonnait sans que quiconque le sût le tocsin de l’indicible carnage du 7 octobre.
Nous voilà embarqués sur un huis-clos de quelque 25 heures : voilà, sommairement résumé, « Red Flower », le dernier film de Haïm Bouzaglo.
Pourquoi une immédiate référence à Cassavetes vient-elle saisir le spectateur cinéphile. Parce que le réalisateur américain nous a souvent donné à voir l’intimité de ces couples banals et desquels la description nous a pourtant si souvent fascinés par le réalisme de leur fonctionnement, scruté au scalpel, de leurs tensions et dysfonctionnements profonds jusqu’à leurs réconciliations ? Incontestablement il y a du Cassavetes en Bouzaglo, mais il y a du Bouzaglo avant tout : celui de « Bab El Ward ». Car Bouzaglo, comme le fit un Cassavetes dans « A Woman Under the Influence », qui se déroule presque entièrement dans l’appartement d’un couple, suit ici la famille Vaknin, du soir du 6 octobre à celui du 7 octobre, ce clan venu du Maroc, fidèle à Dieu et si traditionnel déjà mis en scène dans la comédie dramatique « Bab El Ward ».

Ils se sont intégrés, les Vaknin. En témoignent ce téléviseur, jadis branché sur la chaine marocaine, ici sur la 13. L’arabe judéo-marocain délaissé au profit d’un mélange délicieux d’hébreu-français-arabe. Plus de références au Maroc regretté. Un ras le bol de ces alertes trop fréquentes : Qu’est-ce qui leur prend encore…Et toujours, ce sens de la fatalité : Encore ? Encore ?
C’est Simhat Torah.
Lorsque les sirènes commencent à retentir le lendemain matin, ils reçoivent quasi simultanément un appel d’Elia, appel auquel ils décident, au vu de la situation, de répondre malgré l’observance stricte du shabbat : depuis « Nova », Elia effaré tente d’expliquer une situation inédite, donne sa géolocalisation et supplie ses parents d’appeler la police : le supplice gagne le couple, qui prie avec frénésie pour leur fils mais aussi pour leur nièce, policière sur la frontière.
La 13 est allumée et ses images et témoignages, captant au fur et à mesure le désastre dans le Sud et en mesurant progressivement l’exacte ampleur, se mêlent à celles de Bouzaglo : les tirs se rapprochent ; le poste de police juste en face de la maison est envahi par des terroristes, et c’est à travers le regard d’Albert depuis la fenêtre que les scènes de carnage pénètrent le spectateur, mobilisé sur tous les fronts, des flashs télé aux massacres de Sderot en passant par l’angoisse inénarrable du couple qui vit la guerre en direct, la commente, se chamaille, en vient à aborder des sujets essentiels, le regard toujours rivé sur le portable qui se refuse à sonner.
La 13 s’attarde sur les lieux du festival de musique, des images de terreur qui à tous désormais sont devenues familières. Comme les commentateurs dépêchés sur l’écran Télé, Albert et Annette sont dans une sidération extrême devant l’impensable : le pays s’effondre sans que l’armée réagisse ? Monte en eux une colère sourde face à la tragédie dont ils n’ont pas encore mesuré l’étendue.
Comment Bouzaglo décrit-il l’avancement de la journée. Ce fils impossible désormais à joindre. Ces quelques appels de proches s’enquérant des nouvelles. Dans le mamad qu’à présent ils ont investi, résignés, la dispute entre Albert et Annette aborde des points essentiels : elle l’assurera que non elle ne le quittera pas : Il y a les enfants. Oui ils seront enterrés côte à côte. Les flashs et témoignages sur l’écran. Les rituels esthétiques auxquels s’adonne la désarmante Annette. Autant de scènes si humaines qui s’encastrent, palimpsestes, dans la tragédie nationale : le toit-même de leur bâtiment est investi par des soldats des FID.
Seule la prière – pour Elia, ses amis et pour leur nièce- semble, se faisant frénétique, permettre au couple de survivre à l’angoisse et l’effroi. Summum du réalisme lorsqu’Annette décidera de quitter le mamad pour se peindre les ongles tandis que les sirènes hurlent : Sinwar ne va pas décider quand je peins mes ongles, déclare-t-elle.
En somme une construction inédite qui amène le spectateur à voir les exactions du 7 octobre via le canal 13 de la télé israélienne qui diffuse d’abord en Flash spécial puis en témoignages, mais encore par la fenêtre-même devant laquelle notre Albert, sidéré, regarde le poste de police sous le joug terroriste et par les quelques coups de fils reçus au fur et à mesure des 25 heures du huis-clos. La sidération, l’incompréhension totale, face au pogrom, de la faille, l’absence, la vulnérabilité d’un Tsahal fantasmé comme invincible protecteur.
Là où d’autres ont choisi de documenter, Bouzaglo nous donne à vivre la terrifiante attente, les indicibles questionnements et doutes et la mortelle angoisse de tout Israélien ce jour-là, vivant en live une guerre éclair à laquelle le pays n’a pas été préparé. Nous voilà prisonniers comme eux, abandonnés, assommés, encore une fois, encore une fois donc, répète Albert.
Alors qu’un Pierre Rehov ou un José Ainouz, respectant la règle du genre, montrent, questionnent, interrogent, àSderot ou Ofakim, on est amené à se demander ce qui a le plus d’impact -on pense surtout aux incrédules et autres négationnistes- : le docu pur jus, ou alors la tentative brillante de Bouzaglo de « faire du cinéma » avec la guerre en cours, le sang encore coulant, les plaies à jamais ouvertes, les otages aux mains des barbares. Un film en somme avec un début, une fin.
Faut-il disserter sur la meilleure manière de dire le 7 octobre et ne peut-on affirmer que docu, docu-drame et autres essais se complètent, le projet commun étant de dire, et de laisser une trace pour l’Histoire de tous ces morceaux de vie mêlant tragédie extrême et héroïsme.
Ne faut-il pas aussi louer le triste privilège offert par la technique : alors qu’il fallut des décennies pour réaliser des films de haut niveau sur la guerre du Yom Kippour et d’autres conflits israéliens, les cinéastes d’aujourd’hui, à une vitesse vertigineuse, se font reporters-correspondants de guerre, d’une guerre ici absolument inédite de quelque côté qu’on la regarde, et tirent tous leur exception par l’immédiateté de l’accès à l’image là où récemment encore seules quelques photos racontaient le chaos.
Un privilège au goût pervers et d’autres fois amer et douloureux, lorsque nous avons entre les mains les films diffusés sur le net en temps réel par les terroristes eux-mêmes et les civils gazaouis infiltrés, lesquels ont connu l’orgasme et la schadenfreude en filmant meurtres, enlèvements et autres forfaits perpétrés et en les diffusant sur les médias sociaux, des morceaux de haine contrastant tragiquement avec les enregistrements vidéo et audio laissés par les victimes et que certaines familles ont partagés en guise de témoignage.
© Sarah Cattan
____________
À Relire: L’entretien accordé par Haïm Bouzaglo à TJ
— Sarah Cattan (@SarahCattan) March 14, 2025

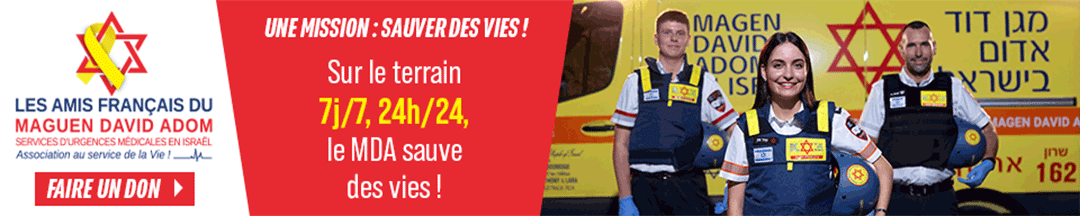
Les films de Pierre Rehov et de Ainouz se contentent de publier des images des télévisions israéliennes sans aucune recherche surtout le 2eme. Rapportant des témoignages vus et revus …..
Films money money sans intérêt