
GRAND ENTRETIEN – Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale en juin dernier, les responsables politiques comme les commentateurs se débattent dans un marasme ne faisant qu’accroître le désarroi des Français.
LE FIGARO. – Comment appréciez-vous la situation créée depuis la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron en juin dernier ?
JEAN-PIERRE LE GOFF. – Comme un brusque coup d’accélérateur de l’autodestruction du politique donné par un président de la République qui s’est cru tout-puissant, sans prendre la mesure d’une « France morcelée » et du fossé existant avec les mentalités et les préoccupations des citoyens ordinaires. Le résultat est là, nous nous débattons dans un marasme qui dégrade un peu plus la politique et accroît le désarroi.
Depuis la dissolution et la censure d’un gouvernement qui aura duré trois mois, la politique a offert un drôle de spectacle qui renforce l’impression d’irréalité et d’impuissance. La bulle médiatico-politique alimentée par les chaînes d’information en continu et les réseaux sociaux s’est nourrie des divisions et des tractations à n’en plus finir, comme dans une mauvaise série télévisuelle avec des scénarios bancals et des castings changeants.
Analystes, journalistes, conseillers de tous ordres ont été intarissables sur les pronostics, les dits et les non-dits, les échanges, les rencontres officielles ou secrètes. Des journalistes ont fait le pied de grue « en direct » devant l’Élysée ou Matignon cherchant le moindre signe qui mettrait fin au « suspens de la nomination ». On a débattu et redébattu sans cesse des questions qui touchent le fond : « Quel “signal fort” envoyer aux uns ou aux autres ? », « Quelles “lignes rouges” à ne pas dépasser ? », « Que se sont-ils dit au juste avec Macron ? », et cette interrogation cruciale qui, à n’en pas douter, passionne les Français : « Les socialistes vont-ils bouger ? »…
Et pendant ce temps-là, les sondages succèdent aux sondages avec toujours la même question : « Que veulent vraiment les Français ? », comme si, sondés sous tous les angles, on ignorait tout de leurs préoccupations. Ce maelstrom renforce le discrédit de la politique et fait le jeu du Rassemblement national et de La France insoumise qui profitent de la crise et s’affirment comme des partis vierges de toute compromission.
Face à ce climat de déliquescence, beaucoup d’observateurs tentent aussi de se raccrocher à certains succès comme celui des Jeux olympiques ou à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Pour Emmanuel Macron, le succès de la reconstruction de la cathédrale peut contribuer à définir les réponses aux défis politiques. N’êtes-vous pas de cet avis ?
Ne mélangeons pas tout. Quand la politique est impuissante à résoudre les problèmes fondamentaux et à unifier le pays, on met en avant des « succès » dans des domaines qui ne relèvent pas des mêmes finalités. Au demeurant, ceux des Jeux olympiques et la reconstruction de la cathédrale de Paris ne sauraient être mis sur le même plan.
Les Jeux olympiques participent des loisirs modernes avec une dimension spectaculaire et festive de plus en plus prononcée qui a donné lieu à l’expression débridée d’émotions et de plaisirs éphémères. La reconstruction de la cathédrale a impliqué des dévouements, des engagements et des compétences d’une autre nature qui s’inscrivent dans une histoire séculaire, avec la transmission d’un héritage catholique qui a façonné notre histoire et des cérémonies qui se réfèrent à un ordre transcendant.
L’invocation éthérée de « l’esprit des Jeux olympiques » mêlée à celle de la cathédrale de Paris participe du grand mélange des genres postmodernes qui noie tout dans l’indistinction et sert de supplément d’âme à un pays divisé et à une crise politique dont on ne voit pas le bout.
En disant cela, ne risquez-vous pas d’être considéré comme un populiste qui s’en prend facilement à la « classe politique » en la rendant responsable de tous nos maux ?
Ce spectacle de la politique est une réalité consternante ressentie comme telle, ce qui ne signifie pas que tous les politiques vivent et se débattent dans la bulle des chaînes d’info en continu et des réseaux sociaux qui les coupe des réalités. Selon leurs parcours de vie et de formation, tous ne considèrent pas la politique comme un projet de carrière à la mesure de leur ambition. Beaucoup ont une expérience humaine, une culture, des convictions fortes et argumentées, gardent le sens de l’État. Leur dévouement et leurs compétences pour sortir le pays du marasme ne sont pas en cause.
Faute de s’attaquer résolument à ces questions, l’autorité et la confiance dans la politique et les institutions se sont érodées ; la méfiance et le ressentiment se sont développés dans les rapports sociaux
Mais il s’agit d’éviter les faux-fuyants en reconnaissant sans ambages des problèmes qui n’ont rien de réjouissant et préoccupent grandement les Français. Face à une situation économique et sociale dégradée, aux incivilités et aux violences de tous ordres, aux trafics de drogue, à l’antisémitisme, à l’immigration clandestine, à l’islamisme…, le pouvoir politique a trop longtemps donné l’impression de tergiverser et de tourner en rond, enrobant ses hésitations et son impuissance dans le rappel éthéré des grands principes et des « éléments de langage » qui finissent par « noyer le poisson ».
Faute de s’attaquer résolument à ces questions, l’autorité et la confiance dans la politique et les institutions se sont érodées ; la méfiance et le ressentiment se sont développés dans les rapports sociaux. Pour beaucoup, la France est devenue un pays où il ne fait plus bon vivre, au moins dans certaines villes et quartiers. Sans parler des répercussions de l’image et de la place de la France en Europe et dans le monde dont le poids et l’influence sont mis en question.
Comment envisagez-vous la sortie possible de cette crise ?
Par-delà la nécessité de s’attaquer à la dette et de gérer au mieux les problèmes les plus urgents, il est une question incontournable : « Comment un gouvernement de coalition et de compromis, cherchant à tenir le plus longtemps possible pour assurer la stabilité, dépendant d’une majorité fragile et incertaine (avec, entre autres, un PS divisé), soumis à la menace de la censure avec le RN et la LFI en embuscade…, comment ce gouvernement pourrait-il être en mesure de rompre avec le maelström ambiant ? » Quoi qu’il en soit de la composition et de la détermination du nouveau gouvernement, la réponse à cette question ne relève-t-elle pas de la quadrature du cercle ?
Quant à la proposition d’introduire une dose de proportionnelle dans le scrutin législatif comme un outil qui permettrait de retrouver des majorités, elle me paraît relever d’un bricolage institutionnel qui ne changerait rien de fondamental à la vision dépréciative des citoyens envers la politique, mais au contraire risquerait de l’aggraver par les marchandages et les combinaisons à l’insu des électeurs que cette introduction pourrait entraîner.
Il est du reste pour le moins paradoxal de répéter à satiété qu’il faut apprendre à faire des compromis et des coalitions comme cela se pratique dans d’autres pays européens dont l’Allemagne, au moment même où dans ce pays la coalition gouvernementale a volé en éclat. Autant achever la Ve République sans le dire ouvertement.
La nomination de François Bayrou comme premier ministre et la composition de son gouvernement ne constituent-elles pas une voie possible pour sortir de l’indécision ?
On ne manque pas de multiplier les hypothèses sur les marges de manœuvre possibles d’un nouveau premier ministre qui n’ignore pas un « Himalaya de difficultés » et entend « réconcilier les Français ». Comme l’a dit Michel Barnier au moment de la passation des pouvoirs à Matignon : « La politique ne peut pas se réduire à un champ de manœuvre, dans une sorte d’entre-soi dont les citoyens sont exclus. »
À vrai dire, ce qui me paraît fondamentalement en jeu, ce n’est pas la « démocratie participative » avec ses grands débats et ses comités de citoyens divers qui brouillent les repères déjà mal en point de la démocratie représentative. C’est la capacité ou non de sortir d’une démocratie informe en redonnant une épaisseur culturelle et historique à la politique et en renforçant les moyens d’action et l’autorité de la puissance publique. Ce sont, à mes yeux, les conditions pour permettre aux citoyens d’y voir clair et de faire des choix politiques en toute connaissance de cause.
Cela impliquerait d’exposer une vision et un projet affirmant des idées fortes, parmi lesquelles la façon dont on entend se réapproprier et faire valoir notre héritage humaniste et républicain, l’explicitation de notre conception de la souveraineté de la France au sein de l’Union européenne et la vision de son avenir possible, la façon dont on entend faire face aux bouleversements géopolitiques et aux défis de ce siècle en prenant pleinement en compte les menaces de guerre contre l’Occident…
On dira sans doute que ces questions relèvent d’une confrontation de projets des candidats à une élection présidentielle alors qu’Emmanuel Macron semble bien décidé à aller au bout de son mandat. Mais outre l’urgence du problème de la dette et du budget de 2025, sans oublier le désastre qui a ravagé Mayotte, il me semble problématique d’en rester indéfiniment à une politique gouvernementale a minima, cherchant à tout prix à éviter une nouvelle censure et à limiter les dégâts.
S’il en allait ainsi et si la politique devait continuer à afficher ses marchandages et ses combinaisons, les démagogues triompheront. Ils trancheront à leur manière les questions laissées en plan et embrouillées par des années de confusion et de tergiversations, entraînant le pays dans le chaos.
Comment expliquez-vous une telle déliquescence ? Comment en est-on arrivé là ?
Sans prétendre rendre compte de tous les facteurs qui ont entraîné une telle situation, les changements politiques et culturels me semblent décisifs. Pour le dire schématiquement, une nouvelle façon déconcertante de gouverner (qui ne date pas d’aujourd’hui) s’est développée, caractérisée par trois grands traits : la « fuite en avant », le « pouvoir informe » et la « langue caoutchouc » (La France morcelée, Folio-Gallimard).
Autrement dit, une politique centrée sur l’adaptation dans l’urgence sans vision et projet d’avenir dans un monde en plein bouleversement ; un pouvoir politique incohérent dans sa composition interne et les politiques suivies faites d’abandons et de retournements successifs sans explication claire ; un discours politique qui peut tout dire et son contraire avec un aplomb déconcertant sur le modèle de la communication médiatique. Tout cela a entretenu et développé le désarroi au sein d’une société morcelée et de plus en plus victimaire, le pouvoir politique et les institutions ne jouant plus leur rôle de repères et de référence stables, crédibles et sécurisants, indispensables à la vie en société et à l’unité du pays. Je ne crois pas que nous soyons sortis d’une telle situation.
Les repères symboliques de l’autorité – dans l’éducation des enfants et à l’école en particulier –, ont été mis à mal dans le sillage d’une révolution culturelle post-soixante-huitarde du siècle dernier avec sa part de gauchisme culturel qui a fini par imprégner les médias et la société
Il en va de même dans le champ social et culturel où les repères symboliques de l’autorité – dans l’éducation des enfants et à l’école en particulier –, ont été mis à mal dans le sillage d’une révolution culturelle post-soixante-huitarde du siècle dernier avec sa part de gauchisme culturel qui a fini par imprégner les médias et la société. Le croisement de ce gauchisme culturel avec la fascination angélique d’une partie des élites pour la libre concurrence mondialisée a produit des effets de déstabilisation et de déstructuration anthropologique et sociale.
Nous sommes arrivés à un point limite de ce basculement problématique, sans savoir sur quel type de changement, démocratique ou non, il peut déboucher. Notre pays ne manque pas de ressources, mais il importe d’être lucide sur cette fin désolante du macronisme plutôt que de continuer à croire que l’on pourrait reprendre le fil rompu d’une politique du « en même temps ».
Entretien mené par Alexandre Devecchio pour Le Figaro
Source: Le Figaro
*Jean-Pierre Le Goff est sociologue et philosophe. Il est l’auteur de nombreux ouvrages remarqués tels que «Mai 68, l’héritage impossible » (La Découverte, 1998), « La Fin du village. Une histoire française » (Gallimard, 2012), « Malaise dans la démocratie » (Stock, 2016) et « La France d’hier. Récit d’un monde adolescent, des années 1950 à Mai 68 » (Stock, 2018).

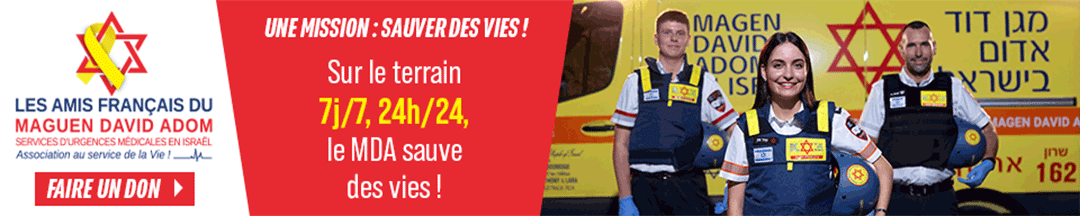
Poster un Commentaire