Une femme à écouter avec autant d’attention qu’un psychanalyste écoute son analysant

Le livre de Sonya Zadig, À corps retrouvé, troisième et dernier d’une trilogie, se prétend « roman », un cadre littéraire qui protège l’auteur en posant comme préalable que toute ressemblance avec la réalité ne pourrait être que fortuite.
Toute ressemblance avec la réalité, d’accord, mais quid de l’inconscient de l’auteur ?
L’avantage pour le lecteur, quand un « roman » est écrit par une psy, c’est que l’auteur inclut dans la forme l’explication du fond. Dans le cas de Zadig il y a un bonus poésie : « J’avais renoncé à ma terre natale, je n’avais pas d’autre possibilité; afin de réchapper à la douleur de l’exil et aux morsures de la nostalgie, j’avais enfermé toute cette histoire à double tour dans un coffret à mémoire ».
La lecture des opus précédents a lié la pathologie dont souffrait l’auteur à sa relation avec son père. D’où son exil. À la mort du paternel, elle s’est sentie libérée, mais « inlassablement insatisfaite et couramment à cran, comme si sa mort, m’ayant dépossédée de son regard insistant sur tous mes faits et gestes, s’était ressuscité tel quel en moi ».
On s’en voudrait d’appliquer de la psychologie de café du commerce à une pro de la psy, mais cette insatisfaction n’était-elle pas plutôt liée au fait que plus jamais son père ne serait en mesure d’admettre le mal qu’il lui avait fait? Notre époque se pique de remettre la psychanalyse en question.[1] Pourtant, cette méthode thérapeutique a encore de beaux jours devant elle : « L’inanalysable était mon corps, l’exil m’avait expropriée de ma langue et donc de mon corps, mon territoire intime devenait au fil du temps une terre en friche, abandonnée à tous les vents, une mélancolie entêtante était devenue dès lors ma compagne, ma partenaire de vie, j’étais opératoire, je vivais certes, mais avec déplétion, je le savais et j’avais épuisé tous les remèdes pour y échapper ». Quand on lit ces lignes, on pense à ce que David Ben Gourion, premier Premier ministre israélien identifiait comme la condition de la renaissance de son État « la force qui a rendu possible le rétablissement de notre État […], le lien spirituel profond avec la patrie antique d’Israël, avec la langue hébraïque dans laquelle est rédigé le Livre des livres ».[2]
Ce n’est pas la seule fois où Sonya Zadig, athée née musulmane, fait preuve d’une étrange proximité avec le judaïsme ou Israël : « La nostalgie d’un passé que j’avais pourtant détesté revenait sans cesse me hanter », comme il hante aussi certains de ses amis juifs originaires de Tunisie. Quand elle parle de sa nostalgie pour son passé détesté, on voit le mécanisme qui soude les enfants battus à leurs parents… et les Juifs persécutés à leurs bourreaux.
Et puisqu’on parle d’enfants malheureux, sachant que le mariage et les enfants étaient la seule destinée d’une femme en terre d’islam, Zadig « craignai(t) » de « céder sur mon désir en rejoignant le destin qui m’avait été prédit ». Elle a été surprise de constater « qu’être mère n’ensevelissait nullement la femme, mais l’augmentait ». Il est courant d’additionner ses différentes identités (privée, professionnelle, sociale…) pour construire un tout supérieur à la somme de ses composantes. Sonya Zadig, elle, a exalté même la partie maternelle de son tout ! Sa nounou, Chrifa, l’avait accueillie lorsqu’elle avait tout juste un an et « que je passais mes jours et mes nuits à hurler ma désaide et le désamour de ma mère ».
L’exemple offert par une « mère insuffisamment bonne », pour reprendre l’expression de Donald Winnicott, conduit plus souvent à l’imitation qu’à la contradiction. Zadig est tombée du bon côté du contre-exemple : « N’ayant pas reçu de recettes sur la manière d’être mère, j’ai simplement inversé en son contraire tout ce qui de l’éducation ou de la non-éducation m’a été transmis »… Jusqu’à tomber dans l’excès inverse : « En voulant enrayer le climat insécure dans lequel j’ai grandi, je les [ses enfants] ai protégés du monde jusqu’à le leur rendre cotonneux et candide ». Mais élever ses enfants avec trop d’amour, est-ce vraiment « mal les élever » ? Leur mère s’est retrouvée « exilée de la langue » par son choix de ne leur parler qu’en français, pour éviter qu’ils entendent sa langue paternelle, celle dans laquelle son père l’interpelait : « Ya Sonya ! », « Eh toi, Sonya ! ». Elle interprétait cette interjection comme une mise à distance, une mise à l’écart. Jusqu’à l’intervention d’Aldo Naouri, autre psy de classe olympique, grâce à qui la fille de l’apostat a eu une épiphanie : et si le « tu » derrière le « eh toi » avait été une injonction non pas paradoxale, mais libératrice ? « Hé TOI ! Ya Sonya, pars ! Sors de cette oumma, réussis là où j’ai échoué. Va, vis et deviens ! »[3]
Printemps arabe et retour aux sources
Le printemps arabe a ramené Sonya Zadig au pays paternel : « mes loyautés que je croyais enterrées s’exhumaient au fur et à mesure que les événements de ce que l’on avait dénommé le Printemps arabe circulaient sur les ondes ». Elle doutait quand même de son issue : l’islam étant antinomique du progrès, comment un pays musulman pourrait-il faire l’expérience de la démocratie, ce péché qui permet aux hommes de prendre des décisions réservées à Allah ? Malgré les doutes, cette « étincelle de l’histoire, ce printemps au milieu de l’hiver » avait aussi dégelé son amour pour la… patrie et lui avait fait signer un traité de paix avec elle-même. Elle voulait, par son retour, « apporter quelque chose à la Tunisie, je voulais pouvoir y retourner légitimement, car lorsqu’on quitte un pays ou quelqu’un depuis si longtemps, revenir sans raison valable friserait l’inconvenance ». Revenir, mais surtout sans en jouir, en payant une dette. Comme les dhimmis, « protégés de l’islam », soumis à un impôt spécial pour être autorisés à vivre dans l’humiliation permanente ?
Revenir, c’était aussi revivre la façon dont la société tunisienne traitait les enfants : leur rôle était d’obéir et de devenir factotum pour tous les adultes : « la soumission et la servitude s’inculquent dès le berceau».
Fille d’un couple dysfonctionnel, la petite Sonya avait à peine douze ans lorsqu’elle rasa la barbe d’Allah « pour installer à sa place celle du père de la psychanalyse ». Devenir, elle-même, psychanalyste fut un passage à l’acte.
De la révolution comme catharsis personnelle
Il n’y a pas de révolution sans violence, pas de lutte pour la justice sans injustice, pas de changement de régime sans retour du refoulé : violence, manifestations, répression… Venue à Tunis avec une équipe française pour travailler sur « les invariants psychiques de la dépression, […] essayer d’épingler à travers les entretiens avec les patients la variable culturelle afin d’améliorer nos pratiques avec la population d’origine maghrébine en France », Sonya Zadig n’était pas dupe de son jargon : « la dimension ethno-psychiatrique était à l’époque leur violon d’Ingres ».
LE VISAGE EST CE QUE LES FEMMES DOIVENT CACHER POUR EMPÊCHER LES HOMMES, CAR DANS L’ISLAM, UN HOMME ÇA NE S’EMPÊCHE PAS (CONTRAIREMENT À CE QUE PRÉCONISAIT CAMUS), CELA EMPÊCHE QU’ON LUI IMPOSE UNE TENTATION. Sonya Zadig
Le droit à la différence n’est jamais loin de la différence des droits et l’ethnopsychiatrie de l’assignation identitaire. Ce qu’elle espérait surtout découvrir, c’était ce qui poussait les femmes à servir de courroie de transmission à leur propre servitude. Et aussi : « saisiraient-elles cette embellie de l’histoire pour vider le ciel de ce dieu tyrannique ? » Les journalistes prennent le pouls d’un nouveau pays en interrogeant leur chauffeur de taxi. Le premier que Zadig rencontra réussit à la réduire au silence par « les clameurs effroyables des versets coraniques » qui l’avaient poussée à quitter son pays.
En astronomie, la révolution a le sens d’une orbite. En l’occurrence, la révolution sociale du printemps arabe s’achevait sur un hiver islamique. La philosophie est œcuménique, la preuve par Sonya Zadig citant le philosophe juif, Emmanuel Levinas, pour chercher à comprendre l’agressivité de son chauffeur de taxi… Les sociétés de la clôture sont celles qui ne posent pas de questions ouvertes. L’islam en est l’exemple type. Et Levinas son contraire : le visage, dont Levinas met en avant la fonction d’altérité, est ce que les femmes doivent cacher pour empêcher les hommes, car dans l’islam, un homme ça ne s’empêche pas (contrairement à ce que préconisait Camus), cela empêche qu’on lui impose une tentation.
Cas cliniques et clinique du cas Zadig
La présentation des cas cliniques est toujours un grand moment pour les étudiants en psychiatrie et en psychologie. Les quatre femmes présentées par « Docteur Sonya » en apportent une ample démonstration : « Warda ou le féminin fané, Latifa ou la disparition d’un corps, Feiruz ou le sacrifice de Hagar[4], Kahina : le corps mélancolique ou l’impossible perte ». La psychanalyste, elle aussi, a vécu une catharsis. Pas sur le divan, mais sur la tombe de son père, où elle a pris la décision de « vouloir vivre un exil heureux ». Être libre ! Sauf qu’en revenant du cimetière, toute à la pensée de cette liberté, elle a failli être violée par un groupe de jeunes : « Inti kahba, labssa roba zeda, nhibou nikouk yamalhat ! (T’es une pute, toi ! T’es en robe en plus, ce qu’on veut, c’est te baiser, espèce de putain !) ». Sa liberté virtuelle en danger ne survécut que grâce au hurlement qu’elle poussa, cri à la fois primal et élaboré, qui ameuta le responsable du cimetière et fit fuir ses agresseurs. À l’inverse, ses patientes lui avaient mis du baume au cœur : « Toutes ces femmes qui ont eu la générosité de me dire mezza voce « Vous avez eu raison de partir, il n’y a rien pour vous ici ! » m’ont aidée à franchir le pas et à clore définitivement le dossier nostalgie ».
Le contre-transfert a été aussi utile à la psy que le transfert à ses patientes. Mais ayant pacifié sa relation avec son pays d’origine, Sonya Zadig avait aussi compris que sa liberté réelle passait par la France, car la révolution avait accouché de l’islam, la boucle était bouclée, et les Tunisiennes continueraient à la boucler. Le diagnostic était le même pour le pays et ses habitants : « Le cœur du problème demeure l’impossibilité pour un sujet de s’individuer, puisqu’il s’agit pour tous de s’agglutiner, tel un corps relié au service de l’idole mahométane et sous la férule d’Allah ; un individu qui n’a pas veillé à faire émerger son individualité ne peut en aucun cas se soucier de préserver la démocratie. Le souci de soi et le souci de la cité sont intimement liés ».
La psychanalyse, comme l’éducation réussie, permet à l’enfant de partir
Sonya Zadig, elle, s’est détachée : « J’ai compris que je n’étais plus une déplacée, mais que je m’étais déplacée. […] J’étais venue confirmer que j’avais fui ce pays pour ne pas devenir folle, ces femmes sont une version possible de ce que j’aurais pu devenir si je n’étais pas partie ». Après le diagnostic, l’ordonnance : « Réinterroger surtout le rapport au pouvoir, aux droits des citoyens, à la liberté de conscience, il faudrait déraciner la haine du féminin qui n’est rien d’autre que la haine de l’altérité ».
Si Zadig s’y sent bien, elle mesure aussi la fragilité de son pays d’adoption, dont beaucoup d’enfants entretiennent « la haine de la France et de son honneur ».Jusque dans son foyer, elle prit « acte avec effroi de la pénétration des signifiants islamiques… Au nom de quelle tolérance avait-on voulu réduire les Français à leurs origines sociale, ethnique et religieuse ? Depuis quand parler la langue de Molière était-il devenu risible, voire « chelou » ? »
Les parents de tous les enfants français devraient être saisis du même effroi en constatant les mêmes symptômes linguistiques chez leurs enfants. Ce stigmate est exporté par les zones de non droit, qui portent mal leur nom, car « zone de non-droit ne veut rien dire, parce qu’il y a bien un droit : celui du plus fort. Un droit, une loi et même des usages ». Comme Zohra Bitan, Abnousse Shamani, Lydia Kebbab, Fathia Boudjalat et d’autres, Sonya Zadig risque son corps et sa vie à parler haut et droit. Ces femmes ont le courage de parler, car elles sont les seules à savoir par le vécu ce que préparent LFI et leurs alliés islamo-compatibles, prêts à tout pour le pouvoir. Il faut les écouter, avec autant d’attention qu’un psychanalyste écoute son analysant !
© Liliane Messika
Notes
[1] www.lexpress.fr/idees-et-debats/faut-il-en-finir-avec-la-psychanalyse-les-verites-sur-une-passion-francaise-YJ2H4S7THRFUTCFNPSHIDWXSPM/
[2] www.amazon.fr/LEtat-dIsra%C3%ABl-lavenir-peuple-Juif/dp/B0DC5LWV26/
[3] Titre d’un film de Radu Mihaileanu, racontant l’histoire d’un enfant éthiopien adopté par des Juifs au moment de l’opération Moïse (novembre 1984-janvier 1985). Hé hé !
[4] Dans la Bible, la servante de Sarah et la mère d’Ismaël.
Livres de Sonya Zadig
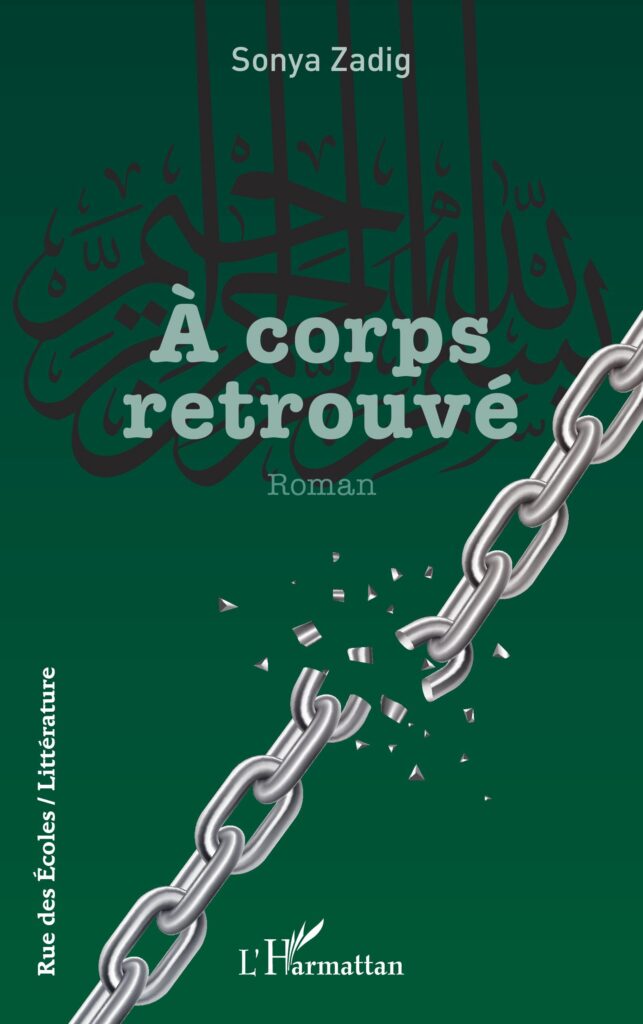

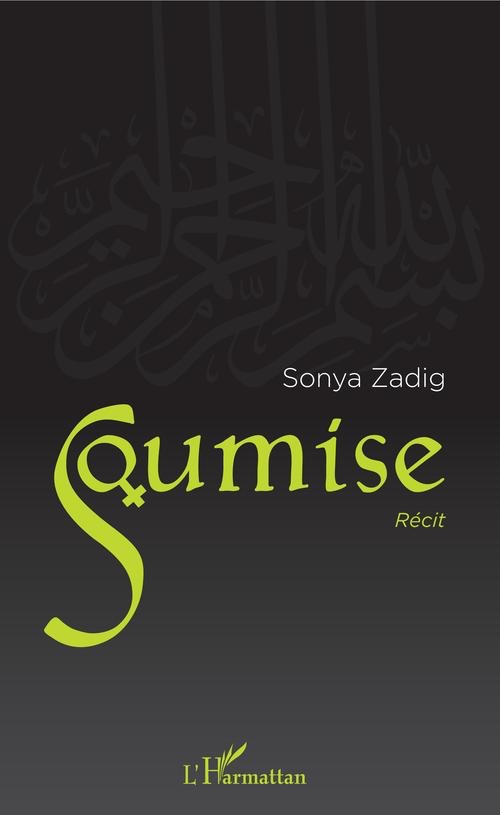


Poster un Commentaire