

Depuis le pogrom du 7 octobre 2023 en Israël, qu’il s’agisse de nos patients juifs, franco-israéliens, israéliens ou encore de certains de nos patients issus de la diversité culturelle française, qu’il s’agisse de nos proches avec qui nous échangeons dans le cadre de notre vie militante ou privée, ou encore d’un bon nombre d’invités et auditeurs intervenant sur les radios israéliennes ou françaises que nous écoutons quotidiennement, une même butée stoppe et ébranle leur réflexion sur la conjoncture. Cet achoppement revient à la question suivante :
« Que faire avec les terroristes islamistes, en Israël comme ailleurs ? »
Le défi de trouver réponse à cette question est d’autant plus grand pour l’État hébreu qu’il n’est pas beaucoup aidé, ni par les autres pays occidentaux, ni par les institutions internationales, pour pouvoir combattre efficacement l’Islamisme, cette idéologie totalitaire qui se répand à l’extérieur comme à l’intérieur du pays. Israël se trouve en effet exposé en avant-garde, insuffisamment épaulé par les nations et en responsabilité de trouver des solutions au regard de la menace terroriste islamiste.
Cette question pour l’heure sans réponse suffisamment rassurante, pour les Israéliens comme pour tous les citoyens du monde confrontés à la menace terroriste islamiste, confine dans un état d’angoisse. De fait, une violence subie sans perspective de dégagement atterre, tant lors de ses émergences meurtrières qu’entre ces émergences qui exposent à la répétition des attaques.
En période de risque vital, plus que jamais, il nous semble que le métier de psychothérapeute demande à ses adeptes, d’être des penseurs de la conjoncture, d’avoir une vision, non pas pour distiller voire proposer en place de vérité les fruits d’élaborations qui ne valent que ce qu’elles valent, mais pour faire exister dans l’espace thérapeutique, une humanité porteuse d’espoir, tandis que les patients désespérés s’en remettent à leur psychothérapie pour tenter de recouvrer des forces, une autonomie, reprendre leur vie personnelle et collective en main.
Tandis que le « plus jamais ça » depuis le 7 octobre vole en éclat, les psychothérapeutes, à l’instar de leurs patients, se trouvent rattrapés, submergés d’images, de représentations, de souvenirs personnels, familiaux et collectifs issus d’un passé de quelques décennies, de triste mémoire, réactivés. La tâche de se dégager du trauma, de la réactivation de leurs traumas passés, de cet ici et maintenant insécurisé pour secourir les patients ne leur incombe pas moins.
C’est dans cet état d’esprit que certaines paroles d’Amos Oz semblent à même d’engager la réflexion qui s’impose aux praticiens :
« Comment guérir un fanatique ? Poursuivre une bande d’intégristes armés dans les montagnes d’Afghanistan, le désert irakien ou les villes syriennes est une chose, lutter contre le fanatisme en est une autre. Je ne sais toujours pas comment attraper des extrémistes dans les montagnes ou dans le désert, ni le mode d’emploi pour les traquer sur Internet (…) Ill ne faut pas oublier qu’on ne peut presque jamais lutter contre une idée, si tordue soit-elle, à coup de matraque. »*
Ces propos d’Amos Oz donnent à penser aujourd’hui que si le pogrom du 7 octobre 2023 offre une triste occasion aux israéliens de « nettoyer la bande de Gaza », d’y éradiquer un maximum d’Islamistes avec leur appareillage offensif, que si les pays menacés par le terrorisme islamique sur la planète agissent de même, interviennent dans les secteurs bien connus où les attentats se financent et se fomentent, la sécurité des citoyens israéliens comme d’ailleurs n’en sera assurée qu’à court terme.
Yehoshua Leibowitz disait qu’il fallait abattre les Nazis comme des chiens, sur le champ, sans procès. Que faire alors des terroristes qui n’ont pas été abattus dans le feu de leurs attentats et qui se retrouvent dans les prisons d’Israël ou d’ailleurs ? Cette question ramène à l’achoppement premier : « Que faire avec les terroristes islamistes, en Israël comme ailleurs ? »
Un politicien israélien partageait ainsi son désarroi la semaine dernière sur la radio Galey Zahal : « Quand vous arrêtez un jeune arabe israélien de 17 ans à Jérusalem-Est qui porte un couteau pour tuer des Juifs et qui ne s’en cache pas, est-ce un terroriste ou un jeune à rééduquer et soigner ? » Son point complexifie encore l’affaire sachant qu’Israël, à l’instar de tous les pays confrontés aux attentats terroristes islamistes à répétition, se doit de respecter les lois de la guerre ainsi que sa Constitution.
Nous vient alors à l’esprit les fameuses « injonctions de soins » que les juges dans bien des pays imposent aux pervers sexuels, aux hommes violents avec leur femme, aux parents maltraitants, etc. Pourquoi ne pas contraindre ces jeunes et ces adultes enragés, en prison, à des séances psychothérapeutiques ?
Le souvenir des quelques patients qui nous avaient demandé un suivi psychothérapeutique pour répondre à l’injonction de soin auquel ils devaient se soumettre nous revient en mémoire. La nausée nous envahit encore quand nous repensons au parcours de leur suivi, à leur félonie, à leur manipulation manifeste se révélant en fin de travail. Leurs visages, leurs regards continuent de nous hanter quand nous y repensons.
Freud en son temps verbalisait cet écueil par ces mots : « La psychanalyse n’est pas faite pour les crapules. »
Il est un autre outil utilisé par les juges lorsque la violence perdure entre des personnes au destin indémêlable, comme celui d’un parent pathologique et de ses enfants : les visites médiatisées. Ne pourrait-on pas s’inspirer de ces espaces de rencontres entre victimes et agresseurs, animés par un (ou des) psychologue(s) dans un cadre protégé, avec comme objectif un avenir commun ?
Dans le récent film « Je verrai toujours vos visages », de Jeanne Herry (2023), une « justice réparatrice» y est défendue par une pratique de thérapie collective. L’approche thérapeutique mise en œuvre avec succès dans cette fiction nous renvoie à celle plus tangible et expérimentée, élaborée par Charles Rojzman dans certaines banlieues difficiles françaises, au Rwanda auprès des victimes et des bourreaux quelques années après le génocide, avec des Palestiniens et des Israéliens mis en présence, etc.
La thérapie sociale telle que la propose Charles Rojzman, enfant caché, survivant de la Shoah, pourrait-elle être une pratique à exploiter, en vue d’un dégagement, de ce qui semble en Israël depuis le 7 octobre et de manière internationale au regard des violences terroristes islamistes contemporaines, inextricable, violent à l’extrême, perdu d’avance ?
Si la psychanalyse n’est pas faite pour les crapules, la thérapie sociale a ceci de spécifique qu’elle permet le dégagement pour tous les participants de leur humanité endommagée, sinon enfouie et étouffée sous une part monstrueuse.
Si un projet en thérapie sociale avec des terroristes, dans les prisons israéliennes comme d’ailleurs, pouvait voir le jour, alors son objectif devrait forcément être atteignable – il s’agit là d’un principe premier à respecter en thérapie sociale : veiller à poser des objectifs atteignables -. Il devrait également répondre aux besoins et aux motivations du ou des commanditaires, tout autant qu’à ceux des participants.
Mais comment poser un objectif atteignable et répondre d’une manière ou d’une autre aux besoins et aux motivations d’ennemis qui ont juré la destruction d’Israël ou d’un État quel qu’il soit, ainsi que le remplacement sinon l’extermination de leur population ?
Pour se sortir de cette impasse, le temps est un allié précieux. Le temps d’incarcération. Les terroristes encourent de longues peines. Pourquoi ne pas concevoir une action dans la durée permettant de constituer des groupes au sein desquels une parole à visée libératrice parviendrait à circuler, se dirait petit à petit.
Pour nous, l’intervention en thérapie sociale a ceci de novateur qu’elle permet des rencontres impensables entre victimes et bourreaux. Dans le cadre de ces rencontres impensables, le bénéfice est triple : il sert aux victimes endommagées, au collectif menacé par la récidive des agresseurs tout autant qu’aux agresseurs.
Séance après séance, les victimes, pour leur part, parviennent à verbaliser, à retraverser, dans un cadre sécurisé par les intervenants en thérapie sociale, la catastrophe qui s’est abattue sur elles tandis qu’elles se trouvaient sans secours. Le processus de thérapie post-traumatique ainsi s’engage. Le psychisme des victimes, en arrêt sur image, prisonnier du trauma, commence ainsi un processus de dégagement qui enraye le lot de symptômes morbides consécutifs à l’agression, symptômes poursuivant ses dégâts si rien n’est fait, sur des générations, telles les radiations d’une bombe atomique.
Les prisonniers terroristes, pour leur part, disposent d’un temps certain, séance après séance, afin de parvenir à verbaliser comment et pourquoi ils en sont arrivés là, à commettre de telles atrocités, au nom de quels dangers à combattre, de quelles idées, de quels ordres supérieurs. Ce faisant, l’humanité sanglante, ensanglantée de leur fait, de cet autre jusqu’alors diabolisé, finit par les atteindre. Les dires, émotions, visages et regards de leurs victimes rencontrent les leurs. Une réalité commence pour eux à sortir de sa gangue d’endoctrinement, d’une idéalisation d’eux-mêmes, de cet ancrage dans la haine, la haine d’eux-mêmes fondamentalement, une haine refoulée. Le bien-fondé de leur violence aveugle chavire.
Aux plans de l’individuel et du collectif, la thérapie sociale, telle que nous la pensons là, n’est pas une justice dans le sens où elle ne cherche pas à réparer le mal ou à l’absoudre. Elle ouvre un chemin permettant à des humains de se rencontrer, de se parler, de tout se dire, jusqu’aux folies qui les habitent, jusqu’à celles commises ou subies, en vue de pouvoir guérir ce qui peut être guéri, de se transformer ensemble, dans les limites sécurisées de groupes constitués.
S’ouvre alors la possibilité d’une compréhension – compréhension ne voulant pas dire pardon ni réconciliation – de ce(ux) qui leur semblai(en)t jusqu’alors incompréhensible(s).
« Comprendre, c’est pardonner », disait Mme de Staël. « Comprendre, ce n’est pas seulement pardonner, mais finalement aimer », avançait pour sa part W. Lippmann. Moins naïfs en la matière, nous pensons qu’une compréhension mutuelle, si balbutiante soit-elle, ouvre un chemin de restauration du lien ou d’un sain divorce, c’est-à-dire, d’une acceptation que l’autre comme soi a droit à son territoire, au respect de ses besoins, de ses désirs, du droit à sa liberté jusqu’où celle de l’autre commence.
Cette proposition de thérapie sociale telle que nous la concevons et la défendons en l’occurrence, rejoint l’idée du philosophe Emmanuel Levinas : c’est la rencontre avec le visage de l’autre qui fondamentalement se trouve à même de convoquer l’humanité désinvestie, pour les besoins de la cause, d’un bourreau. Cette proposition de thérapie sociale rencontre également la proposition talmudique en matière de réparation, proposition rappelée par André Neher dans le contexte historique de l’après-guerre, dans la dramatique « négociation » entre l’Allemagne et l’État d’Israël renaissant, dans la relation entre l’Allemagne et les Juifs, toujours dans l’ombre de cet événement de l’anéantissement insensé nommé « Auschwitz » : si tu as construit ta maison en volant des poutres de la maison de ton voisin, tu te dois de les lui restituer afin qu’il répare sa maison. Mais si la restitution ne permet pas à ton voisin de reconstruire sa maison, tu te dois de déconstruire ta maison jusqu’à ses fondations afin de permettre à ton voisin d’envisager la reconstruction de la sienne.
La thérapie sociale en cela, ne semble-t-elle pas un chemin porteur au regard de l’enjeu ?
En ce qui nous concerne, en tant que praticiens, nous ne pouvons que le défendre et nous nous y engageons.
© Léa Ghidalia-Schwartz © Yves Lusson
Léa Ghidalia-Schwartz : leaghidaliaschwartz1@gmail.com
Yves Lusson: ylusson@gmail.com

***
* Amos Oz. « Chers fanatiques. Trois réflexions. ». Éditions Gallimard. 2017. Pages 13 et 39.
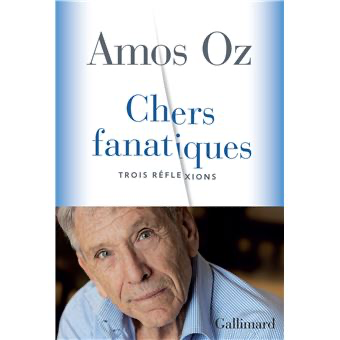


Yeoshua Leibowitz avait raison et son propos s’applique aussi aux nazis du Hamas. Il faut regarder les choses en face : la « déradicalisation » ne fonctionne et ne fonctionnera jamais.
« Une justice inspirée par la pitié porte préjudice aux victimes ».