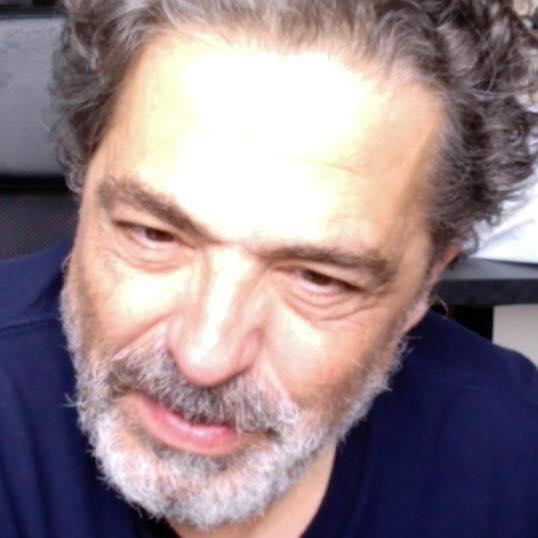
Ce furent quatre semaines intenses, douloureuses, entre effroi et espoir, abattement et colères.
Cet Israël retrouve sa nature, son authenticité, dans le malheur, dans le deuil. Je déteste l’écrire. La société civile s’est organisée dans les toutes premières heures qui ont suivi les massacres, renvoyant au 1er ministre et à son gouvernement l’image de leur faillite.
Les actions de solidarité se sont naturellement mises en place animées par des milliardaires de la tech, des militaires de hauts rangs à la retraite, quelques autorités spirituelles du pays et surtout, dans tout le pays, des centaines de milliers de bénévoles laïques ou religieux, séfarades ou ashkénazes, privilégiés ou modestes.
Ces familles en deuil que chacun se sent un devoir d’accompagner, celles dont les proches sont en otages aux mains du Hamas qu’on entoure nuit et jour pour qu’elles ne s’effondrent pas, l’accueil des dizaines de milliers d’habitants fuyant les roquettes et missiles au Sud et au Nord, le travail psychologique avec les rescapés des kibboutzim martyres, le volontariat agricole, industriel, la fourniture quotidienne de dizaines de milliers de repas aux populations dans le besoin…, encore et encore. Et cette obsession de ramener les enfants à l’école, souvent dans des classes improvisées, mais qu’importe les conditions.
Des initiatives, précises, pensées, pointues, qui couvrent tous les secteurs de la société. L’action a permis à chacun de ces volontaires -qui ont souvent un fils ou une fille à l’armée- de sortir de la sidération, remettant à plus tard l’acceptation du deuil.
Cet Israël, je le soupçonnais mais ne le connaissais pas vraiment. Même pendant la guerre du Kippour -il y a 50 ans, jour pour jour, je faisais mon alyah- je n’avais pas ressenti cette même urgence. Elle est à hauteur du traumatisme vécu ce 7 octobre.
Il y aura beaucoup à dire sur les colères, les trahisons, la perte de confiance dans les élites, les ratages sécuritaires et politiques. Bientôt, même si le mot d’ordre est la retenue des temps de guerre. Mais il n’est qu’à entendre la souffrance de beaucoup à chaque apparition de Netanyahu sur les écrans, pour comprendre l’ampleur de son discrédit et la nécessité de sa mise à l’écart. Y compris dans son propre camp.
Ce documentaire, alibi de ma présence dans cette période de doute existentiel pour le pays, s’est émancipé chaque nouvelle rencontre un peu plus. Il me précède comme un pisteur ouvrirait de nouvelles voies sur une terre tant éprouvée.
Bien des fois, j’ai cru perdre l’équilibre devant la violence des situations. Quelques fois, pleurer était la seule réaction possible face aux débordements d’amour que je percevais, mais aussi, la protection ultime face à l’horreur des témoignages.
La société israélienne, dans son essence juive ranimée, entame un chemin très douloureux vers sa reconstruction. Ce sera long, très long. Il lui faudra tomber une armure de façade, s’avouer ses faiblesses -comportementales, morales-, et surtout retrouver son unité. C’est ce chemin que je m’apprête à suivre, à capturer et à rapporter ces prochains mois.
Ce soir, je quitte cette terre pour quelques semaines, la tête en feu. Pourquoi ai-je le sentiment de déserter?
© Georges Benayoun
Producteur de cinéma et de télévision, Georges Benayoun est auteur et réalisateur de documentaires pour France Télévisions. A son actif, L’assassinat d’Ilan Halimi. France, terre d’accueil : Profs en territoires perdus de la République ? Complotisme: les alibis de la terreur , avec Rudy Reichstadt. Chronique d’un antisémitisme nouveau, en 2019.