
Le réalisateur et scénariste israélien Eran Kolirin revient dans un texte, traduit de l’hébreu par Sylvie Lidgi, sur les sentiments qui le traversent depuis le début de la guerre entre le Hamas et son pays.
Je me souviens d’une fois, quand j’hésitais entre partir ou rester, après une heure passée à peser les choses dans un coin de la cuisine (qui était alors mon chez-moi) plein de colère, de déception et de culpabilité, j’ai compris que, en fait, j’étais déjà parti. Je suppose que c’est aussi la raison pour laquelle ces derniers temps j’évite d’écrire sur les réseaux sociaux, de donner des interviews, de signer des pétitions et d’autres choses qui sont parfois demandées à celui qui est censé être « un homme d’opinion ». M’accompagne un sentiment étrange, comme si les choses s’étaient déjà produites et qu’il serait inconvenant d’ajouter quoi que ce soit au monceau d’opinions, d’interprétations qui, de toute façon, sont balancées de toute part.
Depuis un moment, la réalité dans laquelle je vis ressemble à un accident de train à petite vitesse. Longtemps, trop longtemps, des choses ont été négligées, oubliées, la colère et la sueur se sont accumulées (semblables à ces engrais déposés dans un entrepôt abandonné, jusqu’à ce qu’un jour ils détruisent une ville entière chez notre voisin du nord). Maintenant il est trop tard, le grand mouvement a déjà commencé et il ne nous reste plus qu’à le regarder.
Cependant, il se trouve que j’ai été invité à écrire quelques mots pour un magazine français et cette offre me tente. L’idée que les notes que je vais prendre sur l’épisode le plus récent et le plus diffusé du soap opéra à succès Le Moyen-Orient (un épisode qui semble actuellement être le dernier de la saison en cours, certains disent même de la série entière), seront lues tranquillement sur les rives de la Seine, devant un café et une pâtisserie, me donne le sentiment que cela a du sens en cette heure où l’âme est sombre. Plus que cela, je souhaite écrire, pour faire passer le temps, dans mon appartement de Tel Aviv entre les sirènes et l’horreur des actualités. Ce sera quelque chose que moi aussi, je pourrai balancer quelque part.
Comme la rosée du matin
En écrivant à ce destinataire imaginaire, je voudrais éviter de compter les corps, le sang, les cris, le regard déchiré des enfants, les interprétations, les évaluations, l’histoire, la cuisine locale, la douleur, les anecdotes ironiques, la réalité de la guerre, la solidarité falsifiée des temps de crise. Les bars de Tel Aviv qui persistent encore à ouvrir et les pauvres types (dont je fais partie) qui s’y réfugient, se remémorant les jours anciens de la guerre du Golfe et les missiles de leur jeunesse. Il y a déjà abondance de tout cela. Je veux éviter les imprécisions, je veux écrire quelque chose qui effacera comme la rosée du matin et fera oublier aux gens. Je veux écrire pour un magazine français. Je veux écrire sur ce ressenti.
Et ainsi se pose la question immémoriale, un élément fondamental de la profession que j’exerce (si on peut l’appeler ainsi, « occupation » serait plus approprié ?). Comment diable transmet-on ce que l’on ressent à une autre personne ? Ces dernières nuits, je me prends souvent à méditer sur les dessins qui ont été envoyés dans l’espace à bord de la sonde spatiale Pioneer. Une représentation à grands traits de ce qui apparaîtrait probablement aux habitants de notre planète comme étant un homme et une femme. Je me demande si l’extraterrestre imaginaire qui ouvrira quelque part les portes de la sonde spatiale réussira à comprendre que ces formes gravées sur la petite plaque dorée sont des êtres vivants, ou si, même en cette rare occasion, tout en tendant la main vers l’infini, nous, la race arrogante que nous sommes, avons réussi à nous présenter tels que nous nous voyons, et non comme les autres nous voient.
Les signes dans la langue
Je me retrouve aussi à réfléchir à l’histoire étrange de l’informaticien Armin Meiwes ou au cannibale de Rothenburg, qui a fait venir chez lui le 9 mars 2001 un certain Jürgen Armando Brandes, pour les besoins d’un acte étonnant de cannibalisme mutuel au cours duquel Jürgen a été mangé par Meiwes. Maintenant, alors que, pour écrire cet article, je relis ce que dit Wikipédia sur cette affaire, je suis surpris de découvrir qu’après que les deux aient savouré le pénis grillé de Jürgen, Armin s’est retiré dans sa chambre et a lu un chapitre d’un livre de la série Star Trek sur les aventures spatiales du vaisseau USS Enterprise qui, comme on s’en souvient, se dirige vers « un endroit où aucun homme n’a jamais mis les pieds auparavant« .
Selon Wikipédia, le cannibalisme a existé tout au long de l’histoire, à différentes époques, depuis que l’Homme existe. Je doute de cette affirmation. Il me semble que le besoin de manger et d’être mangé les uns par les autres est un désir profond, une aspiration vers l’avenir, qui, comme d’autres fantasmes violents, trouve ses racines dans un passé glorieux mais complètement imaginaire d’un « autre » indéfini. Dans tous les cas, ô combien cultivée, réfléchie et noble, semble maintenant l’histoire de Jürgen et Meiwes par rapport aux flots de sang qui nous entourent.
En temps de crise, les locuteurs hébraïsants commencent à identifier des signes dans leur antique langue. Mon flux d’actualités sur les réseaux sociaux est plein de jeux de mots, d’indices bibliques, de significations cachées. C’est un jeu courant parmi les locuteurs de langues sémitiques. Quelque chose dans la structure de la langue permet des jeux infinis de significations, d’indices et de variations. Je me souviens de la lettre de Gershom Scholem, le célèbre chercheur de la Kabbale, à Franz Rosenzweig, dans laquelle il exprime sa préoccupation quant à la « sécularisation » de la langue hébraïque et sa transformation d’une langue sacrée en une langue de tous les jours. « Quel sera le résultat de la contemporanéité de l’hébreu ? » écrit Scholem. « Les gens ici ne connaissent pas la signification de leurs actions. Ils pensent qu’ils ont transformé l’hébreu en une langue profane. Qu’ils ont retiré sa barbe apocalyptique. Mais ce n’est pas la vérité ».
Pour personne
Il existe un mot en hébreu « hefker« , qui incarne parfaitement mon sentiment face aux événements récents. La racine de ce mot peut renvoyer à un large éventail de significations. C’est quelque chose qui n’a pas de propriétaire, quelque chose de négligé, qui ne connaît pas les bonnes manières, qui est abandonné, c’est le chaos, l’effraction, le rejet de l’autorité, le comportement immoral, le manque de limites, la pauvreté et bien d’autres sens de la même veine. Sa traduction en anglais sur Google est « To no man » (pour personne, pour aucun homme). Mais pour le comprendre, il faut prononcer le mot à voix haute.
Je voudrais inviter le lecteur (sur les rives de la Seine) à prononcer ce mot. À le sentir sur la langue. HEFKER commence par la lettre H qui est une expiration, un souffle, puis l’expiration se rétrécit vers le F, qui ressemble au geste de dédain si cher aux francophones. L’air continue et s’arrête puis la gorge est coincée, serrée, puis frappée par le rude K, presque comme un vomissement, et tout se termine par un R long comme un râle qui ressemble au cri des animaux abattus.
***
© Eran Kolirin
Texte traduit de l’hébreu par Sylvie Lidgi
Source: https://www.marianne.net/agora/humeurs
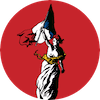


Délire d’un vieux gauchiste israélien agonisant qui n’a pas encore réalisé que la gauche française a épousé l’islam comme en 40 la gauche pacifiste a voté pour la Collaboration avec les nazis .