Dans un texte très personnel, Gilles Kepel part de sa découverte de La Lenteur, premier roman français de Milan Kundera, pour évoquer ce que cet auteur a représenté pour lui. Entre le XVIIIe siècle français et la Tchécoslovaquie travaillée par le XXe siècle, c’est une lecture intime qui se déploie, ouvrant des perspectives souterraines de l’Europe contemporaine.
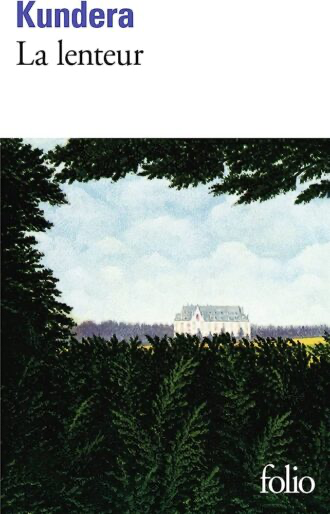
La Lenteur, premier roman de Milan Kundera écrit directement en français, paru en 1995, m’a fait découvrir à la fois l’œuvre de l’auteur et ce qu’il y avait en moi de tchèque – que je tenais jusqu’alors comme anecdotique voire insignifiant. Son nom était honni au domicile familial de Milan Kepel [Kepl], mon père : il n’y avait pas place pour deux Tchèques, portant le même prénom et partageant l’initiale du patronyme, dans le marigot littéraire parisien de la fin du vingtième siècle. Le premier avait pris toute la lumière, le second était demeuré dans la pénombre, et considérait comme indue, voire fabriquée, la gloire de l’autre Milan K. On ne le lisait donc pas à la maison. Son style avait été une fois pour toutes classé comme médiocre, et ses succès attribués exclusivement à ses capacités de séducteur slave impénitent (un domaine où pourtant mon père tenait son rang dignement). Mais il était fait grief à « l’autre » d’utiliser la séduction pour arriver, et de trahir ainsi cette identité sexuelle tchèque mêlant compersion et sombreur (voir ci-dessous) dans laquelle s’empêtre l’âme slave. « Il a baisé toutes les bonnes femmes de Gallimard ! » — clamait mon géniteur pour solde de tous comptes lorsque son paronyme publiait un énième roman qui faisait la Une des mass media. Lui-même avait pourtant été accueilli dans la collection théâtrale de cet éditeur, pour ses traductions des pièces de Vaclav Havel, mais celles-ci n’avaient connu qu’un succès d’estime.
En 1995, j’avais quarante ans, et ma carrière d’arabisant m’avait permis de prendre quelque distance avec l’univers atavique paternel – d’autant que celui-ci n’avait guère compris ni apprécié mes choix professionnels. « On peut laisser la voiture ouverte, il n’y a pas d’Arabes ici », m’avait-il confié avec un profond soupir lors d’un voyage à Prague destiné à tenter de raviver mon identité ancestrale, peu après la chute du communisme. J’avais pourtant lu en cachette L’insoutenable légèreté de l’être, et repéré la fenêtre de la petite maison qui donne sur le pont de pierre, commençant ainsi à découvrir timidement une Prague qui pourrait un jour être mienne, hors du filtre paternel. Mais ma vie était ailleurs…
J’ai dû lire La Lenteur au tournant de la cinquantaine, quelques années après la parution. J’étais déjà aficionado de l’œuvre de Dominique Vivant Denon, éblouissant personnage romanesque, traversant deux siècles de Louis XV à la Restauration, âme intellectuelle de l’Expédition d’Égypte, directeur du Louvre, dessinateur exceptionnel et auteur discret du chef d’œuvre absolu Point de Lendemain, longue nouvelle ou bref roman, publié sous pseudonyme et destiné à la délectation du cercle de ses amis libertins – il ne lui serait attribué que bien après sa mort. Surtout, à mes yeux, Vivant Denon constitue la pierre sur laquelle fut bâti l’orientalisme français, dont je me réclame en modeste continuateur – quel que soit l’opprobre dont ce terme a été couvert depuis la parution du livre homonyme d’Edward Saïd, voire en réaction délibéré aux effets induits et dévastateurs de celui-ci. Or La lenteurconstitue une variation sur le thème de Point de lendemain, qui lui sert de prétexte et de métatexte.
Milan et Vera Kundera se rendent en automobile dans le Relais et Châteaux qu’est devenu le manoir où la comtesse de T. s’offrit pour une nuit d’amour « sans lendemain » au chevalier, afin qu’il donne le change au mari par substitution au véritable amant de celle-ci, le marquis. Dans une veine très « kunderienne », la disneylandisation « fast » de l’Europe occidentale y est brocardée, mais les scènes comiques qui se déroulent dans l’hôtel — à l’occasion d’un congrès international d’entomologistes auquel participe un savant tchèque, tout juste rétabli dans ses fonctions après vingt ans de réduction à la condition ouvrière pour soupçon de dissidence – constituent l’écho déconstruit puis recomposé de la partition de Vivant Denon. Là où le grand styliste de la dernière décennie de l’ancien régime décrit d’une plume toute en subtilité un tableau de mœurs de l’aristocratie dix ans avant le cataclysme révolutionnaire, le rescapé du socialisme réel ironise d’un ton grinçant sur le déclin culturel occidental – au regard d’un critère de perfection romanesque incarné par le XVIIIème siècle français. Dans le texte, Kundera consacre Les Liaisons dangereuses et La philosophie dans le boudoir comme chefs d’œuvre absolus de la littérature – et il est tout sauf innocent que le romancier choisisse de démarquer Point de lendemain pour entrer de plain-pied dans la littérature française en s’appropriant cette langue-ci (il réécrira en français par la suite ses livres tchèques précédents, donnant aux deux textes « même valeur de langue originale »). Le défi est d’ampleur : je ne suis pas convaincu que l’exercice soit réussi formellement – la critique a déploré la sécheresse, voir la « blancheur » d’un texte caractéristique du « roman essayistique », comme on a qualifié la manière de Kundera. Et ses apophtegmes marqués au coin du bon sens des années 1990 paraissent datés au lecteur de 2023 (j’ai relu La lenteurau soir du 12 juillet, le jour de sa disparition, étant sollicité pour lui rendre hommage le lendemain dans la matinale de Radio Classique).
Mais le comment n’est pas l’objet : je me suis demandé pourquoiKundera avait choisi de s’arrimer à Denon, Laclos et Sade pour son entrée de plein exercice dans le roman français. Ma réponse est subjective. Je l’ai déployée durant les dix ans de gestation qui ont abouti en automne 2022 à mon Enfant de Bohême, sans toutefois l’expliciter jusqu’alors. Comme ce texte accompagnant la fin de vie de mon père mais ne pouvait paraître qu’après sa mort (mars 2019), la disparition de l’autre Milan (tous deux communièrent dans cette mort lente qu’est la maladie d’Alzheimer, partageant ce destin funeste au crépuscule de leur existence) me révèle brusquement un processus qui taraude ce livre. J’ai mentionné plus haut que La lenteur m’avait fait découvrir avec stupéfaction comment le non-locuteur tchèque que je suis, qui n’avait qu’une connaissance superficielle (voire un rejet motivé par la volonté d’émancipation de la figure paternelle) du monde slave – jusqu’à ce que je m’y immerge pour rédiger Enfant de Bohême à partir de 2012 – se trouvait en réalité profondément imbibé, par le subtil jeu des gamètes ou d’autres procédés biologiques que je ne peux que supputer, par ce qu’on nommera d’une métaphore convenue « l’âme slave ». De même que l’expriment les auteurs libertins français précités – pour lesquels je nourrissais une passion que je ne pouvais m’expliquer – les Slaves que furent mon aïeul Rodolphe (Rudolf) et son fils Milan construisirent leur vie sentimentale, ainsi que me l’a manifesté le dépouillement des centaines de lettres que j’ai fait traduire du tchèque, couvrant la période 1904-1954, autour de la compersion et de la sombreur.
Le premier de ces termes, que surligne de rouge le correcteur et qui n’appartient qu’au vocabulaire de la psychologie (c’est un artefact langagier d’origine américaine, point encore naturalisé français, même s’il en a l’apparence), signifie « prendre plaisir au plaisir de votre partenaire, quelle qu’en soit la source », et fonctionne a minima comme antonyme de « jalousie ». Il est à la racine de la littérature libertine française, et traverse de part en part la correspondance de mon aïeul comme la prose de Kundera, tant dans la période « tchèque » première, que dans La lenteur, en écho à Point de Lendemain. Quant à la « sombreur », c’est l’un des nombreux synonymes de la mélancolie, archétype, voire topos de « l’âme slave » (avec l’auto-dérision, qui la complète), auquel j’ai eu recours pour éviter de doublonner infiniment ce terme lorsque j’ai rédigé Enfant de Bohême. Car le refus de la jalousie n’est socialement vivable, sauf à n’être plus qu’un rouage fonctionnel dans la machinerie du libertinage – dont Kundera explore longuement les définitions et l’étendue dans son roman – qu’en articulation avec la mélancolie.
Est-ce cela qui a bloqué sur eux-mêmes les Tchèques, peuple du cœur même de l’Europe, inhibant leur expansion culturelle, la laissant introvertie ? Fût-ce leur psychique traduction d’un mécanisme de défense face aux Empires qui les encerclaient, abandonnant la politique à Vienne, Berlin ou Moscou, et construisant dans les chalupa (datchas) des environs boisés de Prague cette même socialité libertine que l’on pratiquait dans les « petites maisons » du XVIIIème siècle français ? Je ne sais – n’étant ni slavisant, ni critique littéraire. Mais telle a été ma révélation intuitive, lisant Kundera, puis découvrant les traductions de la correspondance familiale.
De cette « navrance » tchèque envers la France, qui fut la grande soeur tant adulée de la Première république tchécoslovaque en 1918, où le français était une seconde langue couramment parlée, la trahison de Munich constitua l’aboutissement (j’en ai raconté l’expression par mon père, faisant le coup de poing à l’âge de dix ans contre les potaches français au lycée Montaigne aux lendemains du retour de Daladier à Paris). Le nazisme, le communisme, l’américanisation, ont achevé ce processus de quasi-anéantissement de la relation culturelle franco-tchèque, en dépit des efforts louables des tchéquisants et francisants de chaque pays, qui jettent les passerelles et réparent contre vents et marées les ponts effondrés… Mais il y a Milan Kundera : et quelle plus grande osmose entre la France et la Bohême que cet écrivain tchèque devenu l’un de nos plus fameux romanciers – balayant symboliquement le legs honteux de Munich, à sa façon. J’espère en avoir convaincu, à titre posthume, mon père, en rendant justice, à ma façon filiale, à l’autre Milan K parisien.
© Gilles Kepel
Na shledano, Milanku !
https://legrandcontinent.eu/fr/2023/07/14/adieu-milan/



BIEN !
On est toujours preneurs pour la prose de Gilles Keppel.
Qui d’ailleurs, non déplaise aux médisants, n’est PAS juif…
Sachant qu’un polyglotte de cet acabit ayant des racines plantées en Bohème slave (dite désormais « République Tchèque »), historiquement et culturellement coincée entre l’empire russe et les empires germanisants (l’austro-hongrois et l’allemand) ne peut tout simplement pas totalement ignorer le Yiddish.
Il s’en amuse d’ailleurs, balançant parfois, à des publics sélectionnés, des bribes de phrases en Yiddish histoire de brouiller la piste.
On connaissait l’arabisant et l’islamologue ; on connait désormais le nostalgique de sa terre ancestrale qu’il n’a pas vraiment connu et on comprend sa proximité avec la double (multiple) allégeance de Kundera.
Cela s’appelle un Européen…