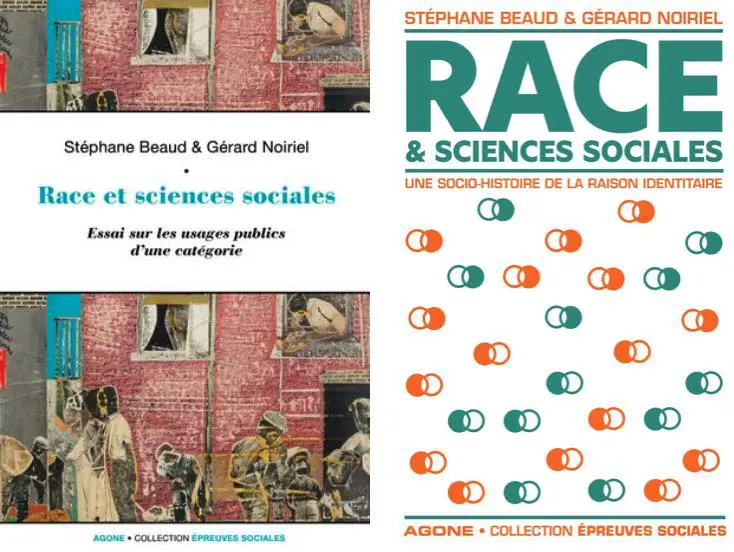
J’ai centré le troisième volet de mes blogs concernant « les médias sociaux, le journalisme et la crise des sciences sociales » sur la virulente campagne médiatique, alimentée par les réseaux sociaux et relayée par un certain nombre d’universitaires, dont notre livre « Race et sciences sociales » a fait l’objet. Cette polémique est une nouvelle preuve, à mes yeux, que dans un espace public dominé par les médias sociaux, le fait même de défendre l’idéal des grands intellectuels de l’époque précédente est devenu obsolète, incompréhensible même.
Étant donné que, dans la conclusion de notre ouvrage avec Stéphane Beaud, nous avons insisté sur le rôle que joue la racialisation du discours public dans l’affaiblissement des luttes collectives, c’est surtout ce point qui a mis le feu aux poudres. Parmi celles et ceux qui se sont lancés dans cette campagne de dénigrement, beaucoup font partie de la nouvelle génération des intellectuels intermédiaires issus de l’immigration post-coloniale. Une analyse sérieuse de leurs arguments aurait exigé une étude sociologique approfondie, qu’il ne m’était pas possible de développer dans ce blog.
J’ai donc préféré me concentrer sur les réactions que cet ouvrage a suscitées dans le monde académique en privilégiant la critique que Didier Fassin a publiée en février 2021 dans la revue en ligne AOC. J’ai choisi cet exemple pour deux raisons. La première tient au fait que Didier Fassin, professeur à Princeton et aujourd’hui au Collège de France, a une très grande légitimité dans le champ universitaire, ce qui donne beaucoup de poids à ses écrits. Sa critique, publiée un mois après la sortie de notre livre, a fortement orienté sa réception dans notre milieu, comme on le verra. La seconde raison tient au fait que Didier Fassin occupe aujourd’hui une position d’intellectuel critique comparable à celle de Michel Foucault (dont il se réclame souvent) dans les années 1970-1980. Pour mieux comprendre ce que notre nouvel espace public a changé dans le débat entre universitaires, j’ai donc choisi de comparer la manière dont Foucault concevait la discussion savante avec celle que Didier Fassin a mise en œuvre dans son compte rendu de notre livre.
Dans mon avant-dernier blog, j’ai rappelé l’importance qu’avait eue l’article de Foucault, intitulé « Polémique, politique et problématisations » dans l’éthique professionnelle à laquelle je suis resté fidèle jusqu’à aujourd’hui. Dans ce texte, Foucault insistait sur l’autonomie de la réflexion savante en disant : « Je n’ai jamais cherché à analyser quoi que ce soit du point de vue de la politique ; mais toujours à interroger la politique sur ce qu’elle avait à dire des problèmes auxquels elle était confrontée ». C’est ce principe d’autonomie qu’il invoquait pour distinguer le polémiste et le savant. Pour ce dernier, précisait-il, « questions et réponses relèvent d’un jeu – d’un jeu à la fois plaisant et difficile – où chacun des deux partenaires s’applique à n’user que des droits qui lui sont donnés par l’autre, et par la forme acceptée du dialogue ».
Les critiques qu’avec Stéphane Beaud nous avons développées dans notre livre s’inscrivaient dans cette perspective du « jeu plaisant et difficile » entre des partenaires qui n’outrepassent pas les « droits qui lui sont donnés par l’autre ». Voilà pourquoi nous avions tenu à mentionner à la fois nos points d’accord et de désaccord avec Didier Fassin. Malheureusement, et c’est un signe des temps, cette discussion critique a été reçue comme une sorte de mise en cause « personnelle » de l’éminent Professeur. Circonstance aggravante, le fait que Didier Fassin ait longtemps dirigé le centre de recherche dont je fais encore partie a été perçu comme une forme de « trahison ».
Pour tenter d’éviter ce type d’interprétations, il aurait sans doute fallu que j’insiste davantage sur les relations cordiales que j’ai entretenues avec Didier Fassin lorsqu’il dirigeait l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux (IRIS-EHESS). Sa capacité à assumer des responsabilités administratives et scientifiques très prenantes tout en poursuivant des recherches internationalement reconnues a toujours fait mon admiration, étant donné mon profil d’enseignant-chercheur plutôt solitaire, ayant fui comme la peste toutes les formes de pouvoir.
Mais tout cela n’avait aucun rapport direct avec les sujets abordés dans la dizaine de pages qui concernent, dans notre livre, les analyses de Didier Fassin sur la question raciale. Ceci d’autant moins que ma divergence fondamentale avec lui ne porte pas sur cette question mais sur la façon de concevoir les rapports entre le savant et le politique.
La nécessité de renforcer l’autonomie de la réflexion savante face aux polémiques médiatiques sur le racisme, plusieurs fois rappelée dans notre ouvrage, est d’emblée écartée d’un revers de main par Didier Fassin dans son compte rendu. Il considère que la parution de quelques extraits du livre dans Le Monde diplomatique est la preuve que nous-mêmes nous ne respectons pas la séparation du savant et du politique. La contradiction est d’autant plus flagrante à ses yeux que la publication de ces « bonnes feuilles » a « permis une spectaculaire réception, plus médiatique que scientifique » de notre ouvrage. « La chose n’est pas sans ironie, ajoute Didier Fassin en parlant de nous, tant ils ne cessent de répéter, invoquant Durkheim, Weber et Bourdieu, dont on peut pourtant dire qu’ils ont été meilleurs à énoncer la séparation du savant et du politique qu’à la respecter eux-mêmes, qu’ils veulent défendre l’idée d’une “science de la société se tenant à distance des enjeux politiques et des polémiques médiatiques”. Loin de cet idéal, mais sans surprise, c’est dans les cercles déjà très investis dans le dénigrement de ce qu’on y nomme “politiques identitaires” que les approbations de leur prise de position se font le plus chaleureuses et unanimes ».
La confusion du savant et du politique conduit Didier Fassin à ignorer qu’il existe une différence radicale entre la production du savoir scientifique et sa réception. Que nos recherches puissent avoir des effets publics, qu’elles soient utilisées par les uns ou par les autres à l’appui des causes qu’ils défendent, relève de l’évidence. C’est malheureusement l’un des problèmes majeurs auxquels sont exposés les chercheurs en sciences sociales. Il est vrai que les intellectuels qui ont plaidé pour défendre l’autonomie de la science, comme Émile Durkheim, Marc Bloch, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Jacques Bouveresse et bien d’autres n’ont pas toujours respecté cet idéal. Mais au lieu d’en tirer argument pour l’invalider, un intellectuel responsable devrait s’interroger sur les raisons qui expliquent ces contradictions.
Prendre au sérieux cette revendication d’autonomie de la science a au moins pour avantage que cela permet de ne pas confondre la polémique et la discussion savante, comme le fait constamment Didier Fassin dans sa critique de notre livre. Dans le texte mentionné plus haut, Michel Foucault avait clairement montré ce qui caractérisait le polémiste. Ce dernier, écrivait-il, « s’avance bardé de privilèges qu’il détient d’avance et que jamais il n’accepte de remettre en question. Il possède, par principe, les droits qui l’autorisent à la guerre et qui font de cette lutte une entreprise juste. Il n’a pas en face de lui un partenaire dans la recherche de la vérité mais un adversaire, un ennemi qui a tort, qui est nuisible et dont l’existence même constitue une menace ».
On retrouve dans le texte publié dans AOC par Didier Fassin la combinaison des trois modèles que Foucault avait distingués pour caractériser le discours polémique : le modèle politique, le modèle judiciaire et le modèle religieux.
Le modèle politique
Le registre polémique qui occupe le plus de place dans l’article de Didier Fassin relève du modèle politique. Il apparaît d’emblée dans le titre de son article, « Un vent de réaction souffle sur la vie intellectuelle ». Les droits qui l’autorisent « à nous faire la guerre » et « qui font de sa lutte une entreprise juste » sont justifiés par la combinaison des deux formes de discrédit que Jacques Bouveresse avait déjà pointées chez les philosophes althussériens quand il disait que leur philosophie « fonctionnait sur le mode terroriste de l’évidence qui ne se discute pas, sauf si l’on est un idiot ou un réactionnaire » ( « Dialogue sur la ‘grippe intellectuelle française' »).
Réactionnaires
Pour introduire la charge visant à nous présenter comme des « réactionnaires », Didier Fassin commence son propos par des considérations générales, qu’il appelle « le contexte ». Il s’agit là du procédé classique dans ce genre de polémiques, que les sociologues appellent la « montée en généralité ». Le fait d’avoir osé critiquer Didier Fassin pose un problème politique très grave, qui concerne tous les citoyens de ce pays et dont l’importance est soulignée par le titre de l’article. La thèse du « vent réactionnaire » est illustrée par des exemples puisés dans la rhétorique des intellectuels de droite, d’extrême-droite et d’une partie de la gauche concernant le « wokisme », la « pensée décoloniale », les « islamo-gauchistes » (insulte que j’ai moi-même subie), la vision caricaturale des États-Unis, etc. Ce que les lecteurs d’AOC ne sauront pas, sauf s’ils lisent notre livre, c’est que nous consacrons tout un chapitre pour critiquer ces discours conservateurs en montrant que, contrairement à ce que dit Didier Fassin, ils ne sont pas apparus il y une vingtaine d’années mais dès les années 1980.
Cette montée en généralité que Fassin appelle « le contexte » est la première étape dans la rhétorique visant à faire croire aux lecteurs que nous aurions rejoint le camp ennemi, celui des réactionnaires qu’il faut combattre pied à pied. Le lien explicite établi entre le préambule concernant « le vent de réaction soufflant sur la vie intellectuelle française » et les arguments de notre livre apparaît dans le passage où Didier Fassin souligne, en parlant de Stéphane Beaud et de moi, « la similarité de la cible de leur charge avec celle des attaques menées depuis plusieurs mois par des membres du gouvernement ». Les preuves de cette complicité objective consistent dans des morceaux de phrases mis entre guillemets, des découpages de citations détachées de leur contexte et sans nom d’auteur, afin de créer un effet d’accumulation et amalgamer des arguments différents, voire parfois contradictoires.
Pour donner un exemple précis de ce type de procédé polémique, je prendrai le passage concernant « le filon du genre ». Le 11 juin 2020, le président de la République a critiqué « l’ethnicisation de la question sociale », dans laquelle « le monde universitaire » aurait vu « un bon filon », au risque d’un « débouché sécessionniste » qui « revient à casser la République en deux ». Didier Fassin rapproche ces propos de l’expression « filon du genre » qui apparaît dans une page de notre livre (p. 239). Le fait que ce terme soit « le même que celui utilisé par le chef de l’État » est pour Didier Fassin la preuve irréfutable de ce qu’il nomme « une alliance objective entre gens de pouvoir et gens de savoir ».
Sauf qu’en reprenant à son compte les procédés que Michel Foucault reprochait aux polémistes de son temps – consistant notamment à isoler quelques mots d’une phrase séparée de son contexte –, Didier Fassin nous fait dire le contraire de ce que nous avons écrit. Ce passage renvoie en effet au problème que j’évoquais dans mon précédent mail concernant la « commercialisation des bonnes causes ». Il vise explicitement le business model que Pascal Blanchard et ses amis ont développé en multipliant les ouvrages richement illustrés sur des thèmes en rapport avec l’histoire coloniale. L’expression « filon du genre » renvoie au livre Sexe, race et colonie (La Découverte, 2018), dans lequel sont exhibés des corps de femmes africaines sous prétexte de dénoncer l’oppression coloniale. Le « filon du genre » a été pointé par des féministes d’origine africaine déplorant l’usage commercial des photos de leurs mères et de leurs grand-mères – lire le texte collectif paru sur le site Cases rebelles. Étant donné que Didier Fassin fait « l’éloge de la complexité » dans son article, on aurait aimé qu’il la mette en œuvre en nous expliquant qui, dans cette affaire, est « progressiste » et qui est « réactionnaire ».
On aurait aussi apprécié que, dans son texte, le mot « réactionnaire » serve à qualifier des pratiques, des activités, des engagements militants et pas simplement des discours. Ce qui aurait permis de clarifier ce qu’il faut entendre par « l’alliance objective entre gens de pouvoir et gens de savoir ». Ni Stéphane Beaud ni moi n’avons rejoint les cercles du pouvoir macronien, à la différence de ceux que Didier Fassin considérait dans le livre De la question sociale à la question raciale comme des « gens de savoir », mobilisés contre les « réactionnaires » parce qu’ils se présentaient comme les porte-parole de la cause des Noirs de France (Pap Ndiaye) ou parce qu’ils critiquaient la « fracture coloniale » (Pascal Blanchard). Le premier a été nommé par Emmanuel Macron ministre de l’Éducation nationale et le second a été chargé par le même président d’une mission officielle pour changer le nom de nos rues. On comprend que ces « gens de savoir » n’aient jamais vu l’intérêt d’une réflexion sur l’autonomie de la science !
À l’heure des médias sociaux, pour qu’une polémique mobilisant la rhétorique guerrière soit vraiment efficace, il faut absolument qu’elle condamne l’ennemi au nom des valeurs morales que défendent, au péril de leur plume, les vrais progressistes. Didier Fassin utilise cette arme contre nous en détectant ce qu’il appelle « un signe troublant ». Selon lui, notre livre « se termine par une critique du plus important mouvement social des dix dernières années aux États-Unis, Black Lives Matter, né de la dénonciation des homicides d’Afro-américains par la police, que nos collègues réduisent ici à une forme de nationalisme noir qui empêcherait l’émancipation des groupes dominés. Adopter cette lecture racialiste d’une mobilisation démocratique qui a inclus des personnes de toutes les couleurs et de tous les milieux sociaux, c’est négliger le rôle décisif que cette dernière a joué dans les élections présidentielles et législatives de 2020 en luttant contre les efforts pour empêcher les Noirs de voter ».
Là encore, ce qui me paraît très « troublant » dans les propos de Didier Fassin, c’est la manière dont il retraduit dans son langage guerrier le passage du livre où nous évoquons le mouvement Black Lives Matter. Une fois de plus, la fureur du polémiste l’emporte sur la lucidité de l’analyste. Ce que Didier Fassin oublie de préciser, et pour cause, c’est qu’il s’agit ici d’une citation empruntée à l’un des plus grands spécialistes de philosophie politique aux États-Unis – spécialiste que Didier Fassin connaît bien puisqu’il s’agit de Michael Walzer qui a été son collègue à l’Institute for Advanced Study (collègue que j’ai moi-même côtoyé l’année de mon passage dans cet institut).
Michael Walzer évoque en effet le mouvement Black Lives Matter pour revenir sur une histoire qu’il a beaucoup étudiée, mais qu’il a aussi vécue en tant que militant antiraciste depuis plus d’un demi-siècle. C’est lui qui utilise l’expression de « nationalisme noir » pour expliquer les raisons de l’échec du mouvement antiraciste afro-américain. À ses yeux, si le racisme reste un problème central aux États-Unis, c’est parce que les « politiques de l’identité » ont pris le dessus dans la vie publique américaine conduisant au développement des mouvements séparés : les Noirs, les Hispaniques, les femmes, les gays, etc. Déplorant l’absence de solidarité entre ces différentes formes de lutte pour la reconnaissance, il estime que cela pose la question essentielle des alliances politiques à nouer dans le camp des forces progressistes. Si nous avons cité ce passage, ce n’est pas pour nous mêler de la vie politique américaine mais pour informer les lecteurs de la diversité des points de vue qui existent aujourd’hui dans ce pays sur la « question raciale ». Toutefois, sur le plan méthodologique, nous pensons, comme Michael Walzer, qu’il n’existe pas de cause sacrée qui devrait être mise à l’abri de la discussion scientifique. Cela n’empêche pas, bien évidemment, qu’on puisse en tant que citoyens, soutenir une lutte sociale – j’ai moi-même souvent pratiqué ce double jeu en ce qui concerne le mouvement ouvrier.
Pour conclure sur les efforts qu’a déployés Didier Fassin dans son article afin de convaincre les lecteurs que notre livre alimentait « le vent de réaction qui souffle sur la France », je signalerai aussi le rôle central qu’occupe dans son texte le vocabulaire de la guerre, illustré par la fréquence des mots qui présentent nos critiques comme des « charges », des « attaques », de la « disqualification », du « dénigrement ».
Les idiots du village
Didier Fassin ayant « démontré » que nous sommes devenus des réactionnaires, il peut s’employer ensuite à nous présenter comme des idiots. Sauf que, dans le langage euphémisé des grands intellectuels, ce n’est pas ce terme qu’on emploie car il existe une grande panoplie d’autres mots qui convergent généralement pour dénoncer l’incompétence des adversaires.
Cette forme de discrédit apparaît surtout dans le passage où Didier Fassin s’efforce de réfuter nos critiques du livre De la question sociale à la question raciale, qu’il a dirigé avec Éric Fassin. Nous aurions commis un « contresens regrettable » parce que nous n’aurions pas compris que, dans leur introduction, les deux directeurs de cet ouvrage collectif « proposaient un renversement qui [nous] a échappé et qui est pourtant crucial ». Partis pour montrer que la « question sociale » était une « question raciale », les émeutes de 2005 les ont convaincus tous les deux que « la question sociale était aussi une question raciale ». L’autre argument que développe Didier Fassin pour souligner notre incompétence, c’est de ne pas avoir compris que, dans leur conclusion, les deux directeurs de la publication avaient déployé « la double dimension de l’injustice », à savoir « l’inégalité sociale et la domination culturelle ». Cette double dimension impliquant, selon eux, une double politique de redistribution et de reconnaissance. Et Didier Fassin ajoute : « Il s’agissait, insistions-nous, de passer de la politique identitaire à la politique minoritaire ».
Au lieu de répondre précisément à nos critiques, Didier Fassin a préféré, une fois de plus, se placer sur le terrain polémique de l’intellectuel « bardé de privilèges qu’il détient d’avance et que jamais il n’accepte de remettre en question », comme disait Foucault… Plutôt que de poursuivre éternellement le petit jeu visant à dénoncer les incompétences de l’autre, je dirai que mes divergences avec Didier et Éric Fassin s’expliquent par des approches des questions du racisme et des discriminations qui peuvent se recouper sur certains points mais qui sont radicalement différentes. Toute leur analyse repose sur la problématique des « représentations », comme le montre le sous-titre du livre collectif qu’ils ont dirigé, « Représenter la société française » ; et aussi leurs propos sur les « minorités visibles », sur le « color blindness« , etc. Alors que mes travaux sur ces questions mettent en œuvre la problématique de la violence symbolique développée par Pierre Bourdieu.
Sans revenir sur ce que j’ai écrit à ce sujet dans mes blogs récents, je rappelle que Bourdieu définissait « les rapports de domination [comme] des rapports symboliques qui passent par la langue [1]« . Voilà pourquoi, comme disait aussi Jacques Bouveresse, « l’inégalité dans les conditions d’accès au langage est un des facteurs de discrimination essentiels entre ceux qui subissent et ceux qui exercent le pouvoir ». C’est pour attirer l’attention sur cette forme de « discrimination essentielle », le plus souvent occultée par les intellectuels, que Pierre Bourdieu parlait du « racisme de l’intelligence ». Dans sa sociologie, il y a un lien étroit, logique et rigoureux, entre la question de la violence symbolique et celle de l’autonomie de la science. Étant donné que le savant est lui-même pris dans les relations de pouvoir que charrie le langage public, il faut nécessairement qu’il s’efforce d’en limiter les effets. D’une part, il doit éviter de se comporter, suivant l’attitude typique des intellectuels, comme un porte-parole, comme un professeur de morale et/ou de politique. D’autre part, il doit mobiliser les instruments que lui offre la science sociale pour entreprendre une analyse critique de son propre milieu.
Si l’on accepte l’idée que les rapports de communication sont aussi des relations de pouvoir, on comprend mieux pourquoi la question de l’autonomie se pose d’une façon beaucoup plus impérieuse pour les sciences sociales – qui utilisent le langage courant – que pour les disciplines plus « techniques », comme la science économique, par exemple. Si Bourdieu a pu écrire, dans ses Méditations pascaliennes, « Je n’aime pas, en moi, l’intellectuel », c’est parce qu’il était conscient que les intellectuels sont en position dominante en matière de langage. Ce qui explique qu’ils soient souvent enclins à alimenter le « racisme de l’intelligence ». Il a noté que cette forme de racisme pouvait être « à la racine de nombre de prises de position d’apparence généreuse en matière culturelle et politique ». Voilà pourquoi, il ajoutait : « En un mot, qui sera le mot de la fin, je dirai seulement que nul ne doit être à l’abri de la critique sociologique, même et surtout pas les intellectuels critiques. [2]«
Étant donné que Didier Fassin nous reproche également de critiquer les théories de « l’intersectionnalité », je m’arrêterai un moment sur cette perspective qui prétend combiner la « race », le genre et la classe. Sans revenir sur l’usage problématique du mot « race », le fait que les partisans de l’intersectionnalité mettent sur le même plan ces trois variables occulte le rôle structurant que joue la classe (au sens socio-économique) dans la domination symbolique car c’est à ce niveau-là que se produit « la discrimination essentielle » qui prive les classes populaires de tout accès au langage public. Cela n’empêche pas, bien sûr, qu’il y ait un lien entre la variable de classe et les variables de genre et de « race ». La grande majorité des individus issus des immigrations post-coloniales (ou autres) étant relégués dans les strates inférieures des milieux populaires, ils sont privés, en raison de leur appartenance de classe, des ressources culturelles qui leur permettraient de parler en leur nom propre.
Ces constats ont une importance essentielle pour comprendre ce que Didier Fassin appelle la « politique minoritaire ». Les « minorités » – je mets le mot entre guillemets parce qu’il faudrait préciser ce qu’on entend par là – sont traversées elles aussi par des clivages de classe. Si bien qu’employer ce terme de « minoritaire » comme un mantra tend à occulter le fait décisif qu’il existe, au sein de ces groupes marginalisés, une petite fraction qui détient le capital scolaire et culturel le plus élevé. Les chercheurs devraient aussi s’intéresser à la forme de domination qu’exercent celles et ceux qui s’érigent en porte-parole des « minorités ». Cela permettrait sans doute de comprendre pourquoi des individus peuvent récuser les étiquetages communautaires et privilégier des affiliations de classe avec les autres composantes des milieux populaires.
Force est de constater que les adeptes de l’ »intersectionnalité », tout en répétant constamment qu’ils prennent en compte la classe sociale, occultent systématiquement le rôle central de ce facteur dans les formes de domination symbolique, et la place qu’ils occupent dans ces relations de pouvoir. Par exemple, dans un ouvrage qui s’inscrit dans le sillage des réflexions de Didier Fassin sur « les politiques minoritaires », Sarah Mazouz se demande si « les personnes altérisées, minorisées, objets des discours officiels antiracistes, peuvent également en être les sujets, et désigner elles-mêmes ce qu’elles vivent du racisme ? [3« . Comme l’a noté Amel M’harzi, Sarah Mazouz « omet de mentionner cette inégale distribution de la parole au sein même de groupes qu’elle postule comme homogènes, ici « les personnes victimes de racisme » et les « minoritaires ». Pousser ces questionnements jusqu’au bout lui aurait fait apparaître que seuls ceux qui sont détenteurs de capital culturel et de temps libre ont le loisir de s’exprimer sur des plateaux TV et dans des revues sur ces enjeux [4]« .
Le modèle judiciaire
Venons-en maintenant au modèle judiciaire que Michel Foucault avait pointé dans son texte sur les polémistes et que l’on retrouve aussi dans le compte rendu de Didier Fassin sur notre livre, notamment dans les passages où il nous accuse de raisonner comme des « procureurs ».
Nous aurions reproché à Didier et Éric Fassin, les deux directeurs de l’ouvrage collectif De la question sociale à la question raciale, d’avoir occulté à leur profit le rôle des autres auteurs du livre – auquel Stéphane Beaud et moi avons également contribué. Un tel reproche aurait été, en effet, bassement polémique, car Didier Fassin a raison de rappeler que tous les noms des contributeurs sont mentionnés sur la couverture – et je peux ajouter que nous étions tous satisfaits de la manière dont les deux maîtres d’œuvre avaient animé ce projet collectif.
Mais si Didier Fassin avait vraiment lu ce que nous avons écrit à ce sujet, il aurait vu que notre critique portait sur le processus qui conduit d’une recherche collective à son édition en livre, puis à sa réception dans les médias. Un processus qui aboutit à privilégier les « grands noms » au détriment des autres, sans que les « grands noms » en soient eux-mêmes responsables. J’avais déjà abordé ce type de problème pour d’autres cas – comme celui des Lieux de mémoire que beaucoup de journalistes attribuent à Pierre Nora, alors qu’il s’agit d’une œuvre collective. Voir dans ce genre de réflexion une charge de « procureur », c’est confondre, une fois de plus, le monde de la science, celui de la justice et de la politique culturelle.
Didier Fassin nous accuse aussi d’avoir joué les « procureurs » en condamnant les travaux des jeunes chercheurs. Ce que j’ai dit plus haut suffit, me semble-t-il, à montrer que, là encore, Didier Fassin succombe aux facilités de la polémique. Nous disons explicitement dans ce livre que nos critiques ne visent nullement les travaux empiriques de nos collègues car seul un examen au cas par cas peut permettre d’émettre un jugement. Mais on comprend l’intérêt stratégique qu’offre une rhétorique nous présentant comme les « procureurs » des « jeunes chercheurs ». En se faisant le porte-parole de ces derniers, Didier Fassin s’est donné l’assurance de les mobiliser contre nous avec les résultats désastreux sur lesquels je reviendrai plus loin. Faut-il rappeler que Stéphane Beaud et moi avons dirigé de nombreuses thèses de « jeunes chercheurs » qui ont passé des années à travailler sur les problèmes qu’il évoque? Lorsqu’il écrit, dans ce même compte rendu, que « la génération précédente » (dont nous faisons partie Stéphane et moi) n’a pris en compte que « la seule dimension socioéconomique » des inégalités, c’est parce qu’il n’a pas lu, apparemment, le livre de Stéphane Beaud sur la famille Belhoumi (La Découverte, 2018), ni les deux ouvrages que j’ai consacrés à l’histoire du clown Chocolat (Bayard, 2012 et 2016).
Le modèle religieux
Venons-en, pour finir, au modèle religieux évoqué par Foucault. Il est illustré par l’usage répété, dans l’article de Didier Fassin, de termes comme « mystère », « étrange », « troublant ». Ce registre lui permet de présenter nos critiques comme une entreprise « diabolique », décrite en ces termes: « Errare humanum est, perseverare diabolicum. Il est difficile de penser que ces deux méprises sur des points si essentiels, clairement présentés en ouverture et à la fin de notre ouvrage, soient le fait du hasard ».
« La polémique n’ouvre pas la possibilité d’une discussion égale ; elle instruit un procès », écrivait Foucault. Dans ce cas précis, il s’agit d’un procès en sorcellerie, car si la répétition de nos fautes de compréhension ne relève pas du hasard, c’est qu’elles sont l’œuvre du diable. Pour tenter d’éviter le bûcher, je vais donc m’efforcer d’élucider le mystère.
Je peux comprendre que Didier Fassin ait été surpris que nous ayons rendu publiques nos divergences en revenant sur un projet de recherche auquel nous avons travaillé ensemble il y a une quinzaine d’années. Mais cela n’a rien de « mystérieux ». Comme nous le disons dans le livre, nous nous sommes rendus compte que l’ouvrage De la question sociale à la question raciale avait été un moment important pour la légitimation des catégories raciales dans le champ scientifique comme dans le champ journalistique. En raison de la forte position institutionnelle et médiatique des directeurs de l’ouvrage, ce livre a joué aussi un grand rôle dans la redéfinition des rapports entre le savant et le politique en rupture avec la tradition sociologique telle qu’elle a été défendue depuis Durkheim jusqu’à Bourdieu.
Quand Didier Fassin écrit que, pendant quinze ans, nous n’avons jamais éprouvé de regrets concernant ce projet, il se trompe. D’une part, il ne s’agit pas de « regrets » mais de divergences. Et d’autre part, nous avons continué à défendre nos positions dans nos publications ultérieures. Toutefois, il est vrai que nous avons longtemps évité de rendre publiques ce qui nous séparait de Didier Fassin et d’Éric Fassin, en raison des relations cordiales que nous avions avec eux.
Les raisons pour lesquelles j’ai décidé, pour ma part, de m’engager dans la publication d’un livre où nous avions, Stéphane Beaud et moi, beaucoup plus à perdre qu’à gagner, n’ont rien de « mystérieux ». Elle s’expliquent parce que je suis arrivé à l’âge où les universitaires dressent souvent un bilan de leur carrière. En m’efforçant d’examiner lucidement ce que j’avais réussi et ce que j’avais raté, il m’a semblé qu’en restant silencieux sur les divergences exposées plus haut j’avais une petite part de responsabilité dans la crise que traversent aujourd’hui les sciences sociales.
Et puisque Didier Fassin nous pousse, dans son texte polémique, à dissiper le « mystère », je dirai que mes critiques concernaient surtout les interventions de plus en plus fréquentes d’Éric Fassin dans les médias au nom de la sociologie. La multiplication de ses tribunes dans Le Monde et dans Libération, son blog abrité par Mediapart illustrent ce que Jacques Bouveresse appelait le « conformisme de la subversion » et de « la radicalité obligatoire ». Je ne pouvais plus garder le silence sur les discours dénonçant le « racisme d’État », le retour du « fascisme historique », la défense des « statistiques ethniques », l’affirmation que la couleur de peau serait une « position sociale » justifiant l’usage de termes comme « blanchité », « racisés », etc. Je ne pouvais plus accepter que la sociologie soit présentée au grand public (et donc aussi aux étudiants) comme une accumulation de discours critiques sur l’actualité, sans appui sur des recherches empiriques.
Dans mon prochain blog, je reviendrai sur le compte rendu de Didier Fassin publié par AOC en m’arrêtant sur l’argument polémique qui m’a le plus heurté, et qui concerne la façon dont il pratique les assignations identitaires pour discréditer ceux qui ne sont pas d’accord avec lui. Je montrerai ensuite que cette forme de violence symbolique, venue d’en haut, a tendance aujourd’hui à se diffuser dans le milieu des sciences sociales, ce qui contribue à aggraver la crise qu’elles traversent.
© Gérard Noiriel
Une première version de ce texte est parue sur le blog de l’auteur le 15 février 2023.
Notes
- 1. Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, Fayard, 1982.
- 2. Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, Presses universitaires de Lyon, 2000, p. 107.
- 3. Sarah Mazouz, Race, Anamosa, 2020, p.73.
- 4. Amel M’harzi, Se mobiliser à distance : une perspective comparée Figuig-« quartiers populaires » en France, mémoire de Master 2, EHESS, 2022.
https://agone.org/aujourlejour/le-savant-le-polemiste-et-le-racisme-de-lintelligence


Salmigondis indigeste. Bien nauséeux.


.
Une précision utile : Blanchard et surtout Éric Fassin (parfaites incarnations de la haine de soi pathologique…puisqu’ils sont blancs) cités dans cette chose… font partie des principaux diffuseurs des théories racistes des indigénistes dans les universités meinkampfiennes françaises (Paris8 notamment). Donc ces gens aussi chercheurs que…Drumont et Hitler.
Deuxio : historiquement le discours sur les « races » est le discours de l’extrême droite et du nazisme. Par définition. C’est un fait historique.. En l’occurrence le PIR, BLM, le parti démocrate américain, la NUPES, LREM etc..
Que nos universités soient aux mains d’authentiques nazis et que leur idéologie raciste soit devenue l’idéologie dominante de notre 4eme reich a été rendu possible en France grâce 1) à l’inculture politique des gens qui préfèrent voir le fascisme la ou il n’est pas que de le voir la où il est 2) la diffusion massive de cette idéologie raciste par les universités et les médias ( le fait qu’ils s’attaquent systématiquement à Israël est donc logique puisque le racisme et l’antisémitisme sont au cœur de l’idéologie dominante : ils ont été formés à la même école) 3) la complicité constante et factuelle des associations style Licra et des partis au pouvoir.
Bienvenue au 4ème Reich.
Ces individus ne sont pas des jeunots : ils ont donc eu le temps de répandre leur venin sur des générations entières…C’est le triomphe des crânes ra(ci)sés ! Et avec l’appui declaré du gouvernement macroniste https://www.tribunejuive.info/2022/09/27/xavier-laurent-salvador-quun-ministre-de-leducation-nationale-critique-luniversalisme-republicain-a-letranger-est-stupe%ef%ac%81ant/