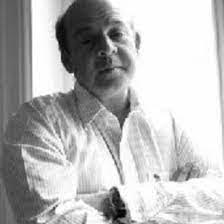
J’ai connu Robert Mauss dans une autre vie professionnelle, alors que lui comme moi nous étions journalistes spécialisés dans les nouvelles technologies. A l’époque, j’ai peu souvent parlé avec lui de notre judaïsme et de son influence sur qui nous étions et ce que nous faisions.
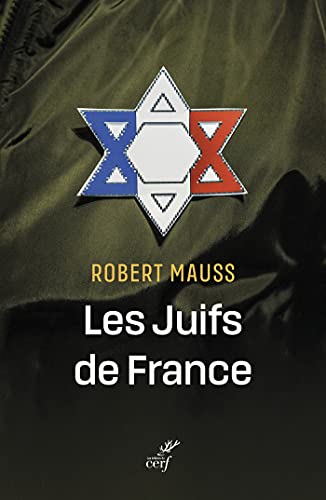
Quelques années plus tard – fin 2021 – j’ai découvert que Robert avait sorti aux Editions du Cerf un livre intitulé « Les Juifs de France »(1). Il reposait sur des interviews de personnalités plus ou moins connues de notre « communauté ». Il permettait de dessiner un portrait sensible et éclairant de la situation des Juifs dans l’hexagone, quelques années après la série d’attentats et de crimes dont les Juifs avaient été victimes. Ce, quelques années après les Gilets Jaunes, en plein cœur de la pandémie du Covid-19, alors que l’antisémitisme ne semblait jamais s’être aussi bien porté depuis l’année 2002, qui marqua pour beaucoup d’entre nous le virage majeur de ce début de siècle.
Plus de quarante ans, après le « Juifs et Français » d’André Harris et Alain Sédouy, qui avait beaucoup fait couler d’encre à l’époque, des questions lancinantes se posaient : Comment les Juifs avaient pu évoluer et avaient vu évoluer leur « statut » dans une république menacée ? Etaient-ils restés ou pas attachés à la France ? Et bien d’autres questions encore auxquelles l’ouvrage de Robert Mauss a tenté de répondre.
En ce début d’année 2023, il m’a paru intéressant d’interroger l’auteur de cette enquête pour savoir, à froid, ce qu’il fallait en retenir. Voici ses réponses.
GK – Bonjour Robert. Pouvez-vous vous présenter ? Avez-vous un lien de famille avec Marcel Mauss, considéré comme le « père de l’anthropologie française » ?
Robert Mauss- Merci infiniment Gérard d’avoir la gentillesse et la délicatesse de me rappeler à mes ascendants. Marcel Mauss (1872-1950) était le frère de mon grand-père paternel. Je suis donc son petit-neveu. Pendant des années, j’ai géré pour le compte de ma famille les liens avec les éditeurs, le Collège de France où il avait enseigné, et les chercheurs qui désiraient accéder aux documents que ma famille a légué au Collège de France. Marcel Mauss est toujours étudié dans les facultés de sociologie du monde entier. Son « Essai sur le Don », publié en 1925 est considéré comme un classique essentiel des études d’ethnologie. Mauss, agrégé de philosophie, était lui-même le neveu d’Emile Durkheim (1858-1917) considéré comme le fondateur de la sociologie française. On lui doit la construction des méthodes, toujours en cours, utilisées pour scruter les sociétés de manière scientifique ou rationnelle. Je tiens Durkheim pour l’un de ces génies juifs apparus à cette époque, au même titre que Freud ou Einstein. Mauss et Durkheim qui n’ont jamais renié leur judaïsme, étaient des militants socialistes de premier plan qui entretenaient des liens d’amitié puissants avec Jaurès, Blum, et bien d’autres. Ils s’étaient ainsi engagés corps et âme dans la défense du capitaine Dreyfus.
GK – Pourquoi ce livre « Les Juifs de France » ? Qu’est-ce qui vous a motivé à l’écrire, vous qui jusqu’alors étiez journaliste dans les nouvelles technologies ?
RM – J’ai toujours été attaché au judaïsme. Jeune, j’étais parti avec l’Hashomer Hatzaïr transformer des pierres en oranges dans un kibboutz. Nous ne mangions pas kasher à la maison, mais nous respections les grandes fêtes du calendrier juif. Comme beaucoup de Français, je considère que la religion ne regarde que soi-même et je n’ai jamais éprouvé le besoin d’en parler plus que nécessaire ou de revendiquer quoi que ce soit. Et puis l’Histoire a commandé. J’ai été horrifié par le traitement réservé aux Juifs dès le début de la deuxième Intifada. Nous avons été engloutis par cette ‘’spirale du silence’’ dont parlent les sociologues. Impossible de s’exprimer. Interdiction formelle de s’indigner quand un dingue se faisait exploser dans un autobus ou un restaurant. Ou, lorsque des esprits puissants osaient comparer une folle meurtrière à Anne Franck. Je crois d’ailleurs que les Palestiniens (et leurs amis) ne comprennent pas le mal qu’ils se font à eux-mêmes en éduquant leurs enfants avec ce goût du sang. Et puis voilà 2003, année maudite. Les anglo-saxons décident d’en terminer avec le dictateur irakien Saddam Hussein. D’interminables cortèges parcourent les rues du monde entier pour tenter d’empêcher la guerre. Avec le recul, pourquoi pas ? Sauf que voilà des manifestants profitent de l’occasion pour vomir leur détestation d’Israël et des Juifs en général qui pourtant n’en peuvent mais. A Paris, au cours d’une manifestation des jeunes juifs identifiés comme tels sont poursuivis par des maghrébins armés de poignards. Les gosses ont échappé au pire en se réfugiant par miracle dans les locaux du Cercle Bernard Lazare, dans le Marais. C’est peu dire à quel point cet incident m’a bouleversé. Surtout qu’il venait après un autre drame. La même année, un collégien juif de douze ans avait été exclu du prestigieux lycée Montaigne à Paris, alors qu’il était racketté et tabassé par deux de ses condisciples d’origine immigrée. La Ligue des Droits de l’Homme et son président l’avocat Henri Leclerc avait multiplié les recours pour obtenir ce résultat calamiteux. Ce gosse était juste le premier d’une longue série qui fait qu’aujourd’hui, vous ne trouverez plus (ou quasiment) de gamins juifs dans les établissements scolaires de Seine Saint Denis ou du Val d’Oise. Outre la nausée que j’avais ressenti, je me suis dit qu’une rupture profonde, une faille béante était creusée entre la France et ses Juifs. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti étranger dans mon propre pays. Une horreur. Alors je me suis souvenu du « Juifs et Français » d’Harris et Sédouy, ces deux grandes figures du journalisme, et j’ai voulu écrire une suite afin d’établir une sorte de point sur la situation des Juifs de la République. L’affaire m’a pris une vingtaine d’années. Il faudra me montrer un peu plus alerte pour le prochain…
GK – Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour l’écriture et la sortie de cet ouvrage ? Notamment : avez-vous essuyé des refus d’interviews de personnalités qu’il vous paraissait important de recueillir ?
RM- J’ai rédigé « Les Juifs de France » pendant la pandémie de Covid. Nombre de gens s’étaient réfugiés loin de Paris et plusieurs de mes interviews ont été malheureusement conduites par téléphone. Mais là ne réside pas l’essentiel des problèmes. Ce livre, je l’ai porté très longtemps aussi parce que je ne trouvais personne pour l’éditer. J’ai quand même décidé de commencer à travailler. D’abord en rédigeant une introduction pour expliquer mes intentions, ensuite en rédigeant des entretiens avec des personnes qui m’aiment bien. Malgré tout, personne ne s’est montré intéressé avant que je ne rencontre un peu par hasard Jean-François Colosimo, l’excellent patron des éditions du Cerf, société soit dit en passant qui appartient à l’ordre des Dominicains.
Il a fallu définir une liste d’intervenants à partir de deux critères : être juif bien sûr et surtout avoir un témoignage particulier, et même spécifique soit parce que le témoin a voué sa vie au service de la communauté, comme Francis Kalifat l’ancien président du CRIF, ou Haïm Korsia notre exceptionnel Grand Rabbin de France, ou bien parce que le témoin a observé et produit un discours sur la vie juive. Je pense ainsi à Gérard Bitton et Michel Munz, auteurs de la saga « La vérité si je mens » qui court sur 25 années. A Jean-Yves Camus qui scrute avec pertinence les évolutions de la vie politique depuis des années ou à Brigitte Stora qui narre dans son « Que sont mes amis devenus » le sort de ces militants de gauche renvoyés à leurs origines juives et abandonnés en rase campagne par leurs amis de toujours, désireux de servir d’autres causes.
Mais rien n’a été simple. A ma grande surprise, beaucoup de gens ont refusé de me recevoir. D’habitude comme vous le savez si bien, les journalistes spécialistes de l’économie numérique sont sollicités chaque matin que D. fait pour rencontrer des dirigeants d’entreprise. Là, au contraire les portes restaient closes. Certains n’ont même jamais voulu me répondre, très grossièrement. Plutôt que d’hurler à l’injustice ou d’abdiquer, j’ai contourné l’obstacle. Comment ? Figurez-vous grâce à Marcel Mauss et Emile Durkheim, bénis soient-ils ! Au quotidien, je ne parle jamais de ma famille. Ça n’aurait aucun sens. Mais là j’ai convoqué ces deux gloires pour forcer les barrages. Après tout personne ne connaissait Robert Mauss et il fallait bien me présenter pour obtenir des entretiens. Par chance, à la demande de Shlomo Malka, j’avais rédigé des années plus tôt un article pour le mensuel « L’Arche » intitulé « Le poids du nom » qui traite de la lourdeur d’un héritage intellectuel pesant.
Dès lors, pour chaque demande d’entretien, je recommandais aux gens de lire l’article. Si l’affaire vous intéresse, le texte est toujours en ligne (https://larchemag.fr/2017/01/02/2913/le-poids-du-nom/) . Miracle ça a plutôt marché !
GK – Parmi tous vos interviewés, si vous deviez en choisir une ou un, quel nom vous viendrait à l’esprit ? Pourquoi ?
RM – Sur ce coup-là, je ne vous remercie pas de la question ! Chacun de mes interlocuteurs compte à sa manière. Chacun porte un témoignage particulier. Très sincèrement, c’est une affaire douloureuse de devoir distinguer l’un d’entre eux. Une fois qu’ils m’ont accordé leur confiance, les gens se sont livrés sincèrement. Disons que je conserve tout de même un souvenir un peu plus précieux de plusieurs rencontres, pour des raisons parfois cocasses. Par exemple, j’ai compris fortuitement au cours de notre rendez-vous que Georges Bensoussan est le frère de l’un de mes amis de l’Hashomer Hatzaïr ! J’ai eu le bonheur d’interviewer Maitre Serge Klarsfeld qu’Harris et Sédouy avaient déjà rencontré en 1979. Ou de revoir le Commissaire Ghozlan, le Fondateur du Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitisme que je connais depuis mon enfance !
Sans parler du rabbin de Blanc-Mesnil si proche de ma famille. J’ai adoré rencontrer Joseph Marceau, Fondateur du Maavar qui permet d’héberger et nourrir tellement de personnes malheureuses.
Mais bon, s’il faut vraiment céder à votre torture amicale, ce sera l’entretien que m’a accordé Nathalie Azoulay. Déjà en bon Français, j’aime la geste littéraire. Ensuite, en 2003, cette année cruciale, Nathalie Azoulay, prix Médicis, avait publié un roman magnifique, « Les Manifestations », qui mieux que n’importe quelle étude sociologique ou journalistique explique l’effroyable solitude que les Juifs de France ont ressentie à ce moment précis de l’Histoire. C’est le propre de la littérature que de découvrir des horizons, dépeindre des sociétés avec une puissance que n’auront jamais les meilleures spécialistes des sciences sociales, historiens, économistes ou autres.
GK – Plus d’un an après sa sortie, quel constat tirez-vous à titre personnel de la situation des Juifs de France et de leur appréciation des opportunités et menaces qui se présentent à eux ?
RM – Là encore merci pour cette question, car l’affaire ne cesse de me tarauder. J’ai profité du recul pour tirer des conclusions de cette étude journalistique qui feront j’espère l’objet d’un prochain livre. Pour faire court, les Juifs ne sont pas en danger comme ils ont pu l’être avant-guerre ou au cours de l’Affaire Dreyfus. Déjà, et ça compte, nous ne sommes pas menacés par un antisémitisme d’état. Au mieux nous profitons de sa protection et de sa bienveillance, au pire de son indifférence. Mais comme l’explique Jean-Yves Camus dans notre entretien, « il ne m’est jamais rien arrivé (heureusement NDR) mais je sais que ça peut cogner à tout moment« . Il faut dire que lui-même habite dans le quartier où vivaient Mireille Knoll et Sarah Halimi. Voilà dans quel état d’esprit je suis. Et il faut croire que je ne suis pas le seul : quand en 1979 André Harris et Alain de Sédouy sortent « Juifs et Français », les experts estiment que la communauté compte 600 000 personnes. En 2021, Francis Kalifat qui connait bien la question affirme qu’elle ne couvre plus que 450 000 personnes. Si j’intègre les données démographiques, la communauté juive de ce pays a perdu non pas 150 000 mais 250 000 personnes ! Il y a ceux que le judaïsme n’intéresse plus, et c’est leur droit absolu. Mais il y a ceux qui quittent la France. Quand je participais aux activités de l’Hashomer Hatzair, pas plus de deux cents personnes partaient vivre chaque année en Israël. Depuis vingt ans, c’est dix fois plus année après année, et parfois plus. Sans compter ceux qui s’installent ailleurs et que nous ne connaissons pas. Ma sœur est américaine, ainsi que deux de nos cousines germaines, leurs conjoints, enfants et petits-enfants. Soit une trentaine de personnes qui ne fréquenteront plus nos synagogues ou les magasins communautaires. Et pourtant, en même temps, jamais la vie juive n’a jamais été aussi intense dans ce pays. Par exemple, quand j’étais gamin il n’y avait que trois écoles juives en Ile-de-France. Aujourd’hui, il y en a partout, et pas seulement pour des questions de sécurité. Idem pour les magasins casher. Ou pour les institutions comme les maisons de retraite. En une petite année, j’ai présenté mon livre dans trois salons dédiés aux livres « juifs ». C’est incroyable. Des campagnes comme la Tsedaka ou le Limoud sont, somme toute très récentes, dans la vie juive de ce pays.
GK – Restez-vous optimiste à long terme ou pensez-vous que le contexte délétère, observé par beaucoup, va s’éterniser, voire s’aggraver ?
RM – Il est évident que la question démographique va finir par peser sur le devenir de la communauté. Il devient ainsi compliqué de manger casher dans certaines métropoles. Mais au-delà, il faut souligner le trouble absolu qui règne sur la communauté. Comme d’autres, je me suis rendu place du Trocadéro pour m’indigner de la décision de la Cour de Cassation dans l’affaire Sarah Halimi. Pour rester calme, la façon stupéfiante dont l’instruction a été conduite me laisse encore pantois. Les campagnes anti-israéliennes conduites par des journaux importants comme « Le Monde » et « Le Figaro » sont catastrophiques. L’engagement d’une partie de la Gauche aux cotés de parfaits antisémites comme le britannique Jeremy Corbin, ou la valorisation de personnalités très douteuses comme Daniele Obono, ont de quoi pétrifier nos coreligionnaires. Je n’ai aucun doute sur les sentiments que ces gens me vouent. Et ça n’est pas fini. Mais le plus stupéfiant, le plus grave de ces phénomènes, c’est bien l’irruption du journaliste Eric Zemmour dans le champ politique. Qu’un Juif, qui parait-il mange casher, puisse trouver des vertus à des figures aussi nauséabondes que Charles Maurras et Philippe Pétain me laisse littéralement sans voix. Ses propos sur Dreyfus relève tout simplement du négationnisme. Mais il y a pire que lui : il a ceux qui le soutiennent et votent pour lui, à commencer par de nombreux Juifs. Ceux-là, je leur en veux. Mais peu importe, l’affaire en dit très long sur la vision que beaucoup de Juifs de France ont de la République. Vous savez l’antisémitisme devient physiquement dangereux quand il est à la conjonction de l’extrême-droite et de l’extrême-gauche. Nous fleurtons depuis des années avec des limites toujours plus ténues.
Entretien conduit par Gérard Kleczewski pour TJ
- « Les Juifs de France ». Robert Mauss. Les Éditions du Cerf. 285 pages.