OPINION. Comment expliquer que les épisodes de violence, qu’ils soient liés au terrorisme ou à l’insécurité au quotidien, se heurtent presque systématiquement à un mur de grands principes et de beaux sentiments ?
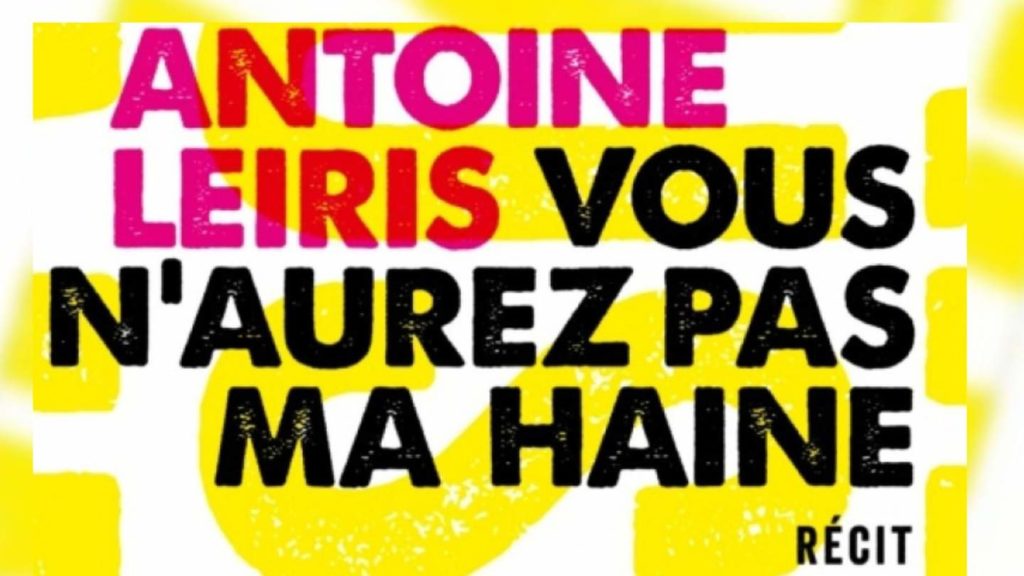
« Vous n’aurez pas ma haine ». Ce titre d’un ouvrage, écrit par le père d’une des victimes du Bataclan, est le cri de toute une génération bourgeoise qui revendique son appartenance au camp du bien et repousse loin d’elle l’hypothèse du mal en son sein. La fracture sociale est là : entre, d’un côté, le monde des enfants de l’élite éduquée qui a accédé aux manettes du pouvoir dans la politique ou les médias, et de l’autre le monde populaire qui se sent abandonné et trahi depuis quelques dizaines d’années déjà. Un monde populaire qui, n’appartenant pas aux « talking classes » seules légitimes à s’exprimer en public, désespère de faire entendre ce qu’il voit et subit quotidiennement.
« La meilleure façon de comprendre les conflits culturels qui ont bouleversé l’Amérique depuis les années soixante est d’y voir une forme de guerre des classes dans laquelle une élite éclairée (telle est l’idée qu’elle se fait d’elle même) entreprend moins d’imposer ses valeurs à la majorité (majorité qu’elle perçoit comme incorrigiblement raciste, sexiste, provinciale et xénophobe) encore moins de persuader la majorité au moyen d’un débat public rationnel, que de créer des institutions parallèles ou « alternatives’ dans laquelle elle ne sera plus obligée d’affronter face à face les masses ignorantes« , écrivait Christopher Lasch dans La révolte des élites (1995).
Macron est le prototype de cette élite instruite dans les bonnes écoles, puisant une image de compétence dans sa communication et s’appuyant sur une base restée provisoirement solide. Une élite indifférente aux souffrances populaires qu’elle ignore, ou plutôt qu’elle relativise. En réalité, l’effondrement est proche et il est préfiguré par l’état déliquescent de l’école, de la police et de la justice qui ne parviennent plus à remplir leur mission d’éducation, de sécurité et d’égalité devant la loi.
Il y a actuellement 120 attaques au couteau par jour. Mais qui donc possède un couteau dans sa poche ? Quel est le profil de ces manieurs de couteau ? Le dénominateur commun serait-il culturel ? Civilisationnel ? Pourquoi n’en parle-t-on pas ? Pour ne pas stigmatiser ? Mais quel rapport avec ces millions de personnes de la même origine ? Pourquoi alors ne pas dire ce que chacun sait : que la quasi-totalité de la délinquance de la vie quotidienne est commis par l’immigration ou plus précisément par des personnes appartenant à cette aire civilisationnelle du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne ? Si on continue à pratiquer ce déni, le danger est grand que l’on en arrive à stigmatiser l’ensemble d’une population en la poussant encore davantage à se séparer de la communauté nationale. Alors qu’il faudrait dénoncer avec franchise cette délinquance qui a son origine dans des comportements familiaux, culturels, religieux même, et entamer le débat sur des mesures nécessairement draconiennes.
Il s’agirait de quelques personnes, nous dit-on, et il ne faudrait pas faire de généralité. Ce discours est convenu depuis quelques dizaines d’années. Cette génération, et ce milieu-là, minoritaires dans la population mais très puissants dans la politique et les médias, a peur du racisme, peur de la haine, peur de l’exclusion. Ils appartiennent à des groupes qui se veulent angéliques dans leurs intentions et coupables de ce qu’ont fait leurs prédécesseurs : colonialisme, esclavagisme antisémitisme, racisme… Ils se méfient de l’armée et la police sauf quand elles servent leurs intérêts, récusent le monopole de l’État sur la violence légitime, rejettent le nationalisme, l’homophobie, le sexisme, l’islamophobie, le militarisme. Comment comprendre cet assaut de gentillesse et d’humanisme sans limites ?
La réponse est en partie dans l’éducation donnée par des parents, une éducation bienveillante qui culpabilise l’enfant colérique, l’enfant « méchant » et rebelle, l’enfant qui devrait être reconnaissant de l’amour qu’on lui porte. Cet enfant, souvent unique, est gâté car il est le porteur des rêves de ses parents. D’un côté, on lui dit qu’il est aimé et qu’il peut faire ce qu’il veut. De l’autre, subtilement, il est manipulé pour répondre aux désirs de ses parents. Cette violence qui se fait passer pour de l’amour culpabilise l’enfant qui doit réprimer sa colère. Il va ainsi choisir ses objets de bienveillance et de sollicitude, les opprimés qu’il a choisis et au même moment pouvoir exprimer sa haine des oppresseurs, l’autorité et tous ses représentants. Bien entendu, l’explication psychologique est insuffisante. Mais elle permet de comprendre que l’idéologie a souvent un soubassement relevant de l’histoire personnelle et affective de chacun. A condition de ne pas oublier que cette histoire familiale est également une histoire de classes sociales et de moment de l’histoire.
Charles Rojzman