

16 juillet 1942. Il y a 80 ans. Un matin de soleil. Un jour de honte qui a vu mon arrière-grand-mère , Rosza, partir pour Pitchipoï…
En ce merveilleux jour d’été, ayez une petite pensée pour elle ainsi que pour tous ceux montés dans les bus du désespoir.
« 1942. C’est un jeudi d’été. Ce matin-là Rosza s’est levée plus tôt que d’habitude pour faire une surprise à son petit-fils. Il raffole du « Ferdinand Testa ». Un gâteau au nom ridicule. Il viendrait, soutient-elle, de l’Empereur Ferdinand. Lequel ? Elle n’en est pas à ce détail près. C’était un Habsbourg et le « Ferdinand Testa » a été créé pour lui. – La preuve, dit-elle, c’est ma mère Julia qui m’a transmis la recette, qui la tenait elle-même de sa propre mère, Sara, ma grand-mère. Un régal avec son beurre généreux, la crème, la fontaine de sucre, sa croûte caramélisée.
En riant, Rosza a chassé Michel de son lit. – Dépêche-toi, j’ai besoin de ton édredon pour que la pâte lève.
La rue dans l’alignement du balcon s’étire. Vide. Comme un trait vers l’inconnu. Il fait pourtant si beau. Mais les trottoirs sont déserts. Le bouquiniste est fermé. Disparus les amoureux, les étudiants, les touristes, les ménagères.
Une curieuse ambiance entoure le silence du matin. En haut de la rue de la Grange-Batelière, subitement dépeuplée, apparaissent trois policiers en uniforme. Ils se parlent à voix basse. Marchent lentement. Du pas de ceux qui vont accomplir leur devoir. Sur ordres.
Le claquement des talons résonnent contre les façades inquiètes. Rien ne presse. Cinquième étage. Porte du fond à gauche. Qui pourrait se douter de quoi que ce soit ?
Il faudrait ignorer cette sonnette. Elle annonce le malheur. Restez immobile. Ne bougez pas. Taisez-vous. Arrêtez de respirer. Faites croire que l’appartement est vide. Nous ne sommes pas là. Il n’y a personne.
Deuxième coup de sonnette. Élisabeth, appelée affectueusement Böszi par sa mère, ouvre sans méfiance.
Les voilà. Les messagers de la mort. Portant l’uniforme des policiers français. Pour l’instant, ils sont trois fonctionnaires sévères, munis d’une lettre de mission, dressés face à Élisabeth, Rosza et le garçon. La famille est pétrifiée. Soucieuse. Sans doute résignée à la vue de ces trois hommes. Ils représentent l’autorité. Quelle autorité ? Celle d’entrer sans être invités à le faire ? – Nous venons chercher Rozalia Korn née Waldman, annoncent-ils sans préambule.
Aucun sentiment ne filtre. Les ordres sont les ordres.
Pourquoi elle et pas les autres ? Pas de questions. Pas un cri de protestation. Pas même des larmes. Le silence. L’obéissance comme s’ils avaient su. Depuis longtemps. Cela devait arriver. – Prenez quelques affaires, dit froidement l’un d’eux.
Toujours l’absence d’émotion dans la voix. Après tout, ce n’est qu’une vieille femme étrangère. Elle a fait son temps. Dans le fond de l’appartement, Élisabeth remplit en vrac une petite valise. Comme il le fait habituellement, Michel, que tout le monde appelle Misha, se serre contre les jupes de Rosza. Et elle, elle lui passe la main dans les cheveux, disant doucement en Hongrois :- Ce n’est rien, ne pleure pas, tout ira bien.
Ce furent ses dernières paroles. Ils l’emmènent prestement. Sans un regard en arrière. On ne la reverra plus. Petite silhouette voûtée. Elle trotte entre les uniformes bleus. Elle marche vers la mort en ce jour de juillet 1942. Un jour de honte. Il demeurera dans l’histoire sous le nom de la grande rafle du Vel d’Hiv. »
Jean-Jacques Erbstein
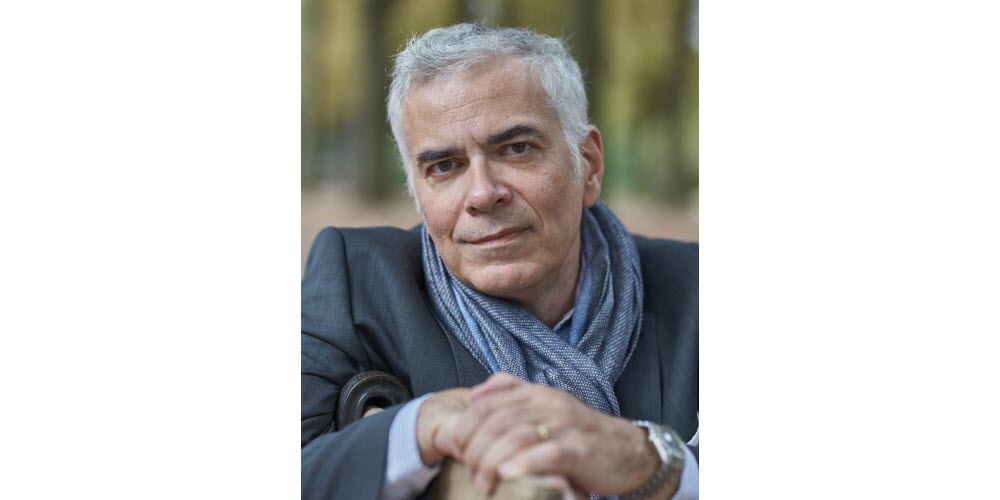

A partir des notes de son père journaliste, Jean-Jacques Erbstein a reconstitué dans Les Volets bleus l’histoire de sa famille hongroise. Cinquième livre du « médecin auteur », après Les voyages de Philibert, Le Blues de la blouse blanche et L’homme fatigué, qui a obtenu le prix Littré du Groupement des écrivains-médecins.


C’est effrayant…je ne trouve pas d’autres mots. Je suis née en Août 1940. On ne m’a rien appris sur la WW2 ni à la maison ni à l’école. Fin Août 62 je suis partie en coopération à l’étranger puis en 1970 je suis partie au Québec. Je ne savais toujours presque rien, des informations comme ça sur la WW2. Au Canada Il y avait une importante communauté de confession Juive venue des Pays d’Europe de l’Est ,comme on disait à l’époque. Ces gens ne racontaient rien. ou presque. Je découvre en entier maintenant, en France, par les commémorations.
Quand je relis ces horreurs, toujours il me revient la peur de la police française, je suis née en aout 39, j’ai échappé de justesse avec ma mére, à la rafle .Quelques années plus tard, encore une gamine nous partions en courant quand nous apercevions les flics qu’on appelait les hirondelles à l’époque car ils portaient une sorte de cape . 22 Vla les flics!