Yehoshua est mort le mardi 14 juin à l’âge de 85 ans et il est difficile de ne pas avoir le sentiment que nous approchons de la fin d’une époque. Celle d’Aharon Appelfeld (1932-2018), d’Amos Oz (1938-2018) et d’A.B. Yehoshua (1936-2022), qui ont incarné une génération de lions de la littérature israélienne, lesquels n’étaient pas seulement de grands écrivains. Cette génération représentait aussi la conscience morale d’une nation qu’ils ont vu naître.
Beryl Caizzi, qui avait écrit pour K. un texte à partir de La mariée libérée de Yehoshua – à lire ICI – envoie, le cœur serré, une lettre en hommage à cet écrivain qu’elle aime.

« La politesse et la sympathie nous gâtent. Une conversation profitable est impossible, tant les gens sont conciliants et résolus à tomber d’accord avec vous. Que d’amabilité et de résignation dans une causerie ! J’aimerais rencontrer chez un homme de la bizarrerie agressive ; alors, nous pourrions jouer à l’hôte et à l’étranger et nous rafraîchir mutuellement. Il peut arriver à un homme de se noyer et de sombrer entièrement dans les bonnes manières. Les milles individus que je vois, je les aborde navré, et seulement pour les quitter, car je ne puis espérer la moindre rudesse de leur part. Un homme grognon, original, un homme mal dressé – voilà de l’espérance. »
H. D. Thoreau, Journal, 1851.
L’écrivain Avraham B. Yehoshua est mort mardi 14 juin, en Israël, à l’âge de quatre-vingt-cinq ans.
Difficile sans doute de faire un éloge, même funèbre, d’un homme qui cherchait aussi peu à plaire et prenait presque systématiquement l’Histoire à rebrousse poil.
A l’instar du président, du premier ministre et du ministre de la culture israéliens, nous pourrions nous concentrer exclusivement sur ses talents littéraires, rappeler le nombre de langues dans lesquelles ont été traduits ses romans, les nombreux prix qui lui ont été décernés.
Sioniste et arabisant, chantre du mariage et de la famille et féministe revendiqué, écrivain polyglotte et cosmopolite et pourfendeur de la diaspora, Yehoshua ne se laisse enfermer dans aucune case. Déjà très âgé, il renonça même à l’idée qu’il avait défendu pendant des décennies, “la solution à deux États”, pour promouvoir “un État commun” aux Israéliens et aux Palestiniens, revirement qui entraîna une dispute avec son ami de toujours, Amos Oz.
Et pourtant, aucune de ces postures, de ces prises de position ne semble être le fruit d’un goût pour la provocation, l’exposition médiatique ou les modes du moment. Comme les personnages de ses romans, Yehoshua cherche inlassablement : il cherche à comprendre les causes des conflits intimes et collectifs, il cherche la vérité des êtres, il cherche des solutions et ce, jusqu’à son dernier souffle. Que l’on partage ou non les conclusions de ses recherches, une telle persévérance, une telle obstination dans le questionnement force l’admiration.
Qu’il prête sa plume à un jeune Arabe israélien dans L’amant, qu’il fasse l’éloge des Juifs pieux qui permettent à un déserteur de fuir le front ou que l’un de ses personnages, un vieux professeur, se dispute au téléphone avec un représentant en aspirateur qui demande à parler à sa femme et qui refuse de lui vanter les qualités d’un produit dont il est pourtant l’utilisateur principal dans son foyer, jamais le lecteur ne doute de la véracité du propos.
Yehoshua semble ne pas éprouver le besoin de retrancher, de policer, de produire un ensemble cohérent et transparent. Ce faisant, sans jamais proposer de schémas d’identification facile, il offre une liberté incomparable au lecteur, celle de plonger dans la pluralité des mondes.
J’écris d’Italie, pays que Yehoshua considérait comme sa seconde patrie et où ses lecteurs non israéliens étaient les plus nombreux. L’action de son dernier roman, La fille unique, se déroule au nord de l’Italie et, dans La mariée libérée, le personnage qui semble incarner le père de l’écrivain, l’historien Yaakov Yehoshua, est un Juif piémontais, le professeur Tedeschi.

Aujourd’hui, le quotidien La Repubblica lui consacre deux pleines pages. Le directeur du journal, Maurizio Molinari, et le spécialiste d’Israël et du fait juif, Wlodek Golkorn, en parlent avec émotion comme d’un ami intime qui leur manquera ainsi qu’aux lecteurs du journal et aux nombreux Italiens qui ont eu la chance de le rencontrer lors d’événements littéraires. Ses affinités tiennent bien sûr à la culture méditerranéenne du brassage. Moins prévisible est l’hypothèse avancée par Maurizio Molinari qui établit un parallèle entre l’aventure sioniste et le Risorgimento italien, processus tardif et laborieux qui ne semble toujours pas achevé dans un pays d’émigration, multilingue, divisé et difficile à comprendre dans son hétérogénéité. “Etre Italien” n’a encore aujourd’hui rien d’une évidence. De part et d’autre, ces incertitudes sont sans doute fécondes.
Bizarrement, à l’annonce de sa mort, le cœur serré, je me suis demandée dans quel lit il était mort, lui qui aimait tant à faire dormir ses personnages dans des lits de hasard. Dormir hors de chez soi, disait-il, c’est être capable de s’abandonner, de s’en remettre à autrui. Forts de cette confiance, les hôtes veillent sur le sommeil de l’étranger. C’est donc par ces paroles que je voudrais le saluer, lui et ses personnages que j’ai tant aimé suivre dans leurs incessantes pérégrinations : “Et je me couche, fier d’avoir vécu et souffert dans d’autres que moi-même.[1]”.
Notes
| 1 | Charles Baudelaire, Les fenêtres, Le spleen de Paris. |
Béryl Caizzi.
Rome, le 15 juin 2022
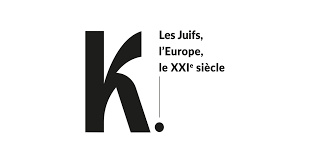
K. est une revue sur Internet fondée par des universitaires et des journalistes venant des quatre coins de l’Europe.



Poster un Commentaire