CRITIQUE- L’idée de déclin est la reine de l’époque. Faut-il penser l’effacement de la civilisation occidentale et, si oui, comment ? Le philosophe Pierre-André Taguieff s’attarde sur cette épineuse question dans Le retour de la décadence (éd. PUF).
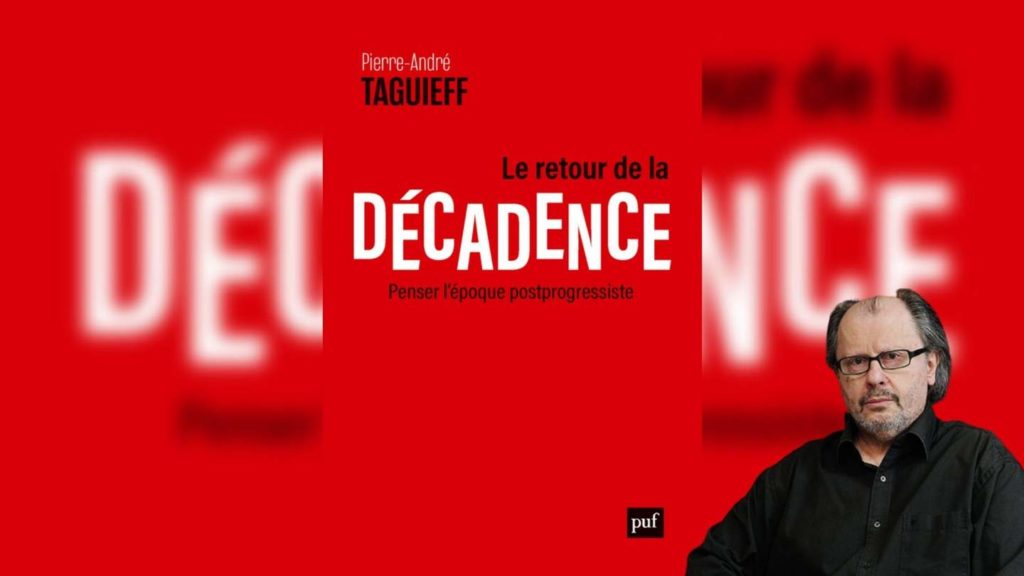
« Peut-on parler aujourd’hui, un siècle après Spengler, d’un déclin de l’Occident ? La réponse à cette question ne peut qu’être nuancée », note l’auteur en fin d’ouvrage. C’est du reste souvent l’intérêt des travaux de Pierre-André Taguieff. Historien des idées, ce grand érudit nous propose de « penser l’époque postprogressiste ». Essayons d’y voir clair avec lui.
L’époque postprogressiste, comme son nom l’indique, est l’époque qui succède non pas tant au progrès en lui-même qu’au Progrès comme idéologie, c’est-à-dire l’époque moderne, celle des Lumières, de la Raison et des « grands récits ». Les temps modernes se sont installés avec l’idée d’un progrès linéaire et quasi nécessaire de l’humanité (dont la pensée de Condorcet fournit un des archétypes).
Cette époque d’optimisme historique semble révolue. Nous sommes aujourd’hui dans l’ère post-moderne, celle du relativisme généralisé, de l’instabilité identitaire. C’est donc aussi celle du retour dans l’ère des inquiétudes, voire des angoisses. La question est de savoir si cet essoufflement du progressisme – là encore, nous parlons non pas du progrès en lui-même mais du progrès comme idéologie -, signe la fin de la civilisation occidentale.
Quelle est la thèse de Pierre-André Taguieff ? En l’occurrence, il s’agit d’une crainte intellectuelle : nous sommes en train de passer d’une utopie à une autre. Du fait que le progrès a été absolutisé dans la modernité, il ne pouvait que décevoir. Et puisqu’il a déçu, il est aujourd’hui rejeté en bloc avec la même fougue qui l’avait porté sur les fonts baptismaux de l’histoire universelle.
« La dissipation des mythes et des utopies modernes, rendue possible par la clairvoyance des penseurs anti-utopistes du 20ème siècle, ne devrait pas logiquement ouvrir la porte à une nouvelle vague d’obscurantisme, qui mêlerait le rejet de la science à la haine de la technique. C’est pourtant la menace qui se profile, les mouvements idéologiques n’obéissant pas aux règles élémentaires de la rationalité. »
Ainsi de l’histoire occidentale et du mouvement de balancier qui la caractérise. Elle est passée en à peine trois siècles d’une hégémonie ivre d’elle-même et de sa puissance à la haine de soi et aux flagellations intempestives. Le monde occidental était celui qui avait conquis idéologiquement la planète, inventé la science, le progrès, la technique… Il n’est plus que le géniteur criminel de la domination blanche, du capitalisme, du règne technicien, de l’hétéropatriarcat et la destruction de la biodiversité.
Alors que l’époque moderne a été caractérisée par le « prométhéisme », cette faculté technicienne de l’homme à s’arracher à la nature pour s’aventurer à la conquête du monde, c’est aujourd’hui le principe de précaution qui règne, lequel est un principe en soi conservateur. « Le progressisme rencontre une incrédulité croissante, notamment dans le monde des élites occidentales, converties à l’écologisme et à sa morale anti-prométhéenne de la préservation », note Taguieff.
Ainsi le progressisme – et tout l’Occident avec lui – se retourne contre lui-même. Pour Taguieff, les exemples du féminisme et de l’antiracisme sont éloquents. Dans les deux cas, l’exigence d’universalité a laissé place à un essentialisme identitaire. Le néoféminisme réinvestit l’essence féminine (contre les hommes) et le nouvel antiracisme réinvestit les races (contre les Blancs). Pourquoi ? Parce que l’universalité a été criminalisée comme une maladie du monde occidental, lui-même mis en accusation.
Ce nouveau pessimisme – en partie nihiliste – trouve son point d’orgue dans l’écologisme, nouvelle idole païenne des temps présents. Ainsi, « depuis le début du 21ème siècle, dans le monde occidental, c’est la sacralisation écologiste de la Nature qui est la principale pourvoyeuse de transcendance. » Le tout sur fond de catastrophisme. À ce titre, on aurait tort de qualifier les nouveaux partisans de l’écologisme de « progressistes ». Des grandes idéologies modernes (conservatisme, libéralisme, socialisme…), seuls le libéralisme et le socialisme sont des progressismes. L’écologisme appartient au conservatisme et, catastrophisme oblige, à un conservatisme autoritaire.
Nihilisme, déclin, décadence, décivilisation, retour du tragique ? Tout au long de son livre, Taguieff s’appuie sur différents penseurs (Spengler, Valéry, Aron, Freund, Chaunu, Onfray…) pour tenter d’appréhender notre réalité contemporaine. Une chose est sûre, la décadence est un sujet sérieux qu’il convient d’aborder autrement que sous la forme du slogan. D’abord en commençant par ne pas tout confondre : le déclin relève de la « mort naturelle », il est l’aboutissement logique de tout ce qui advient. La décadence relève de la « mort violente », il est un écroulement, une désintégration provoquée.
À travers d’autres ouvrages (L’Effacement de l’avenir, Le sens du progrès), Pierre-André Taguieff avait déjà indiqué la voie rationnelle qui lui semblait la moins dogmatique pour aborder la question du progrès et de la décadence, revers de la même médaille du temps considéré comme ligne droite : le « méliorisme ». Il s’agit de renvoyer dos à dos le progressisme fanatique (le progrès absolutisé) et l’anti-modernisme (le progrès comme décadence masquée), pour privilégier un progrès « volontaire », issu de la délibération collective et des aspirations communes. On conserve le progrès comme horizon, mais sous une forme désidéologisée.
Le méliorisme suppose d’abandonner la prétention à réaliser ici-bas l’idée de perfection, de se départir du constructivisme intégral (donc d’oublier l’idéologie de la table rase), d’accepter dans sa réalité imparfaite et ambivalente la nature humaine – serait-elle indéfinissable –, de renoncer au désir d’abolir toutes les limites de la condition humaine et de réinvestir le sens du tragique.


Poster un Commentaire