
Le photographe de l’agence Magnum, qui a grandi sans rien connaître de son histoire familiale, expose ses « voyages de mémoire » au Musée d’art et d’histoire du judaïsme.

D’une vie de non-dits, Patrick Zachmann a fait des photographies. Comme s’il avait voulu combler l’absence de mots et de récit familial par des images. « Le silence de mes parents m’a hanté, résume le photographe de l’agence Magnum. Toute ma vie, j’ai essayé de reconstituer l’album de famille que je n’ai jamais eu. »
Ce n’est donc pas étonnant si, après quarante ans de carrière, la vaste rétrospective qu’il présente au Musée d’art et d’histoire du judaïsme de Paris (auquel il a fait une donation de deux cents tirages) prend la forme d’une quête personnelle, et ce malgré la variété des sujets. Le spectateur le suit dans ses allers-retours sinueux entre l’intime et les autres, le proche et le lointain, les portraits familiaux et les reportages à l’étranger. Car toutes ses séries, parfois un peu à l’étroit dans l’espace tortueux du musée, pointent dans une même direction : une évocation sensible de la mémoire, la disparition, l’identité. « De toute façon, même quand on regarde ailleurs, on met toujours beaucoup de soi dans les images », confirme avec une voix douce le photographe de 66 ans, qui a écrit toutes les légendes à la première personne, et invite chacun dans sa quête artistique et personnelle.
Son enfance a été marquée par l’ignorance et le silence. Chez les Zachmann, on ne parle ni yiddish ni hébreu, on ne pratique pas la religion juive et on mange des plats français. Son père, juif polonais laïc dont les parents sont morts à Auschwitz, masque sous des blagues un traumatisme qui n’est jamais mentionné. Sa mère, juive algérienne qui ne rêve que d’ascension sociale, a mis un mouchoir sur son propre passé. « Ils se sont réunis sur la France, la République, en oubliant au passage de transmettre des racines : je ne savais rien de ce que voulait dire être juif. Mais on est toujours renvoyé à ça : on a une tête différente, un nom différent… »
Tatouage infamant
Le jeune photographe commencera par s’intéresser à ceux qui sont, pense-t-il, les plus loin de lui : les hassidim, les juifs orthodoxes, les juifs « visibles ». « Pour moi, les juifs, c’étaient eux, pas moi ! » En 1979, pour son premier reportage professionnel, il parvient à se faire accepter par des loubavitch, quand bien même il ne leur cache pas son athéisme. Et c’est là qu’il trouve son regard de photographe : ses images sont à la fois documentaires et personnelles, poétiques et traversées de pointes d’humour. Un poulet semble faire sa prière, le regard inquiet d’un enfant évoque des images du ghetto… « J’aime le côté inconscient de la photographie »,souligne Patrick Zachmann qui reconnaît le côté psychanalytique de l’entreprise.
Petit à petit, il élargit sa quête à d’autres communautés : au parc des Buttes-Chaumont, il se glisse parmi de vieux juifs ashkénazes qui parlent encore yiddish, toujours tirés à quatre épingles – ils travaillent pour la plupart dans la confection – , derniers représentants d’un monde en voie de disparition. Il est aussi témoin de la première réunion mondiale de rescapés de la Shoah, en 1981, en Israël. Il en tire des portraits graves, où l’émotion s’exprime dans les regards et sur ces bras dénudés qui brandissent le tatouage infamant.
Quarante ans après, certains survivants sont encore incapables de parler de ce qu’ils ont vécu, mais acceptent de poser pour lui : « La photo est silencieuse, et c’est sa force. » Et, finalement, Patrick Zachmann ira photographier des « juifs invisibles », à l’identité plus intérieure – et qui lui ressemblent. Un vieux couple d’anciens voisins, les Friedman, pose dans une image aussi drôle que touchante, l’épouse s’invite dans le cadre, à la grande fureur de son mari dont le visage dit toute la frustration.

Plus ou moins consciemment, c’est toujours autour de son propre passé qu’il tourne. « Il m’a fallu en passer par les autres avant d’affronter les miens. » Patrick Zachmann finit par prendre son histoire à bras-le-corps et interroger son père sur son passé tragique par le biais d’un film : La Mémoire de mon père, qui sortira en 1998, après la mort de celui-ci.Du côté maternel, c’est encore plus difficile : il attendra 2011, quand elle a 90 ans et que ses souvenirs s’évaporent, pour oser enfin boucler la boucle, et partir sur ses traces en faisant son voyage à l’envers, de la France vers l’Algérie. Le projet « Mare Mater » qu’il en tire élargit le propos bien au-delà de sa propre histoire, pour faire le lien avec d’autres histoires d’exil, d’autres portraits de mères aussi étouffantes qu’inconsolables.
Fantômes de la dictature
Entre ses travaux personnels et les reportages que le photographe a menés au cours de sa carrière professionnelle, la frontière est finalement ténue : « Je me suis intéressé aux gens dont les identités font écho à la mienne »,confirme le photographe. Parce qu’il partageait avec d’autres habitants de la planète une même histoire d’exil et de violence, il s’est penché sur les communautés immigrées, sur les disparus, les survivants, sur tous ceux à qui il a manqué, comme à lui, un morceau d’histoire, une racine, une sépulture.
Au Chili, il est parti en quête des fantômes de la dictature. Au Rwanda, il a interrogé les survivants du génocide, qui portent gravés dans le corps et dans la tête les stigmates de la tragédie. En Afrique du Sud, il a capté la haine des Afrikaners manifestant avec des drapeaux ornés d’une croix gammée. « J’espère bien que mes photos sont universelles », conclut le photographe. Qui s’est acharné à remplir les silences de son enfance avec ses images, mais aussi avec des mots. « Mon fils a été abreuvé de paroles, dit-il avec malice. Je crois bien que je l’ai saoulé ! »
« Voyages de mémoire », de Patrick Zachmann, au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 71, rue du Temple, Paris 3e. De 5 à 10 euros. Catalogue : 224 pages, coédition Mahj-Atelier EXB. Mahj.org.

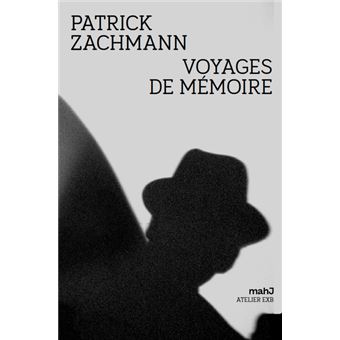
© Claire Guillot


Poster un Commentaire