
FIGAROVOX/TRIBUNE – Le philosophe participe à un colloque qui a lieu les 7 et 8 janvier 2022 sur la déconstruction. Il rappelle les origines de ce mouvement philosophique et dénonce ses dérives actuelles, qui selon lui, constituent une menace pour la civilisation occidentale.
L’idée de déconstruction, devenue rapidement vision idéologique et programme de travail sur les textes, s’est formée à partir des lectures françaises de Nietzche et surtout de Heidegger au cours des années 1960 et 1970. Le mot «Dé-construction» (avec la majuscule) a été forgé par Gérard Granel au milieu des années 1960 pour traduire le terme polysémique employé par Heidegger : Abbau, dans son essai «Contribution à la question de l’être» (Zur Seinsfrage, 1956), texte rédigé en 1955 en hommage à Ernst Jünger. Le mot Abbau avait été auparavant employé par Heidegger, notamment dans son cours de 1927, «Les Problèmes fondamentaux de la phénoménologie», pour désigner la «déconstruction critique des concepts reçus qui sont d’abord nécessairement en usage, afin de remonter aux sources où ils ont été puisés». Cette idée directrice était présente chez Edmund Husserl qui, dans le § 60 des Méditations cartésiennes (1929), critiquait la «métaphysique dénaturée au cours de l’histoire», et se proposait, par la phénoménologie, de retrouver ou de restaurer «le sens de ce qui fut à l’origine fondé comme une philosophie première», ainsi que le rappelle Derrida dans «La Voix et le phénomène» (1967).
C’est à la suite d’une rencontre avec Heidegger sur des questions de traduction de ses textes que Granel, comme il l’expliquera plus tard, a proposé le mot «dé-construction» pour «éviter “destruction” qui, même avec un tiret, renverrait à Zerstörung plutôt qu’à Abbau». Avant d’être publiée, la traduction par Granel du texte de Heidegger avait circulé dans les milieux heideggériens, et sa traduction d’Abbau par le mot «Dé-construction» avait retenu l’attention. Il a été aussitôt repris par Jacques Derrida, qui en a fait par la suite un drapeau. Au début de «De la grammatologie» – ouvrage publié en décembre 1967 – où il s’engage dans la déconstruction de l’«onto-théologie métaphysique» censée être propre à l’Occident, Derrida définit son geste comme «la destruction, non pas la démolition, mais la dé-sédimentation, la dé-construction de toutes les significations qui ont leur source dans celle du logos. En particulier la signification de vérité». Ce qui est visé, c’est ce qu’il appelle le «logocentrisme», cette «métaphysique de l’écriture phonétique» et, plus profondément, cette «ontologie qui, dans son cours le plus intérieur, a déterminé le sens de l’être comme présence et le sens du langage comme continuité pleine de la parole». L’objectif déclaré de l’ouvrage est de travailler à «l’ébranlement» de cette ontologie ou de cette «métaphysique de la présence» et de «rendre énigmatique ce que l’on croit entendre sous les noms de proximité, d’immédiateté, de présence». Et de préciser : «Cette déconstruction de la présence passe par celle de la conscience, donc par la notion irréductible de trace (Spur), telle qu’elle apparaît dans le discours nietzschéen comme dans le discours freudien».
Il faut pointer le grand malentendu sur la déconstruction : par son ambiguïté constitutive, l’entreprise derridienne, mi-philosophique mi-littéraire, située entre l’orthodoxie heideggérienne et l’avant-gardisme académique étatsunien, pouvait être mise à toutes les sauces, ce qui faisait croire à tous ceux qui s’en inspiraient qu’ils parvenaient ainsi aux sommets de l’inventivité intellectuelle, et, plus particulièrement, aux critiques littéraires qu’ils étaient devenus philosophes et aux heideggériens les plus compassés qu’ils dansaient avec la langue. Tous disciples néanmoins de Derrida, s’il est vrai que la formule synthétique des prétentions derridiennes est de marier la «profondeur» heideggérienne à la «légèreté» nietzschéenne. Mais aussi, d’une certaine manière, de jouer Nietzsche contre Heidegger.
La déconstruction semble toujours échapper aux définitions qu’on en donne. Dans «Force de loi» (1994), où ce qu’il appelle «l’exercice de la déconstruction» porte sur la justice, Derrida évoque les «recherches de style déconstructif» ou un «questionnement déconstructif», ou encore un «questionnement philosophico-déconstructif». Lectures, recherches, pratiques, discours, questionnements : la déconstruction est tout cela en même temps. Derrida ne recule pas devant la coquetterie provocatrice lorsqu’il écrit en 1985, dans sa Lettre à un ami japonais : «Ce que la déconstruction n’est pas ? mais tout ! Qu’est-ce que la déconstruction ? mais rien !» Disons plus simplement qu’elle est indéfinissable.
Ces interrogations, réserves, extensions, autocorrections indéfinies et tours de passe-passe n’ont nullement empêché la sloganisation de ce mot à la fois obscur, sonore et scintillant, outil privilégié d’un nouveau pédantisme à la portée de tous. La déconstruction est ainsi devenue une clé universelle en même temps qu’un tribunal devant lequel sont convoqués tous les grands penseurs de l’histoire européenne, mais aussi toutes les composantes de la civilisation occidentale.
Dans le paysage déconstructionniste contemporain, on observe un certain nombre de tendances et d’orientations politico-intellectuelles, associées à des groupes formés autour de maîtres à penser et à parler, grands et petits. Simplifions grossièrement le tableau en distinguant, d’une part, la déconstruction du discours philosophique et politique occidental, qui suppose des analyses critiques sophistiquées conduites par des universitaires restant ou non dans leurs domaines de compétence respectifs (philosophie, sociologie, anthropologie, histoire, science politique, études littéraires, etc.), et, d’autre part, les politiques de la déconstruction menées par des intellectuels engagés, qui, puisant leurs thèmes et leurs arguments dans diverses disciplines, prétendent accomplir une critique radicale des sociétés occidentales dans tous leurs aspects, en vue d’une transformation globale prenant la relève des utopies révolutionnaires modernes.
Il est clair que seule la civilisation occidentale fait l’objet des activités déconstructrices, qu’elles s’attaquent à des formes discursives jugées trompeuses ou à des ordres sociopolitiques jugés injustes ou inégalitaires. Incarnation supposée de la volonté de puissance et de domination, matrice désignée de l’exploitation capitaliste et de l’impérialisme colonial, le monde occidental est traité par les déconstructeurs comme l’ennemi absolu. La déconstruction est l’arme intellectuelle censée permettre de dévoiler l’insoutenable face cachée de l’Occident, à savoir son racisme et son sexisme, considérés comme ses héritages culturels à dénoncer, en attendant de les abolir. La conclusion logique du déconstructionnisme est qu’il faut en finir avec la civilisation occidentale.
La mode déconstructionniste a eu notamment pour effet de stériliser la pensée philosophique en France, en la réduisant à l’imitation pieuse des écrits de Jacques Derrida et de ses disciples immédiats, comme Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe. Cette mode intellectuelle et langagière présente quatre traits distinctifs : sa longue durée, sa force d’intimidation, sa vitesse de propagation internationale et sa traduction en une vulgate dont les variantes se rencontrent dans des domaines extrêmement divers, de l’art contemporain à la pédagogie, de l’antiracisme et du néo-féminisme au discours publicitaire et à la propagande politique. Le mot d’ordre des déconstructeurs est simple : tout peut et doit être déconstruit. Mais il est trompeur, car seule la culture occidentale fait l’objet d’une déconstruction systématique. Il n’est pas question, par exemple, de déconstruire le «ressenti» victimaire des catégories sociales dites minoritaires, dominées ou racisées. Criminalisé et diabolisé dans toutes ses composantes, le monde occidental est voué à être démoli, mis en pièces, pour être remplacé par un monde meilleur qui n’est guère défini que par la négation de tout ce qu’est l’Occident aux yeux de ses ennemis.
L’intimidation heideggéro-derridienne a eu pour résultat d’imposer un lexique et une rhétorique qui, en bloquant la pensée libre ou créatrice, n’a fourni que des signes d’appartenance à une secte intellectuelle internationale et, partant, des signes de reconnaissance entre membres de ladite secte, politiquement situés à l’extrême gauche, qu’ils se disent marxistes ou non. La pensée critique et démystificatrice, issue des Lumières, s’est transformée en pratique déconstructrice, dont le premier geste est de s’attaquer au «logocentrisme» et au «phallogocentrisme», les exigences de rationalité et d’universalité étant réduites à l’expression d’une volonté de domination sans pareille elle-même rapportée à l’abominable «système hétéro-patriarcal» dont nous sommes censés voir les méfaits tous les jours.
L’extension sans fin du champ des objets à déconstruire constitue l’un des traits de la pratique déconstructionniste. Dans «Force de loi» (1994), Derrida ajoute la question animale et part en guerre contre le «carno-phallogocentrisme», venant donner une caution philosophique à l’antispécisme (extension de l’antiracisme) et à l’animalisme, conclusion logique de l’anti-humanisme théorique. Il s’agit selon lui de «déconstruire les partitions qui instituent le sujet humain (de préférence et paradigmatiquement le mâle adulte, plutôt que la femme, l’enfant ou l’animal) en mesure du juste et de l’injuste». La décentration et la déconstruction doivent se poursuivre dans l’espace tout entier du monde vivant.
Les déconstructeurs militants en sont venus à s’attaquer au «leucocentrisme» (de «leukós», « blanc »), en dénonçant le «privilège blanc» et en appelant à «déconstruire l’innocence blanche». La leucophobie s’est installée dans le discours politiquement correct qu’est l’antiracisme racialiste. Une croisade idéologique a été lancée par les «féministes noires» états-uniennes contre le «savoir eurocentrique et androcentrique» et plus largement contre l’«androcentrisme blanc», désignant «la procédure de validation du savoir contrôlée par les hommes blancs et dont le but est de représenter le point de vue blanc et masculin» (Patricia Hill Collins, 1989). Tel qu’il est dénoncé, le «x-centrisme» vise toujours et seulement l’homme occidental (le mâle blanc) intrinsèquement phallocentrique ainsi que son logocentrisme (ou son rationalisme), son humanisme paternaliste et son universalisme suspect, censés dissimuler son impérialisme, son nationalisme, son sexisme et son racisme.
Les nouveaux précieux et les nouveaux pédants à visage radical se sont donc installés sur les terres de la déconstruction en même temps que sur celles de la révolution. Je dirai, pour paraphraser librement Pascal, que, depuis la fin des années 1960, les heideggéro-derridiens ne s’imaginent pouvoir philosopher «qu’avec de grandes robes de pédants» et que, lorsqu’ils se risquent à écrire sur la politique, ils entrent volontairement dans cet «hôpital de fous» qu’est le jeu politique, pour devenir fous parmi les fous – la prétention, la préciosité et le pédantisme en plus. Le mouvement «woke» est issu de ce long moment déconstructionniste politisé qui dure depuis plus d’un demi-siècle et a conduit, dans l’enseignement supérieur, à multiplier les «studies» (Black Studies, Queer Studies, Gender Studies, etc.), lesquelles permettent aux activistes de prendre d’assaut les universités et d’occuper le terrain académique.
Quel est le sens du mot «déconstruction» dans l’usage courant depuis le début des années 2010 en France ? «Déconstruction» signifie simplement «analyse critique à visée démystificatrice» comme dans les appels à «déconstruire les stéréotypes et les préjugés» (de race, de sexe, de genre, etc.) pour «lutter contre les discriminations». Dans le discours pédagogique ordinaire, l’esprit critique est censé s’exercer désormais par la «déconstruction», mot magique. Il en va de même dans le discours politique des gauches ralliées au décolonialisme et à l’éco-féminisme. C’est ainsi que, dans ces emplois du mot «déconstruction», l’esprit critique se retourne contre lui-même. Les origines heideggéro-derridiennes du terme ont été oubliées, et les nouveaux locuteurs, du moins pour la plupart d’entre eux, les ignorent. En sortant de l’espace universitaire, le mot «déconstruction» a donc changé de sens. En déconstruisant tout ce qu’ils perçoivent comme politiquement ou moralement incorrect, les nouveaux déconstructeurs militants sont convaincus d’être «progressistes». Mais le mot «progressisme» a lui-même changé de sens : privé de ses fondements rationalistes et de ses horizons universalistes, il désigne simplement la posture idéologico-politique qui prétend incarner le Bien, à savoir l’engagement à gauche ou à l’extrême gauche, défini par son objectif claironné : le combat pour l’égalité et la justice.
On peut y voir la dernière version en date de la grande illusion communiste. Il faut rappeler que l’imposture criminelle qu’est le communisme, qui a toujours ses adeptes, ses militants et ses apologètes, tenait sa séduction de ce qu’elle avançait sous le drapeau du «progressisme» et promettait de réaliser universellement l’égalité des conditions après la destruction de la société capitaliste. L’utopie égalitaire s’est redéfinie à travers le «wokisme», nouvelle figure de l’égalitarisme radical marié à l’étrange haine de soi cultivée par les intellectuels occidentaux. Il ne s’agit plus seulement d’en finir avec le capitalisme, il faut détruire la civilisation occidentale en commençant par criminaliser son passé tout entier et rejeter en conséquence tous ses héritages. La destruction de la langue par l’écriture inclusive fait partie de ce programme de décivilisation vertuiste. Il y a là un appel à un ethnocide de grande ampleur. Du pédantisme déconstructionniste plus ou moins ludique est né ce monstre qu’est le «wokisme», conformisme conquérant qui semble marquer l’émergence d’un nouvel esprit totalitaire.
© Pierre-André Taguieff
Directeur de recherche honoraire au CNRS, Pierre-André Taguieff est philosophe, politiste et historien des idées. Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, il a récemment publié Les nietzschéens et leurs ennemis. Pour, avec et contre Nietzsche aux Éditions du Cerf.
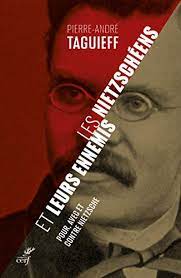


La radicalisation des universités occidentales tombées aux mains de fascistes et d’ignares est le signe d’une mort civilisationnelle de l’Amérique du Nord et de l’Europe de l’ouest qui est désormais irrémédiable. Un Japonais vivant en France effrayé par ce qui se passait en 2020 (BLM) écrivait qu’il avait l’impression d’assister en direct à la mort de l’Occident. Pierre André Taguieff aurait pu aussi citer l’influence particulièrement délétère de l’ignoble JPSartre qui est également devenu une grande source d’inspiration pour les obscurantistes woke et indigénistes.
A Sylvain. Vous dites :
….le signe d’une mort civilisationnelle de l’Amérique du Nord et de l’Europe de l’ouest qui est désormais irrémédiable…
Tout désespoir en politique est une sottise absolue. ( Maurras ne disait pas que de dangereuses insanités).
@joseph Mon pessimisme absolu se base sur une analyse en profondeur. Je reconnais que mon vécu personnel (hard) ne me rend pas enclin à croire en l’être humain mais il existe de nombreuses données objectives qui amènent toutes à cette conclusion. Cordialement.