
A l’occasion du premier Podcast de K., rencontre avec Joann Sfar, qui nous devait bien quelques explications concernant le titre de son dernier roman : Le dernier Juif d’Europe…
Portrait
Joann Sfar rappelle qu’il est avant tout un dessinateur, et que du dessin naissent ses récits et ses perspectives. « Le dessin est une science humaine ». Les techniques d’observation du dessin engendrent une connaissance du monde, des hommes et des choses, fondée paradoxalement sur la capture d’un rythme. Il ne s’agit pas de musique et pourtant, dessinant, il faut représenter ce que l’on voit avec une certaine justesse de ton, il faut regarder ce qui anime les êtres. Si nous partons de ce point, c’est parce que Joann Sfar est lui-même avant tout un rythme, de vie, de création et de parole. Comme l‘on s’en apercevra dans l’entretien qu’il nous a accordé.
Nous pensions commencer par l’énumération de ce que Sfar fait, mais comme il y a mille choses – de la bande dessinée au cinéma, en passant par le roman – et qu’on ne pourra pas être exhaustif, il est peut-être plus adéquat d’imaginer son portrait à partir de cette cadence inextinguible, et comprendre sa source d’inspiration intarissable. Un peu comme un passage de livre d’Albert Cohen, dans lequel il n’y a pas de point pendant cinquante pages, Joann Sfar raconte sans cesse des histoires qui puisent dans la synagogue, l’histoire de l’art, la littérature (juive ou non, et antisémite aussi, il aime Céline – ce sont des choses qui arrivent), la philosophie (de Clément Rosset), les états d’âme félins et la tératologie. Ou alors comme dans un tableau de Chagall (à qui il a consacré une bande-dessinée), nous imaginons Joann Sfar, carnet en main, en train de survoler plusieurs villes réunies, Nice, Sétif en Algérie, et un shtetl en Ukraine ; en bas à droite, il y aurait des musiciens de Klezmer et de jazz manouche, à gauche on mettrait un chat qui lit le talmud à un lion, il faudrait au centre une petite datcha avec des palmiers autours, nommée la boule rouge, et puis en arrière-plan, un cimetière avec des dibbouks et des vampires sympathiques. Ce serait très coloré, sans lien de cause à effet, donc joyeux et libre.

La créativité de Joann Sfar est issue de ce cheminement surréaliste, un peu nostalgique – mais il ne le dira pas, parce que la nostalgie suppose une part de retrait de soi dans le passé. Tout est présent simultanément, les morts et les vivants, et donc la dimension tragique de l’existence est toujours déjà consommée. Une fois ceci intégré, il n’y plus de raison d’avoir peur de s’exprimer, et de représenter les « aberrations ordinaires » de l’époque. Nous l’avons justement rencontré pour parler de cela. Se résoudre à un pessimisme tragique n’empêche pas de s’inquiéter profondément, de l’antisémitisme, par exemple. Seulement, comment en parler ? Et pourquoi s’interroger sur la manière d’en parler ? Il n’aura échappé à personne que les figures de l’antisémitisme se sont renouvelées, et que les anciennes critiques de l’antisémitisme non seulement ne fonctionnent plus tellement, mais en outre dans le marasme de la concurrence des mémoires, ne sont plus supportées.
Les récits de Joann Sfar ne revendiquent pas mais nous transportent, ici dans la vie juive d’Algérie, là dans un monde souterrain fantastique où se jouent les enjeux inconscients du monde terrestre – et nous donnent aussi une perspective sur l’actualité. Le voyage plutôt que d’emblée une satire, ou un engagement politique. De sorte que le discours de Sfar forge des contenus imaginaires qui distraient un peu de la réalité polémique – tout en y remédiant. A la manière de Sempé, dont l’ambition est de capturer en un minimum de traits possibles les sentiments des gens et des lieux, Sfar saisit lui les crispations de l’actualité, avec justesse et humour. C’est un genre de dessin qui a le pouvoir de renverser les fausses prétentions, des politiques par exemple, mais aussi de briser les idoles. C’est aussi la transgression la plus morale possible de l’interdit juif de la représentation, précisément formulé pour éviter l’idolâtrie. Un art dialectique en somme, que l’on retrouve dans la manière d’aborder les histoires juives.
Dans le tome 9 du Chat du rabbin, une bulle dit justement : « C’est bon, revenez ! Ce n’est pas une histoire de juifs ! ». A l’image de l’histoire du canari que l’on emmenait dans les mines de charbon pour être prévenu d’un danger, si on le voyait s’évanouir, les histoires de juifs ne sont pas présentées comme concernant (seulement) les juifs. Il ne s’agit pas non plus d’une curiosité anthropologique, comment vivent-ils, que mangent-ils, quelle est leur conception du monde et quelle est leur recette du panier aux amandes, veulent-ils dominer le monde ou marier leur fille ? Ces questions mises à part, les récits d’histoires juives-non-juives sont des aventures qui illustrent de manière condensée comment les aléas de l’Histoire sont absorbés, détournés, remaniés, avec un peu de sagesse populaire et quelques névroses utiles. Tout ceci pour continuer à exister, et avoir sa part de soleil, à Sétif, dans un kibboutz, ou une maison hantée de Nice. Dans Le dernier Juif d’Europe, qui n’est pas (seulement) une histoire juive non plus, l’angoisse du dessinateur Joann Sfar prend une autre tournure. Les dernières années en France n’augurent rien de très bon, et devant une nouvelle vague d’antisémitisme, le gouvernail doit trouver une direction inédite. Joann Sfar conjure l’angoisse avec des pouvoirs magiques, que nous n’avons pas hélas. Mais peut-être suffit-il de le faire croire.

Texte
Une grande partie du long entretien de 52 minutes qui figure sur le podcast peut être lue ci-dessous dans une version retranscrite.
Avishag Zafrani : Votre roman, Le dernier Juif d’Europe, reprend les aventures d’un vampire juif ukrainien, violoniste mort au combat en 1917 qu’on avait déjà vu dans un de vos précédent roman l’Éternel. Mais cette fois-ci, il réapparaît dans une France actuelle qui est traversée par de graves conflits sociaux et qui connaît une nouvelle vague d’antisémitisme. Il va croiser deux personnages, un père et son fils, François et Désiré Abergel. Ceux-ci vont symboliser les « derniers juifs d’Europe ». Désiré, en particulier, souhaite ne plus être juif et même devenir antisémite pour voir ce que cela fait. Avant de revenir sur son parcours étrange et un peu contradictoire, et avant de parler aussi des autres personnages, dont une rabbine laïque, une psychanalyste mystique, au milieu d’un monde qui mélange les morts et les vivants, je voudrais tout d’abord vous interroger sur le titre de l’ouvrage. On aurait pu s’attendre à lire une variation sur le thème courant de la disparition des juifs dans un région particulière (comme lorsqu’on parle des derniers juifs de Pologne, des derniers juifs du Maroc ou du dernier juif d’Afghanistan qui s’occupe tout seul de sa synagogue). Dans votre roman, on n’a pas l’impression que ce soit ce dont il s’agit. Il s’agit même plutôt que vous travaillez le thème de la disparition de l’antisémitisme. Est-ce que l’idée de « derniers Juifs » a été motivée par une inquiétude, une angoisse profonde ?
Joann Sfar : … Et d’une colère. Au-delà même du contenu du livre, il y a une part colérique de moi qui avait envie de remplir les librairies d’un ouvrage avec marqué « le dernier juif d’Europe ». Avant même d’écrire une ligne, j’avais envie de ça. J’ai tout à fait conscience du fait que si j’avais fait un ouvrage à couverture blanche avec uniquement marqué « le dernier juif d’Europe », on l’aurait étudié comme un sujet sérieux ou universitaire ou polémique. Le simple fait que ce soit un ouvrage de divertissement avec des monstres et qu’il y ait un vampire sur la couverture, on est déjà en train de relativiser ou de se demander ce que j’ai voulu dire. Et à l’intérieur de l’ouvrage, on retrouve effectivement la renaissance de l’envie finalement la plus répandue en Europe et dans le monde : celle de massacrer les Juifs. Depuis que les Juifs existent, à chaque génération se réinvente une façon de les haïr. Ce qui est assez intéressant, c’est que d’une génération à l’autre, on leur reproche une chose ou son contraire. Parfois, on leur reproche d’être trop croyants. Parfois, on leur reproche d’être trop laïques. Parfois, on leur reproche de ne pas comprendre les nouvelles idées, parfois de les avoir produites.
AZ : Mais revenons au titre…
JS : Dans Le dernier juif d’Europe, notre héros, est très embêté parce que son père veut se faire remettre le prépuce. Et si son père se fait remettre le prépuce, il va se retrouver, lui, à être le dernier juif de la famille. Et il y a là peut-être, une mise en abyme du drame de notre génération, c’est-à-dire que nous héritons tous d’une tradition historique et religieuse assez lourde de nos parents. On s’en retrouve dépositaire et on ne sait pas très bien ce qu’on doit en faire…
J’ai beaucoup grandi, comme beaucoup de Juifs de ma génération, avec la culpabilité de ne pas être parti en Israël.
Mon inquiétude et ma colère, en fait, proviennent de plusieurs choses : tout d’abord, j’ai la terreur de la disparition d’une vie culturelle, d’une vie intellectuelle juive européenne. Je distingue cela d’une présence des Juifs en Europe. Est-ce qu’il y a des Juifs qui sont assez épanouis ou assez heureux en Europe pour projeter leur voix dans la polyphonie du débat, pour projeter leur voix en tant que Juif. Pas en tant que Juifs fermés sur eux-mêmes, pas en tant que Juifs qui voient leur avenir en Israël, ou en tant que Juifs qui se projettent toujours ailleurs que là où ils sont. Si je voulais être débile, je parlerais des Juifs de l’être-là, pour marquer ce moment où on se retrouve là, à un endroit, quelque part où l’on se dit que ça a un sens.
J’ai beaucoup grandi, comme beaucoup de Juifs de ma génération, avec la culpabilité de ne pas être parti en Israël. Mon père, très petit, dès l’âge de 6-7 ans, nous a préparés à notre alya – qu’on n’a jamais faite. Il a acheté un appartement en Israël ; il l’a revendu trois ans après. Une partie de ma famille est partie, mais pas nous. C’était vécu à chaque fois comme un échec. Mais je refuse de voir mon destin et de voir le destin des Juifs en Europe comme un échec ou comme un non-choix ou comme quoi que ce soit. En revanche, je ne peux pas ne pas voir que lorsque j’étais enfant, la vie culturelle européenne, et singulièrement la vie culturelle française, était modelée par des penseurs, juifs, qui pensaient parfois contre la religion, qui pensaient parfois contre leur histoire, mais qui tout de même étaient très présents, qui étaient conscients de leur héritage et qui étaient –alors ça, c’est mon tropisme personnel – et qui allaient dans le sens du progrès. Si je voulais être provocant, je dirais qu’à chaque fois qu’on a aboli la peine de mort, il y a un Juif derrière.
On se trouve aujourd’hui avec – et j’espère que ça va changer, j’espère que mon livre n’est qu’un ouvrage de Cassandre – une parole juive moribonde en Europe, c’est-à-dire que les seuls intellectuels Juifs qu’on est capable de nommer, ce sont des gens qui, au mieux, sont dans la réaction et au pire, sont à l’extrême droite. En tout cas, on a l’impression de personnes âgées qui yoyottent. J’ai l’impression que même la parole religieuse, ce n’est pas en Europe qu’on l’entend le plus. Il y a un vide, une absence. Le projet juif au XXe siècle a été double. Il y a eu d’un côté la fascination sioniste, l’envie de créer un pays où ça se passerait mieux qu’ailleurs. Et c’est un très beau choix, il est très noble. Et de l’autre côté, il y a eu le Bund. La voix juive, c’est aussi une voix de la polyphonie européenne. Il faut qu’on puisse l’entendre, même indépendamment du religieux. Et il faut des représentants de la voix juive en Europe, de la même manière que tous les peuples européens en ont. Dans cette réalité, les Juifs ont quelque chose à dire.
Bon, à vrai dire, je ne sais pas où on en est aujourd’hui. J’y réponds avec des histoires de vampires. J’y réponds avec mes petites angoisses. C’est marrant parce que pour Le chat du rabbin, j’ai beaucoup le nez dans la Bible en ce moment, dans le prophète Élie particulièrement, au moment où il s’énerve et où il reproche aux Israélites de claudiquer sur deux pieds, un pied qui croit en Baal et l’autre qui croit en l’Éternel. Et je dois dire que dans mon travail, il y a un peu de ça, c’est-à-dire que je ne me résous pas à faire un livre totalement sérieux et totalement impliqué. Il faut toujours que je mette des conneries toutes les dix lignes… D’abord parce que je crois qu’on transmet les choses par le jeu et ensuite, parce que j’ai une difficulté avec le sérieux, ou plutôt avec l’idée de l’auteur qui est persuadé de servir à quelque chose. La littérature n’est pas là pour dire la vertu. La littérature est là pour nous montrer les tréfonds de l’âme humaine, parfois dans ce qu’elle a de pire. S’il y a une valeur dans cet ouvrage, c’est la verbalisation de mes angoisses.
Je raconte une scène dans mon livre que je n’ai pas inventée. Je me suis trouvé un soir à table avec une grande figure du judaïsme contemporain qui est un type formidable, industriel, brillant, actif dans la société française depuis toujours. Il y a dû avoir une vieille dame juive de trop jetée par une fenêtre. Je ne sais plus laquelle… Il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Et il a dit « Écoute, j’en ai marre, j’en ai marre. Parfois, on a envie de leur rendre, tout ça. Le judaïsme, vous en voulez ? Prenez-le, voilà. Je me fais dé-circoncire et démerdez-vous. Et comme ça, on va voir contre qui vous allez vous énerver. ». Et ça, je me suis dit, c’est une idée à la Gogol ou à la Kafka, ou c’est une idée de théâtre : le Juif qui veut se refaire remettre le prépuce. Et évidemment, comme dans une histoire drôle, à l’instant où il s’est fait remettre le prépuce, il veut devenir antisémite…
AZ : Le passage où Désiré Abergel décide de devenir antisémite et bénéficie des dernières avancées chirurgicales pour se faire remettre le prépuce est en même temps très drôle et glaçant. On a l’impression, que Désiré Abergel n’en peut plus, il sature. Peut-être que lui-même a combattu l’antisémitisme dans le passé, et qu’il y a cru à ce combat mais c’est fini. La situation le dépasse, il est submergé. Il va essayer d’être antisémite avec l’idée que cela le soulagera : il faut dire que c’est pratique quand on est antisémite, on a trouvé les coupables de pas mal de maux de l’existence, ce qui doit donc être apaisant… Mais cette haine de soi du personnage est ponctuelle, elle ne fonctionne pas tellement. Son fils François, qui devient le dernier Juif de sa famille, doit porter sur lui la responsabilité d’apaiser le désespoir de son père ou de le protéger du désespoir. Il doit le sauver de quelque chose…
JS : Oui, et puis, il y a le rapport aux organes génitaux… Le rapport aux parties génitales paternelles, chez moi, il est fondateur. Je le raconte à la fin du Chat du rabbin. Mon père, qui a toujours été un type extrêmement militant, violent, combattant, est le premier avocat qui a fait foutre en prison des néonazis dans les années 70. Il a vécu sous la menace des cercueils et des coups de fil la nuit. Il faisait le coup de poing dès qu’il fallait. C’était aussi un type très impressionnant qui était écrasé de culpabilité d’avoir été un juif d’Algérie qui n’a pas été déporté et qui n’a pas pu se battre contre Hitler. Donc, il m’a mis au monde pour que je me batte contre Hitler, qui n’était plus là. Moyennant quoi, j’ai dû passer des années à monter la garde devant la synagogue de Nice et Hitler n’est jamais arrivé.
Mon père m’a mis au monde pour que je me batte contre Hitler, qui n’était plus là. Moyennant quoi, j’ai dû passer des années à monter la garde devant la synagogue de Nice et Hitler n’est jamais arrivé.
À l’âge de 7 ans, il m’emmène à Yad Vashem avec mon grand-père maternel qui, lui, a combattu et dont toute la famille a été exterminée dans la Shoah par balles. Il s’est retrouvé bien avant ça en France, ce qui l’a sauvé. Il est entré dans le maquis très tôt. Il a été un des quatre ou cinq médecins de la brigade Alsace-Lorraine. Ce qui fait que sa guerre a consisté, quand il avançait en Allemagne, à tirer sur les Allemands un jour et à les raccommoder le lendemain, puisqu’il était le médecin. Il disait : « la guerre, c’est absurde, tu tires sur un type et puis tu le raccommodes… ». J’ai donc ces deux bonhommes qui m’emmènent à Yad Vashem. Mon père, devant les photos de déportés, me dit : « tu vois, Hitler a essayé de nous exterminer, il faut que tu fasses plein d’enfants juifs pour montrer qu’il a perdu ». La phrase a mis mon grand-père très en colère, lui qui cherchait sa famille dans les noms de déportés. Il a dit « Explique à ton père que tes parties génitales ne servent pas à combattre Hitler ». Cette idée se retrouve dans le livre, puisque non seulement mon personnage s’est fait remettre le prépuce, mais après qu’il se soit fait remettre le prépuce, lors d’une manifestation anti-juive, il veut absolument enlever son pantalon pour expliquer à tout le monde qu’il n’est pas juif.
C’est quand même extraordinaire l’époque qu’a vécue mon père, parce que les antisémites, c’était l’extrême droite. C’était formidable ! Moi, à chaque fois que je me suis bagarré avec des skinheads, j’étais très, très content. Je savais que j’étais dans le camp qu’il fallait. Maintenant, les antisémites, ça peut être tout le monde… Je ne dis pas ça par parano. J’ai vécu le moment où, il y a 20 ou 25 ans, dans les radios juives, on incitait les Juifs à dire s’ils avaient vécu des actes antisémites. Ensuite, j’ai vécu l’inverse. Aujourd’hui, on sait que tout acte antisémite en suscite d’autres. À l’issue des tueries de l’école Ozar HaTorah, le cimetière où est ma maman à Nice a été profané. D’autres écoles ont reçu des lettres d’insultes, etc. Aujourd’hui, on a une tendance à taire ces actes de violence parce qu’on sait qu’on ne parviendra pas à les arrêter. Et on est dans une situation totalement inédite : traditionnellement, la haine des juifs depuis le Moyen-Âge, était un outil des gouvernants pour acheter la paix civile. Là, on est dans un monde complètement nouveau où les pouvoirs publics défendent les juifs. On est dans un monde où les pouvoirs publics font de leur mieux pour éviter ce massacre que la population, inconsciemment, pour toutes les raisons psychiatriques, appelle de ses vœux. C’est ce que je raconte dans mon livre : l’antisémitisme est devenu aujourd’hui un objet consensuel.
Ce que j’essaye de raconter dans ce livre plein de monstres, c’est que la haine du Juif ne pourra se combattre que sur le terrain magique, puisque c’est une haine magique, puisque c’est une haine qui remonte peut-être à l’empereur Nemrod. On va la combattre en convoquant les mêmes divinités que dans la Bible, et ce sera Baal et Astarté et tout ce qu’on veut…
AZ : Vous trouvez des manières de raconter l’antisémitisme qui changent par rapport à ce que l’on l’entend habituellement. La situation est aberrante : tout le monde est bien sûr capable de dire à quel point c’est terrible et dramatique que des enfants juifs soient tués ; et en même temps, les Juifs ont le sentiment, sans doute à raison, qu’on ne veut pas les entendre se plaindre de l’antisémitisme. Cela produit une réalité littéralement absurde que votre roman raconte très bien…
JS : Dans les années 30, on pouvait manifester en disant « sale juif ». Aujourd’hui, ce n’est plus acceptable. Donc on manifeste désormais en disant « sale juif ! Nous ne sommes pas antisémites ». Ce slogan anti-juifs pendant la manifestation racontée dans mon roman est ce qui m’a fait le plus rire en l’écrivant. Et je crois d‘ailleurs que c’est le cœur du livre… Les cris d’orfraie que j’entends, face à des manifestations qui ne relèvent de rien d’autre que de l’antisémitisme, venant de gens qui ont le cœur sur la main et disent : « Non, mais comment tu peux imaginer ? Mais comment oses-tu, nous antisémites ? » Ah bon ? Mais quand vous hurliez contre les Rothschild toutes les deux minutes, qu’est-ce que ça veut dire ? Vous les connaissez, les Rothschild ? Quand vous parlez de machin apatride, vous vous rendez compte de la phraséologie ? Ce n’est pas possible que les gens ne se rendent pas compte. C’est comme quand un gosse a renversé quelque chose et qu’il dit : « c’est pas moi qui l’ai fait ». Donc quand quelqu’un, le cœur sur la main, vous dit « je ne suis pas antisémite », il y a la même rage dans ce « je ne suis pas antisémite » que dans le « sale juif ».
Dans les années 30, on pouvait manifester en disant « sale juif ». Aujourd’hui, ce n’est plus acceptable. Donc on manifeste désormais en disant « sale juif ! Nous ne sommes pas antisémites ».
J’essaie de faire de l’hyperréalisme, et il faut des outils monstrueux pour faire comprendre, pour faire le coup de poing… Nous vivons dans un univers où les informations, chaque jour, amènent tellement d’étrangeté, de révolte, de bizarrerie qu’on est même plus en train de se demander si c’est normal, comment on va faire, comment se positionner, où on est une population abrutie à coups de bâton tous les jours par de nouvelles réalités qui nous dépassent. Il a fallu s’habituer en très peu d’années à voir des gens décapités dans nos rues, à voir un virus qui perturbe la manière de vivre de la planète entière, à rencontrer des gens qui ont la certitude que des élections d’une démocratie comme les Etats-Unis ont été manipulées par une puissance comme la Russie, etc. On s’habitue à des choses comme ça. On s’habitue aussi à des inventions scientifiques qu’on n’a pas le temps d’intégrer avant qu’on nous dise qu’elles sont néfastes. Cela crée un retour brutal vers un sentiment que l’individu est une toute petite créature que tout dépasse et qui, à part sa colère, n’a pas grand-chose à dire. Maintenant, même en France, on est face à une population dont le seul canal d’expression est le hurlement public, la manifestation publique dans laquelle on va montrer le plus de violence possible…
AZ : Dans votre livre, il y a un passage très intéressant, et osé : le long monologue d’un gilet jaune. Vous y montrez la difficulté de saisir un discours qui est plein de revendications légitimes, puisqu’il est question de conflits sociaux, de misère économique. Et puis vous montrez comment tout se passe comme s’il y avait une espèce de relâchement pulsionnel. Quelque chose d’hyper archaïque remonte à la surface qui se transforme en sortie raciste, homophobe ou antisémite. Il y a une colère qui est tout à fait légitime, qui pourrait très bien se passer de cette couche de ressentiment désorienté. Comment se fait-il qu’il semble malgré inévitable, pour vous, que ce ressentiment accompagne cette colère ?
J.S : C’est cette fameuse ignorance bruyante dont parlait le philosophe Clément Rosset. Il disait « dès qu’on approfondit, on quitte le réel ». La fausse certitude actuelle est la suivante : tous nos contemporains sont persuadés que leurs opinions sont nourries au coin du bon sens, de la logique, d’un raisonnement. En réalité, on est submergé d’émotions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, et on exprime ses émotions comme on peut, par un cri… Et on finit toujours, puisqu’il est question d’injustice et de colère, par vouloir mettre un visage sur le responsable de cette colère. Évidemment, l’erreur se trouve là. La chose que personne n’est en état d’entendre, parce que c’est la permanence tragique est que depuis l’Antiquité, c’est insupportable, c’est que les forces qui nous écrasent sont aveugles. Que font les gens qui, depuis quelques années, ont cette haine sanguinaire contre le président de la République française, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron, qui sont quand même les trois types les plus différents qu’on puisse imaginer ?
Cette haine-là, c’est la certitude qu’en France, le président est capable de quelque chose. Pour avoir dîné deux fois avec François Hollande, je peux vous promettre que s’il avait le pouvoir de quoi que ce soit, ça se serait su. J’aime beaucoup la façon dont il le dit, par une phrase très drôle : « Vous savez, à chaque fois qu’un de mes collègues prend le micro et dit nous sommes déterminés, c’est qu’il n’a pas la moindre idée de ce qu’il va faire ». Et je crois que la population souffre tellement et pour des motifs légitimes, qu’elle n’est pas en mesure d’entendre qu’il n’y a pas de visage, qu’il n’y a pas un ennemi, qu’il n’y a pas un complot, qu’il n’y a pas des gens qui se sont réunis pour que ça aille mal pour eux. Ce serait tellement facile et malheureusement, il n’y a rien de tout ça.
J’ai vécu une mésaventure. J’aurais mieux fait de fermer ma gueule… À chaque fois que je parle sur les réseaux sociaux, je me dis que j’aurais mieux fait de me taire. Au moment des plus grandes manifestations des gilets jaunes, le jour ou la veille de la plus grande manifestation, on trouve une étoile de David et un truc marqué juif sur la devanture d’un magasin. J’ai eu le malheur de faire un texte en disant : « ça, ce n’est pas acceptable ». J’ai reçu des lettres de la France entière en me disant que je transmettais des fake news, que cette étoile juive n’avait pas du tout été peinte sur le trajet de la manifestation ou qu’elle avait été faite quelques heures avant. On s’imagine que, dans le contexte où la France entière débarque à Paris avec des pots de peinture, une étoile jaune est faite sur le parcours de la manifestation mais sans aucun lien avec elle… Tout ça n’existe donc pas. Seulement l’idée que j’ai répandu une fake news en essayant de jeter l’opprobre sur un mouvement. Je ne mets pas en cause la légitimité de tous les mouvements de colère.
Ma seule préoccupation un peu atavique, c’est de me demander si est-ce que ce coup-ci on va nous couper la tête ou pas ? Alors effectivement, ça colore mon jugement politique. C’était très simple quand j’étais enfant, de croire que la haine des Juifs venait uniquement de l’extrême droite. Bon, ce n’est plus le cas aujourd’hui et c’est dommage parce que c’est toujours beaucoup plus sexy de s’en prendre à un skinhead que de s’en prendre à une personne qui a toute la légitimité d’être en colère du fait de son histoire ou d’autre chose.

AZ : Et vous vous en sortez par l’usage, précisément, des monstres pour essayer de résoudre cette énigme de l’antisémitisme, qui dure depuis si longtemps. En lisant le roman, on a l’impression qu’il y avait une sorte de suspense progressif dans la résolution de la mécanique de l’antisémitisme. On se dit, Joann Sfar va nous montrer comment fonctionne l’antisémitisme, et on va peut-être pouvoir désamorcer le phénomène… Et puis le lecteur est progressivement confronté à une sorte de thèse un peu gnostique selon laquelle l’antisémitisme est un monstre souterrain, diabolique, qui n’a pas tellement de formes ou qui est polymorphe, puisque, vous l’avez dit, on peut ne pas aimer les juifs parce qu’ils sont communistes ou parce qu’ils sont capitalistes, c’est selon. L’antisémitisme, ce n’est pas non plus quelqu’un pour vous. Il n’a pas de figure. C’est ce monstre amorphe et polymorphe à la fois qui ressemble à tous les péchés qu’il reproche aux Juifs. D’une certaine manière, votre thèse sur l’antisémitisme, c’est qu’il se nourrit d’une haine qu’il produit lui-même et qui est fondée sur le rejet de ses propres péchés ou de ses propres sentiments de culpabilité.
J.S : La haine est une grande force politique, c’est une réalité concrète. La haine est une force fédératrice. La haine permet de faire de l’audience. Et je crois que les haines ne se ressemblent pas toutes. Le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie, la misogynie, on peut toutes les égrener, sont des haines qui ne se ressemblent pas, qui n’ont pas les mêmes moteurs. Il faut les nommer correctement. Dans la haine du Juif, il y a une chose commune à chaque fois, c’est le sentiment de la proximité et de l’étrangeté. La haine de l’étranger, la haine de la race, c’est la haine de quelqu’un qu’on sort de notre système. Je me souviens d’une interview de Lech Walesa – que je ne retrouve pas et dont on me dit que je l’ai inventée, mais je ne l’ai absolument pas inventée – où il dit : « Nous, les Polonais, nous n’avons jamais détesté les Juifs. Ce n’est pas la question. On a toujours vécu avec eux. Le problème, c’est qu’on n’arrive pas à les différencier. Ça nous stresse ! » Il l’a dit moins bien que moi, parce qu’il était moins drôle que moi. Mais c’était l’idée…
Le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie, la misogynie, on peut toutes les égrener, sont des haines qui ne se ressemblent pas, qui n’ont pas les mêmes moteurs. Il faut les nommer correctement.
On voit bien que la caricature antijuive, c’est très commode parce que ça permet de les reconnaître. Mais en même temps, les gens n’arrêtent pas de dénicher les Juifs. C’est le point commun entre les antisémites et les juifs, qui savent très bien qui est Juif et qui ne l’est pas.
Mon idée, c’est que la haine se nourrit d’elle-même. Et, c’est peut-être aussi ce que je raconte dans le livre, c’est un plaisir d’être dans la haine, c’est une joie. Et c’est ce qui me ce qui me frappe le plus. C’est le cas de tous les massacres, malheureusement, ce n’est pas un privilège juif. À chaque fois qu’il y a eu un massacre de juifs, je pense au récit du pogrom de Kichinev, il n’y a jamais la moindre once de culpabilité chez les massacreurs au moment du massacre. Il y a une joie collective. Il y a une certitude de faire ce qu’il doit être fait, et il y a une certitude que c’est nécessaire. Je ne crois pas à l’aveuglement. Je crois que la personne qui massacre a la certitude de faire le bien.
Moi, je n’ai jamais demandé aux gens d’aimer les Juifs. Je demande juste qu’on évite de les massacrer. Je vois la jouissance gourmande avec lesquelles les grandes chaînes de télévision ou de radio qui m’invitent essayent parfois de me faire parler d’Israël pour enfin que je trébuche, qu’enfin on puisse me mettre l’étiquette… Je me borne à répondre qu’une partie de ma famille vit en Israël et que je voudrais qu’on évite de les massacrer, et que ma pensée politique sur le Proche-Orient ne va pas au-delà. J’ai eu la chance de fréquenter beaucoup Georges Kiejman à un moment et il avait une définition extraordinaire de l’antisémitisme. À un moment, je lui parlais d’un ministre d’extrême droite qu’il avait parmi ses amis. Mais je lui disais : « tout de même Georges, il est très, très antijuif ! ». Et il m’a répondu que « l’antisémitisme consiste à détester les juifs exagérément. Tant qu’ils ne nous tuent pas, c’est déjà ça ».
AZ : Albert Cohen, quand il dénonce l’antisémitisme, c’est en laissant entendre qu’il veut être aimé. C’est un désir d’être aimé en tant que juif. Et il ne comprend pas. Ça lui brise le cœur, l’antisémitisme. C’est une position très différente de la vôtre… Tout cela nous invite d’ailleurs à réfléchir à notre niveau de tolérance vis-à-vis de ce qu’on peut dire sur les juifs ou pas. Je pense à Romain Gary qui, concernant la fameuse phrase de De Gaulle sur les Juifs « fiers et dominateurs » dit, en substance que les juifs ont exagéré, la phrase de De Gaulle n’était pas du tout antisémite, c’était au contraire une manière de valoriser les juifs : ils sont forts, ils sont fiers et ils ont raison de l’être. Et Gary ajoutait : « C’est dommage. Là, on est un peu malade de l’antisémitisme. Il ne faut pas réagir comme ça. ».
J.S : Romain Gary et Albert Cohen sont des étoiles dans mon firmament. Ils font partie des romanciers que j’aime le plus, mais ils nourrissent, heureusement, une ambiguïté constante vis-à-vis de leur judaïsme. Albert Cohen est tiraillé de dégoût pour sa partie juive. On voit la fascination pour les jolies blondes suisses et on voit le dégoût pour le grouillement qu’il imagine être un grouillement juif. On le voit d’autant mieux qu’il n’a pas eu de vie juive. Il a subi les insultes antijuives quand il était petit à Marseille, dans sa petite cellule familiale de Juifs de Corfou qui essaye de passer inaperçue à Marseille. Il a inventé son monde juif.
Romain Gary, c’est encore plus formidable, c’est un des plus grands auteurs yiddish, c’est au niveau de Philip Roth. Sauf que, par erreur, au lieu d’aller à New York, il est allé à Paris. Mais ce n’est pas sa faute, c’est la faute de sa mère. Là où Romain Gary est formidable – parce que c’est le roi des menteurs – c’est que si tu l’écoutes, il n’est pas juif. Il se présente toujours un peu comme le prophète qui veut le bien des Juifs qu’il ne connaît que vaguement. Mes idoles juives parmi les romanciers francophones, et je mets Kessel dans le lot, ce sont ces auteurs qui sont en permanence dans un frottement ambigu vis-à-vis de leur appartenance juive.
Moi, je n’ai pas de vie juive, je n’ai pas de vie communautaire. Je ne vois pratiquement pas ma famille et avant de faire Le chat du rabbin, des Juifs, je n’en voyais pas. J’ai fait Le chat du rabbin parce que les deux tours se sont écroulées à New York et qu’on essayait de nous vendre une guerre de civilisation – évidemment, à force de l’appeler de ses vœux, elle va finir par advenir… Ma grand-mère d’Algérie venait de mourir, et je me disais que j’aimerais bien lui raconter quand même quelque chose. J’ai alors imaginé ce ‘chat du rabbin’…
AZ : Dans le tome 10 du Chat du rabbin, qui s’appelle « Rentrez chez vous ! », vous parlez notamment de la diversité des positions vis-à-vis d’Israël : les raisons que peuvent avoir à les Juifs à y partir ou au contraire les raisons qui poussent à ne pas partir ; le fait qu’on peut à la fois reprocher aux Juifs de s’assimiler mais aussi bien de partir en Israël… Ce que je veux souligner ici, c’est qu’avec le dessin et la narration, les critiques ou reproches qui vous sont régulièrement adressés quand vous abordez ces questions délicates semblent désamorcées. On a l’impression que le dessin vous permet de proposer des images des Juifs et du monde juif plus ambiguës, plus complexes et qui détournent des représentations habituelles…
J.S. : Le récit et dessin laissent une place aux lecteurs. Je crois que l’époque où un professeur pouvait faire un monologue en chaire avec des gens qui écoutent et qui font oui de la tête est révolue. Aujourd’hui, le lecteur ou l’auditeur est aussi malin que l’auteur, donc on est là pour partager des outils de réflexion. Pourquoi je dis souvent que le dessin est une science humaine ? Parce qu’avant d’en faire une discipline poétique ou artistique, c’est une manière de raconter, une manière de mettre en scène des personnages. Et l’avantage des bandes dessinées, c’est qu’à part dans la voix du narrateur, on fait parler des opinions diverses, qu’on fait dialoguer et qu’on fait se disputer.
J’aime beaucoup l’idée absurde et très vraie qui concerne ma famille : pourquoi n’a-t-on pas fait notre alya ? Cette menace de l’alya me terrorisait, parce que je pensais qu’il n’avait pas de bonne boutique de bande dessinée en Israël.
Aujourd’hui, lorsque je travaille sur une histoire que je raconte, je me documente… Par exemple, avant de commencer ce tome 10 du chat du rabbin, je croyais déjà bien connaître les mouvements juifs du début d’Israël. En fait, non. Je ne connaissais pas le mouvement Hashomer. Je ne savais pas ce que c’était. Je connaissais pas ces juifs russes qui vont s’habiller comme des Bédouins, qui terrorisent tout le monde, à cheval, avec des grenades et des fusils, et que rien ne peut distinguer d’une tribu arabe quand ils arrivent. Je ne connaissais pas le quotidien des bergers palestiniens qui s’opposaient aux juifs d’un côté, mais chez qui ils allaient se faire soigner parce que la tribu d’au-dessus ne va pas le permettre, au risque de les massacrer. J’essaie de raconter des récits individuels, parce que sur le Proche-Orient tout le monde est tellement passionné qu’il n’y a plus place, semble-t-il, pour un récit individuel, pour un souvenir. Et puis malheureusement, dans le concours de bêtise, il n’y a pas de gagnant. C’est-à-dire que dans tous les camps, tout le monde est hystérique… Surtout les gens qui n’y connaissent rien et certainement pas l’histoire de cette région.
Dans le Chat du Rabin, j’ai essayé de rester dans l’histoire de ma grand-mère, c’est-à-dire dans les souvenirs à peine maquillés de personnes de ma famille ou de mon entourage, avec leur spécificité algérienne. C’est-à-dire que pour des juifs d’Europe de l’Est, pour des juifs du Maroc, Israël a représenté très tôt une terre promise. Pour les Juifs d’Algérie, pas du tout. Pour les Juifs d’Algérie, la terre promise, c’est la métropole. Ils ont une fascination pour la France. Donc leur fascination pour Israël interviendra après qu’ils aient résolu ce qu’ils ont à faire en métropole, d’une certaine façon…
Et donc, je me suis aperçu qu’il y avait à l’époque de mon histoire, à la fin du 19e siècle, très peu de Juifs algériens en Israël. Il y en a quand même un peu, ils devaient être 500. Et j’ai raconté toutes sortes d’histoires qui sont plus ou moins dans la mémoire familiale, avec des personnages chez qui ce n’est jamais résolu : « Ce n’est pas notre destin d’aller là-bas ».
J’aime beaucoup l’idée absurde et très vraie qui concerne ma famille : pourquoi n’a-t-on pas fait notre alya ? Cette menace de l’alya me terrorisait, parce que je pensais qu’il n’avait pas de bonne boutique de bande dessinée en Israël. Et on n’y est finalement pas allé parce que ma grand-mère est tombée malade dans un hôtel de Tel-Aviv. Elle a dit qu’il était hors de question qu’on vive dans un pays qui avait la climatisation. Nice, c’était déjà bien par rapport à l’Algérie. Mais quand mon père allait plaider à Aix, elle avait peur qu’il attrape la mort parce qu’à Aix, c’était les grands froids. Donc Israël, avec la climatisation, ce n’était pas possible. J’aime beaucoup cette histoire. Cela me fait dire qu’il faut arrêter avec le libre arbitre. Il faut arrêter de nous faire croire que les gens décident de leur destin, que les familles savent ce qu’elles font. Les familles, ce sont des braves gens qui sont entraînés à droite, à gauche et qui ensuite passent leur vie à essayer de se justifier sur ce qu’ils ont fait ou ce qu’ils ont dit. J’ai essayé d’amener l’histoire de ma grand-mère, et cet imaginaire un peu absurde, plutôt que l’histoire des historiens.
© Avishag Zafrani
Le Dernier Juif d’Europe. Joann Sfar. Albin Michel. 2020.
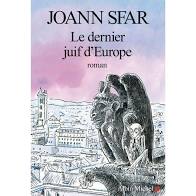
Source: « K. » 12 avril 2021


Poster un Commentaire