
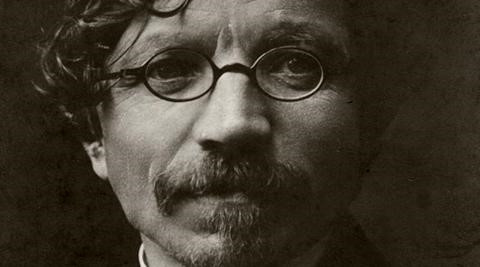
Cholem Aleikhem עליכם-שלום vous salue, par Albert Bensoussan
Le nombre de Juifs russes qui sont nés en Ukraine et ont rayonné dans le monde est étonnant, et qui peut expliquer pourquoi ? Ne parlons pas des plus grands musiciens du XXe siècle, les violonistes Misha Elman, dont le père était prince du klezmer, David Oistrakh – surnommé « le Roi David » ─, Nathan Milstein, les pianistes Oleg Maisenberg, Emil Gilels ainsi que son beau-frère Leonid Kogan, immense violoniste, tous nés ou formés à Odessa. Sans parler d’un des plus grands cinéastes de l’histoire, Serguei Eisenstein (juif par son père), et puis le grand maître des échecs que fut Efil Geller. Et enfin les très grands écrivains que furent Isaac Babel (Contes d’Odessa) Haïm Nahman Bialik, gloire nationale de la poésie hébraïque. et, bien entendu, Mendele Moïkher Sforim (1836-1917), considéré comme le grand-père de la littérature yiddish. « Et comment ne pas saluer aussi, natif d’Odessa, Zeev Jabotinsky, l’un des maîtres fondateurs du sionisme? »
Et dans ce sillage, voilà cet autre Ukrainien tenu pour Russe, mais tout bonnement Juif de langue yiddish, Cholem Naoumovitch Rabinovitch, qui, s’appuyant sur son prénom Salomon, devenu Cholem en yiddish, choisit de saluer ses lecteurs en adoptant le pseudonyme de Cholem Aleikhem : Que la paix soit sur vous !
Pas étonnant si l’on songe qu’Odessa, où se tient chaque année un festival, se considère comme la capitale mondiale de l’humour. Qui doit tant, à coup sûr, à cet ancrage et cette tradition yiddish. Et l’on se souviendra aussi que le chef d’œuvre de Jonathan Safran Foer, Tout est illuminé (éditions de l’Olivier, 2003) se situe en Ukraine, sur la trace d’un shtetl disparu.
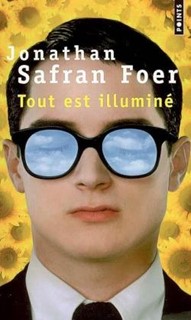
Lorsqu’on évoque le nom de Sholem-Aleikhem, le sourire monte aux lèvres et même l’on se tient les côtes : c’est l’esprit yiddish dans toute sa verve et sa verdeur, multipliant les Witz ─ vitsn, en yiddish ─, les mots d’esprit, chers à Freud (Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient – Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten) dont on citera le plus célèbre : « Moi je prends un bain tous les six mois », dit un Juif du shtetl à son compère, puis il ajoute et c’est la chute comique : « … que j’en ai besoin ou pas » ! On se rappelle la truculente chronique des Gens de Kasrilevkè (Julliard, 1992, collection « Littérature yiddish »), un shtetl imaginaire, et les contes drolatiques de Guitel Pourishkevittsh et autres héros dépités (éditions de l’Antilope, 2016). Et pourtant le monde qu’il décrit nous restera toujours en travers de la gorge, car c’est celui des pogroms russes, des persécutions polonaises et des guerres allemandes, aboutissant – mais l’auteur, décédé en 1916, ne le verra pas – à la Shoah. Quand il écrit en 1915 Les mille et une nuits de Krushnik (l’Antilope, 2018, traduction et introduction de Nadia Déhan-Rotschild et Évelyne Grumberg),

Cholem Aleikhem, écrit aussi Sholem-Aleikhem, vogue vers l’Amérique en tournant le dos à la première grande boucherie du XXe siècle. C’est alors un homme célèbre et le plus grand écrivain de langue yiddish. Sa créature, Tevye le laitier, Tevye der Milkhiger, a fait, depuis 1891, le tour de la terre, plus tard triomphant aussi sur toutes les scènes et même sur les écrans de cinéma sous le visage de l’acteur israélien Chaïm Topol חיים־טופול (Un violon sur le toit, 1971).
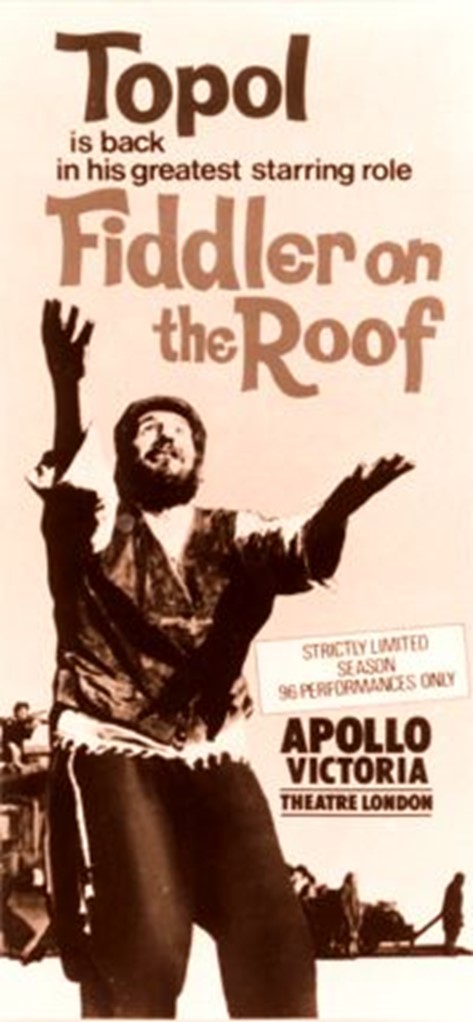
Le XXe siècle yiddish est dominé par deux écrivains majeurs, Cholem Aleikhem et Isaac Bashevis Singer, juif polonais devenu newyorkais à partir de 1935, qui prit le relais de son illustre aîné. Par chance, nous voyons aujourd’hui ressusciter ce yiddishland qu’on croyait disparu.
La première chose qu’on entend en ouvrant ce livre, et l’on en prend plein la gueule, c’est cette injure russe : Zhidovske morde, « gueule de youpin ». Les Juifs sont ici, quel que soit l’occupant du shtetl ─ tantôt russe, tantôt ukrainien, tantôt polonais, tantôt allemand ─, traités de « youpins » ou de « Beilis », du nom de ce juif ukrainien accusé, à tort, d’avoir commis un crime rituel. Mais nous sommes là sur un « Exodus » avant-coureur qui emmène, via Copenhague – « Coupeinehague », dit le narrateur en humoristique distorsion –, bon nombre de Juifs d’Europe centrale vers l’Eldorado américain, alors que la Grande Guerre fait rage : on est en 1915. Et là, Cholem Aleikhem, grand intellectuel et glorieux écrivain, se trouve sur le même bateau qu’un émigrant des 3èmes cabines, nommé Yankl (Jacob en yiddish), un bavard intarissable qui, en 14 chapitres correspondant aux 14 jours de la traversée réelle de l’auteur, raconte tous les avatars de son histoire. Qui est, bien sûr, un conte et une allégorie, progressant à la façon des Mille et Une nuits, avec interruption périodique en fin de jour, là même où le discours reste en suspens, et reprise du conte le lendemain, les récits étant rythmés, au début du moins, par la sonnerie du shofar, qui est ici, sur le pont qui tangue et qui roule, la corne ou la cloche annonçant le service de table. Quant à la ville dont on rapporte la chronique, Krushnik, c’est le nom yiddish de Kraśnik, un bourg polonais de la province de Lublin, au demeurant peuplé majoritairement de Juifs, présents là depuis des siècles. À la veille de la 2nde Guerre mondiale, la ville comptait 5000 Juifs, composant la moitié de la population : il n’en restait plus, après la Shoah, que quelques centaines.

Le récit de Cholem Aleikhem, étonnamment prophétique, montre la progressive extinction du Yiddishland. Le sujet unique du récit est la guerre. La guerre qui ravage l’Europe, et même, croit-on savoir, la terre entière. « Qu’est-ce que c’est que ce travail, des gens qui se tirent les uns sur les autres ! » s’écrie Yankl, prenant à témoin l’auteur, ici campé en personnage et témoin, auditeur du monologue de ce grand bavard qui l’interpelle à tout moment en usant de la formule : « Vous me suivez ? », dont la multiple répétition produit un effet comique sur un discours qui ne l’est assurément pas. Et il réitère sa vision des conflits en se référant à Azraël עֲזַרְאֵל : « Qu’est-ce donc que la guerre avec ses combattants sinon l’ange de la mort en personne ? » Oui, mais alors quelle attitude prendre face à la guerre ? Cet homme, ce Jacob/Yankl, a deux fils qui sont comme les deux faces d’une même monnaie : l’un est pacifiste à tout crin, l’autre engagé volontaire. Yehiel le doux est allergique à la tuerie :
« Tu ne tueras point » pour lui c’était le summum. On ne plaisante pas avec « Tu ne tueras point ».
Si on lui donne un fusil en lui ordonnant de tirer, il fait feu en l’air au furieux désespoir de l’adjudant-chef, qui lui enjoint de viser en face. « En face ? répond-il, mais il y a des gens ! » Ce doux, malgré tout et sans doute pour cela, mourra au front. Le second fils de Yankl, Shmuel-Moyshe, est tout le contraire du brave Yehiel, car lui s’engage dans l’armée russe et veut combattre pour sa patrie : « Un Juif est capable, dit-il, de faire autre chose que le commerce de poisson juif ou de vodka russe ». Le voilà en front, hardi combattant, et tout près d’embrocher un officier qui lui fait face et qui, se voyant perdu, se met soudain à réciter le Chema Israël, ce que tout Juif croyant récite à l’article de la mort. Mais quoi, un Juif allemand contre un Juif russe, est-ce possible ? La guerre des frères n’aura pas lieu. Anti-Caïn, Shmuel-Moyshe abaisse son arme et se saisit de son adversaire pour l’embrasser. Ce qui lui vaut d’être traduit en conseil de guerre, mais il s’en tirera quand même, du moins le père veut croire que ce fils si dégourdi aura pu échapper à la mort promise et gagner l’Amérique ; et c’est bien pour cela, alors que tous les siens ont été tués, qu’il monte sur le bateau. Le navire de la délivrance. Tout en doutant, malgré tout, d’un si faible espoir. Le discours de Yankl, plein d’amertume et de révolte contre la bêtise des hommes exprime ce qui peut apparaître comme le noyau dur de ce récit : l’homme est pire que la bête qui,
quand elle a faim, elle vous attaque, vous dévore, et une fois rassasiée, elle se tient tranquille. Mais l’homme, quand il se déchaîne, ne sait pas s’arrêter. Au contraire, plus il voit de sang, plus il a envie d’en répandre, on se jette les uns sur les autres, on se hache menu comme du chou, on se saigne comme des porcs, pardon pour l’expression, et le sang coule à flot.
Ce récit est une eau-forte. Un passage de ce livre nous interpelle avec une étrange actualité : les Polonais affament les juifs et leur arme offensive tient en un seul mot : « Boycott ». D’où cette remarque enragée du conteur : « Le mot boycott, vous me suivez, est à rayer du vocabulaire et des mémoires ». Voilà un mot qui fait tilt dans notre tête aujourd’hui. Comment ne pas y penser en ces temps de stigmatisation où l’odieux BDS fait des ravages ? Et, dans sa rancœur, ou son désir de vengeance, Yankl ─ mais n’est-ce pas l’auteur qui parle par sa bouche ? ─ imagine le châtiment des Polonais, pris en tenaille entre les Russes et les Allemands : « Le Ruskoff leur donnera des nèfles et l’Allemand une belle figue ». L’expression métaphorique ravit le lecteur qui étanche à bon compte sa soif de vengeance, ou de revanche. Bien des sourires, malgré tout, dans ce récit tragi-comique. Le concept de lutte des classes trouve à s’exprimer dans ce bateau où l’auteur à succès, Cholem Aleikhem, jouit d’une cabine du pont supérieur, tandis que le tout-venant de l’émigration juive croupit en cale, et l’humour s’en prend à la cacherout à bord du bateau de l‘exil : « Dans ce qu’on nous donne sur ce bateau tout n’est pas autorisé et tout ce qui l’est n’est pas forcément mangeable ». Ou cette terrible métaphore, cette fois sans nul sourire, où le monde juif est comparé à une olive : « Car il est telle l’olive qui ne donne son huile que pilonnée, broyée, pressée ».
Mais l’humour juif est toujours à deux faces : voyez ce vits sur la Shoah de Marceline Loridan-Ivens (alias Rozenberg) rapporté par Delphine Horvilleur dans son dernier livre, Vivre avec les morts (Grasset, 2021) :
(C’est) l’histoire de deux rescapés des camps qui font de l’humour noir sur la Shoah. Dieu, qui passe par là, les interrompt : « Mais comment osez-vous plaisanter sur cette catastrophe ? » et les survivants de lui répondre : « Toi, tu ne peux pas comprendre, tu n’étais pas là ! »
On pense parfois, à lire Cholem Aleikhem et son humour grinçant, au chef-d’œuvre du Tchèque Jaroslav Hašek et à son Brave Soldat Chvéïk, publié de 1921 à 1923, donc quelques années après la disparition de notre auteur. Moins dans le portrait du naïf et de l’idiot qui se révèle tellement rusé qu’il fait tourner les autres en bourrique, que par le ton, le style, cette façon de conter où tout est mis à distance avec un rire étouffé ou une grimace de dérision. Et puis dans les deux œuvres, nous assistons à un procès de la guerre et au même constat : la stupidité des hommes. Tel cet exemple donné par Cholem Aleikhem :
Le Ruskoff entre en bisbille avec Frantz l’Austro-goth pour un bout de Serbie qui ne vaut pas deux sous, le monde entier s’embrase, mon Dieu protégez-nous !
Ce qui résume assez bien la folie humaine qui a présidé à la première des grandes guerres du XXe siècle. Au dernier chapitre, intitulé significativement « Écoute, Israël », reprenant la prière précédant la mort ainsi qu’on l’a vu plus haut, il faut se préparer à quitter cette existence et cette terre de sang et de larmes. Comme ses personnages, l’auteur récitera là une prière d’espoir, ou de désespoir, en délaissant la scène de ce monde d’idiots et de fous.
Qui niera l’actualité d’un tel livre écrit plus d’un siècle avant, sa résonance dans les temps que nous vivons où nulle leçon n’a été tirée et, balayée l’histoire, rien n’a été compris ? La guerre des loups, dénoncée au temps de Hobbes (Homo homini lupus), fait rage un peu partout, et les morts s’amoncellent au milieu des pires exactions. Le mot de la fin est donc la prière de l’agonisant, psalmodiée avec un parfait accent yiddish ─ on peut entendre Simone Signoret (juive par son Kaminker de père) la prononcer telle dans le film La vie devant soi, d’après Romain Gary, cet autre rescapé du Yiddishland :
Shema Yisroel, adonay elohenu, adonay ekhod
auquel le survivant (peut-être) répond, dans la logique de la prière :
Borekh shem kvoyd malkhuso.
Et donc, quand tombe le rideau, en dernière page du livre, le rescapé de tous les pogromes, laisse parler son désespoir : « À quoi bon vivre ? »
A-t-on oublié le célèbre proverbe yiddish :
La vie vaut la peine d’être vécue… ne serait-ce que par curiosité ?
Alors s’il a péché par excès de pessimisme, et s’il nous fait pleurer, Yankl prend congé de l’auteur sur cette seule expression, sa dernière parole : « Sans rancune ».
Soit. On se consolera en cherchant un souffle d’espoir, au deuxième tour d’écrou de la catastrophe, et trouvant cet écho chez Max Jacob reclus à Drancy, en 1944, aux portes du Pitchipoï, ce lieu de nulle part et qui était Auschwitz :
Ce qui demeure est le futur
Non le présent qui désole.
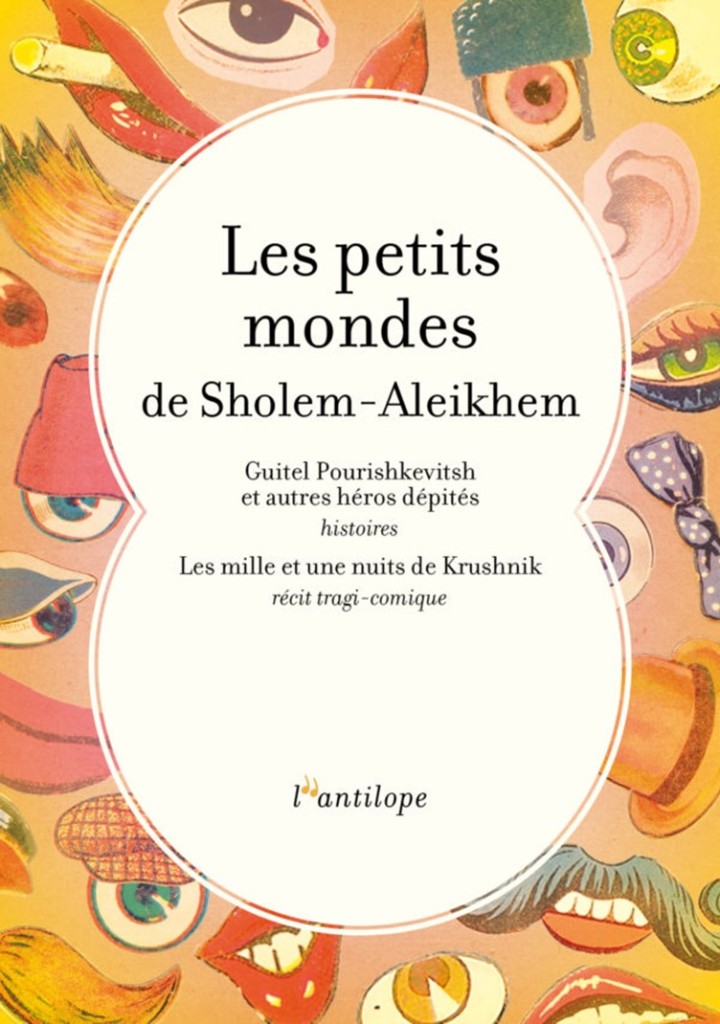
On aura compris que ce livre admirable, véritable testament d’une des plus grandes voix du monde yiddish, est à lire et à avaler d’un trait, dût-on rire et pleurer jusqu’au bout de la nuit. Quant à l’auteur, Cholem Aleikhem, dont tant d’œuvres désormais circulent en français, c’est le plaisir permanent d’une lecture qu’on souhaite à tous les confinés et reclus de par nos pauvres terres.

Source: Terre-des-Juifs.com
https://terre-des-juifs.com/2021/03/18/cholem-aleikhem-
Ce site traite de l’actualité et des évolutions géopolitiques au Moyen-Orient, de la société israélienne et de la diaspora juive
Merci à Marc Brzutowski de nous permettre de diffuser


Merci, cher Albert Bensoussan, le plus ashkenaze des auteurs séfarades, de nous parler avec un tel talent de cet immense écrivain que fut Sholem Aleikhem, qui sut si bien tirer profit des ressources de l’humour juif, toujours si proche du tragique. Kol hakavod!