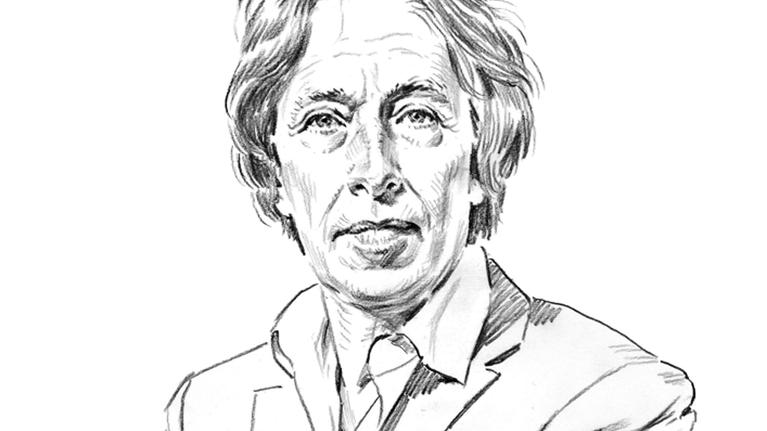
TRIBUNE – L’écrivain et philosophe décrit avec finesse l’expérience si étonnante du huis clos de masse. Comment réorganiser ses journées, rester digne et se tenir en pareilles circonstances?
«Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans leur chambre», disait Pascal à propos du divertissement. Et il poursuit: «De là que les hommes aiment tant le bruit et le remuement, de là vient que la prison est un supplice si horrible. De là vient que le plaisir de la solitude est une chose si incompréhensible.»
On pourrait lui répondre: tout le malheur des Européens vient de ce qu’ils doivent garder la chambre. Ce qui les menace aujourd’hui, c’est moins le virus que l’inaction, moins le risque de tomber malade que de périr d’ennui. N’en déplaise à Pascal, le divertissement est essentiel, la futilité vitale et sans ces entractes qui interrompent le quotidien, l’existence ressemblerait vite à une punition. Comment réorganiser des journées qui étaient scandées par les sorties, les cafés, la perspective des vacances, des voyages? Le tête-à-tête avec le conjoint et les enfants en bas âge peut ressembler pour beaucoup à un cauchemar. On peut donc prévoir beaucoup de naissances, les bébés Covid-19, et de nombreux divorces. Un rien sépare les douceurs de la vie commune de la servitude. Étrange leçon: les amoureux peuvent traverser les guerres, les adultères, les disputes mais moins le huis clos. Le calme plat est fatal à l’amour.
Étrange leçon : les amoureux peuvent traverser les guerres, les adultères, les disputes mais moins le huis clos.
Si l’épidémie est une épreuve, elle n’est pas vécue par tous de la même façon. Au sommet de la hiérarchie, la tragédie et le combat: les malades en réanimation, les médecins, les infirmières qui les soignent et risquent leur vie tous les jours, épuisés, furieux de manquer de tout, de masques, de lits, de respirateurs. Un système hospitalier aux abois et qui craque de partout, surtout en Europe du Sud qui évoque de plus en plus un tiers-monde de luxe. Juste à côté, les «aînés» seuls dans leurs maisons de retraite ou leurs Ehpad, abandonnés de leurs familles, barricadés dans leurs mouroirs et statistiquement promis à la disparition. Après eux, majoritaires, les rescapés qui guérissent, sortent de l’hôpital. On les regarde avec
envie: ils ont traversé l’enfer. Ensuite les salariés qui continuent à travailler jusqu’à l’épuisement, les soldats, les forces de police qui assurent la sécurité à leurs risques et périls. Et puis les innombrables drames, les enterrements impossibles, les funérailles bâclées, les parents et les enfants séparés entre les continents.
Retour de la grande division de 14-18 : au front la troupe des médecins qui se battent au prix de sacrifices inouïs, à l’arrière la masse des planqués qui râlent et gémissent.
Enfin, la piétaille, vous, moi, la masse des confinés. Mais il y a un fossé entre les familles coincées dans 50 m2 avec des mômes hurleurs et intenables et les ménages aisés qui baillent dans 200 m2 ou découvrent l’apparition du printemps en lisant Proust ou Fitzgerald depuis leur gentilhommière de Bretagne ou du Poitou. Retour de la grande division de 14-18: au front la troupe des médecins qui se battent au prix de sacrifices inouïs, à l’arrière la masse des planqués qui râlent et gémissent. Tous en guerre oui, mais pour la plupart en pyjama et charentaises, avec Netflix et Canal+. Un auteur suisse peu connu, Henri-Frédéric Amiel, a écrit au XIXe siècle un monstrueux journal de plus de 16.000 pages, monument de vide absolu puisque chaque jour se caractérise par le fait qu’il ne s’y passe rien. Velléitaire forcené, il passa son temps à rêver des livres qu’il aurait pu écrire, des femmes qu’il n’a pas épousées. Seul son Journal minutieusement tenu lui donnait l’illusion d’une vie bien remplie. Frédéric Amiel est notre maître en ce moment car il a su porter la promotion de l’insignifiance à un niveau inégalé. Son Journal est un sanctuaire de papier dédié à une nouvelle divinité:
l’infinitésimal. Humeurs, anecdotes, digestions pénibles, difficultés respiratoires (déjà), tout ce peu de choses finit par composer une histoire. J’imagine que nous aurons à l’automne une profusion de «Journaux du confinement» qui nous apporteront des tombereaux de vétilles élevées au rang d’épopées.

Nous voilà tout comme Amiel condamnés à l’effroyable tâche de ne pas exister. Nous vivons le côte à côte vertigineux de la réclusion stérile et de la mort gourmande qui dévore chaque jour de nouveaux sujets. Nous oscillons entre désinvolture et panique, coupables d’être chez nous en bonne santé alors qu’alentour les malades tombent et la Camarde moissonne. Chacune de nos journées est une encyclopédie colossale du néant, la certitude que prendre une douche, composer les menus, faire de l’exercice, changer notre fauteuil de place, appeler les proches pour les rassurer constitueront les seuls événements notoires. Intimation nous est faite de devenir des héros de l’extinction tel Oblomov, célèbre personnage de la littérature russe qui déploie une exorbitante force d’inertie, refuse de se lever le matin et reste au lit. La vie larvaire est une ascèse, au rebours de l’hystérie consumériste ou romantique. Soixante-sept millions de Français sont priés de se convertir en extrémistes de la routine pour leur bien. Notre humanité démunie se trouve à la merci de quelques postillons.
«Au revoir Monsieur, restez solidaire», me dit un marchand. Solidaire: soit les mots n’ont aucun sens, soit celui-là est vraiment mal choisi. On nous demande au contraire de rester solitaires, d’éviter le moindre contact. Dans le jargon actuel, se montrer altruiste, c’est manifester un égoïsme tout-puissant. Rester chez soi, respecter une distance de sécurité, porter un masque ou un mouchoir sur la bouche, guetter la moindre silhouette dans les rues désertes et l’éviter comme un pestiféré, c’est ça la solidarité? Le Covid-19 donne raison aux deux personnages qui nous habitent: le paranoïaque et l’hypocondriaque. Le premier se méfie des autres, le second se méfie de soi. Notre corps abrite un ennemi qui peut nous terrasser à chaque moment. Vous avez raison d’avoir peur!
Le civisme désormais c’est de penser à soi. Aller acheter son pain est l’équivalent d’une expédition en Amazonie au milieu des rapides et des serpents. Le commerçant vous rend la monnaie avec un regard torve. Ne vous avisez pas de tousser ou de renifler: la foule se tourne vers vous, prête à vous lyncher. Le simple fait d’ouvrir la porte de sa maison, de son appartement est un danger majeur.
«Pouvez-vous me prêter votre chien? Je vous le loue pour une heure.» Que ne ferait-on pour tuer la monotonie, avoir une bonne raison de marcher dans ces avenues mortes où seul résonne l’écho de nos pas? Le silence de Paris la nuit est effrayant. Pas même un avion pour rompre la monotonie, une voiture qui klaxonne. Et le contraste est stupéfiant entre la nature qui, en ce moment, explose en couleurs, bourgeonne et les visages tirés des passants.
Un monde d’égoïsmes opaques où les gens se croisent sans se parler: c’est la situation du théâtre de l’absurde ou de ces films d’avant-garde des années 1970 où des jeunes gens très cultivés dissertaient à l’envie sur l’incommunicabilité des êtres. À tout prendre, autant regarder de vrais films catastrophe, Le Jour d’après, Contagion, La Route où chaque personne qui se profile à l’horizon est un tueur potentiel. Paris comme Rome ou Madrid est devenu un décor de film d’épouvante mais le monstre, c’est vous pour votre voisin et lui pour vous.
On dirait que l’époque a fabriqué la maladie qui la reflète: hier encore, nous redoutions l’étranger, maintenant nous craignons le locataire de notre palier. Nous sommes passés de l’agoraphobie, la terreur des grands espaces sans frontières ni garde-fous, à la claustrophobie, le sentiment d’incarcération chez soi. Voilà le monde plus coprésent à lui-même que jamais, nous sommes contemporains pour la première fois de nos contemporains en temps réel, en Iran, en Argentine comme en Corée. La globalisation de la pandémie a remplacé celle des échanges.
Relativisons: ce n’est pas la peste noire, ni l’occupation et encore moins la situation d’un otage capturé par des terroristes. Mais c’est notre défi et il est inédit. Il ne dépend pas de nous de vaincre cette maladie, tout au plus d’en freiner la propagation. Il dépend de nous en revanche de rester à la hauteur de ce qui arrive. Chaque jour est un combat discret mené contre le doute et le découragement. Il est important en période d’exception, de ne pas se laisser aller, de faire comme si: s’habiller comme si la vie sociale continuait, ranger la maison comme si on allait recevoir des invités, embellir les pièces, préparer de somptueux repas, bref se tenir.
Les historiens diront plus tard comment les populations ont développé une immunité mentale contre la peur. Comment elles se sont construit une forteresse intérieure pour repousser le malheur et ne laisser passer que la beauté, le talent, l’humour, l’insolite, les témoignages d’amour et d’amitié.
Nous ne sommes pas égaux devant l’ennui ; certains le tuent par une distraction perpétuelle, d’autres s’appuient sur lui pour plonger dans une rêverie féconde: ceux-là sont les aristocrates de la vie intérieure. Cette aristocratie est en principe ouverte à tous et ne dépend ni de la richesse ni de la naissance. Elle est une hygiène de l’esprit qui nous commande de puiser en nous les ressources nécessaires à la survie. La perception du temps a changé, il n’est plus orienté vers un but sinon vers l’improbable délivrance. Il n’y a plus de dimanche, de lundi, chaque jour est un seul jour qui ressemble aux autres. Un présent perpétuel. Autant que la maladie, ce qui nous menace, c’est le spectre de la dissolution, la tempête des heures molles. Chacun déploie mille ruses pour tromper la monotonie: certains transforment leur salon en salle de sport, leur terrasse en piste de course, installent leur lit dans le couloir pour se dépayser. D’autres échangent des poèmes, des chansons. On voit même des couples faire l’amour au balcon pour saluer le printemps tandis que de l’autre côté de la rue, des mélomanes improvisent des airs d’opéra. On rivalise d’ingéniosité grâce au téléphone, à la vidéo.
Mille blagues circulent en ligne dont certaines, avouons-le, touchent au génie dans le non-sens. Les historiens diront plus tard comment les populations ont développé une immunité mentale contre la peur. Comment elles se sont construit une forteresse intérieure pour
repousser le malheur et ne laisser passer que la beauté, le talent, l’humour, l’insolite, les témoignages d’amour et d’amitié. Nous voilà contraints, de faire de notre réclusion un art de vivre, de convertir l’enfermement en liberté. C’est une calamité, c’est aussi une chance.
Source: Le Figaro. 23 mars 2020.

Membre de l’académie Goncourt, Pascal Bruckner a écrit en 2019 Une brève éternité – Philosophie de la longévité, publié chez Grasset.
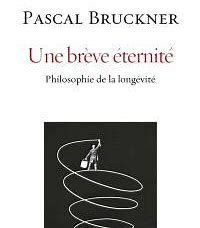


Bruckner nous raconte ici qu’un « auteur suisse peu connu, Henri-Frédéric Amiel, a écrit au XIXe siècle un monstrueux journal de plus de 16.000 pages, monument de vide absolu puisque chaque jour se caractérise par le fait qu’il ne s’y passe rien ».
Aspire-t-il à la même performance en écrivant cet article où il n’y a rien ?
Concernant l’huis-clos avec les mêmes personnes, Sartre a déjà tout dit dans la pièce éponyme et sa conclusion : « l’enfer, c’est les autres ».
Bruckner aspire-t-il à faire du Sartre ? Qu’il cite ses sources, au moins.
Sinon, prenons un exemple au hasard : moi.
Je ne m’ennuie jamais. Je n’ai jamais le temps de faire quoi que ce soit.
Il est toujours plus urgent à ne rien faire.