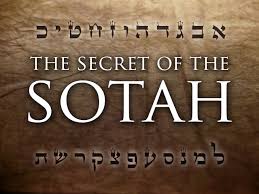Quelqu’un qui me veut du bien m’a dit : cesse d’écrire sur l’antisémitisme et l’islam ! J’aimais mieux quand tu parlais de Delphine Horvilleur ! Alors, j’ai rangé Blasphémateur ! Les prisons d’Allah et Ma vie à contre Coran, mais, au lieu de vous raconter Foi, violence et espérance, la dernière conférence de notre rabbin préférée, j’ai choisi dans la pile de livres qui s’entassent à mon chevet : divine surprise je viens de refermer une pépite : Sotah, la femme adultère, de Naomi Ragen.
Ronit Elkabetz, j’aime à penser que tu as eu le temps de la faire, cette plongée dans le quotidien d’une famille juive ultra-orthodoxe de Jérusalem, car le portrait de cette société fermée sur elle-même, ce destin croisé de trois jeunes sœurs, ça aurait fait un scénario à ta mesure. Si seulement tu avais eu le temps.
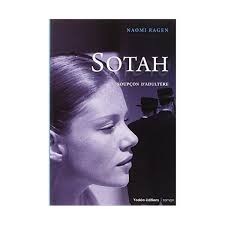
Si l’auteure de Sotah, la femme adultère, dépeint avec une tendresse non feinte le quotidien d’une société solidaire et viscéralement attachée à ses valeurs, elle en dénoncera néanmoins sans la moindre complaisance les dérives, tout particulièrement celles dont les femmes sont victimes.
Nous voilà chez les Reich, famille juive ultra-orthodoxe de huit enfants, vivant modestement à Jérusalem. Le père, homme pieux et bon, consacre sa vie à l’étude et à l’enseignement, pendant que la mère, une force de la nature, gagne l’argent du ménage et tient le foyer : il semble que cela soit souvent le cas lorsqu’on est femme de rabbin.
DVORA, DINA ET HAYA LEA
Nous, lecteurs, allons suivre trois destins à travers les histoires de Dvora, Dina et Haya Léa Reich, jeunes filles dont les vies vont emprunter des chemins bien différents.
Dès les premières pages, le mariage de l’ainée se profile : Dvora a déjà vingt ans et il n’est que temps. Elle va épouser cet homme peu attirant et qu’elle ne désire pas, mais qu’elle respecte pour ses qualités et sa bonté. Qui oser douter qu’avec le temps, elle apprendra à le connaître et à l’apprécier, suivant le chemin tout tracé de ces bons mariages arrangés. Elle mènera une vie sans histoire, une vie de femme docile et soumise, faite de grossesses à répétions, bref la vie d’une mère de famille orthodoxe. Acceptant son sort, Dvora sera peut-être heureuse et peut-être même qu’elle finira par l’aimer, ce mari qu’on a choisi pour elle.
Dina est la cadette. Elle est la plus douce, la plus jolie. Cette jeune fille ravissante et fragile devra pourtant se résigner à ne pas épouser celui qui partage ses sentiments, car l’affaire entre les deux familles ne pourra se conclure, faute d’argent. Depuis, Dina a changé et c’est une jeune fille résignée et taciturne qui épousera, à l’âge de dix sept ans, sans le moindre enthousiasme, Judah Gutman, un menuisier de vingt-six ans, un homme bâti comme une armoire à glace, aussi habile et délicat avec ses mains que gauche avec son corps et maladroit avec ses mots.
Cet époux en apparence rustre, ce géant timide et maladroit, Dina ne saura en deviner la gentillesse et la pureté, voire la finesse. Au contraire, très vite, la jeune épouse va se laisser éblouir et séduire par les paroles de Noah Saltzman, voisin peu scrupuleux, homme marié et membre de la même communauté. Voilà qui pourrait être de l’ordre du non-événement si les jeunes gens n’appartenaient pas au milieu juif ultra-orthodoxe de Jérusalem. Ce milieu où tout se sait, où la pudeur et les bonnes mœurs sont règles non négociables de la vie communautaire. Comment dès lors s’étonner que l’un et l’autre soient rapidement repérés…
Dina sera dénoncée pour adultère, accusée puis menacée par la Brigade des mœurs qui sévit clandestinement dans son quartier et fera basculer sa vie : sous la pression, et pour éviter qu’un scandale jette l’opprobre sur sa famille, elle sera contrainte de quitter les siens sans un mot et de s’exiler aux Etats-Unis, où elle sera l’aide ménagère d’une famille juive moderne et assimilée qui a tourné depuis longtemps le dos aux pratiques religieuses. Malgré la gentillesse de sa famille d’accueil qui ignore tout de son histoire, Sotah peinera à vivre dans cette société individualiste, tournée vers la consommation et les loisirs, cette société radicalement différente de celle dont elle est issue et qui met si durement à l’épreuve ses convictions. Elle ne pourra pas non plus soutenir sa sœur Haya Léa, la rebelle de la famille, lorsque celle-ci, éprise du fils du poissonnier, un hassid[1] d’un autre courant religieux et qui entend bien faire son service militaire, s’opposera aux vœux que ses parents forment pour elle.
Inspiré d’une histoire vraie, Sotah nous fait pénétrer au cœur d une communauté qui vit au rythme de rites ancestraux, dans le respect scrupuleux des commandements de La Bible, ces communautés juives orthodoxes de Jérusalem que l’auteure, elle-même née au sein d’une famille juive orthodoxe, connaît si bien, ce monde fermé avec ses histoires de jeunes filles religieuses et très chastes, ses mariages plus ou moins arrangés, ses conflits entres communautés opposées, ses dérives enfin dont les femmes sont les premières victimes.
L’histoire de Dina Reich m’a été inspirée par un article paru dans un quotidien israélien, écrivit Naomi Ragen. Une femme ultra-orthodoxe évoquait son adultère avec un homme marié et religieux qui était son voisin. Elle parlait du plaisir qu’elle avait trouvé, de son sentiment de culpabilité et de la découverte de cette liaison par la Brigade des mœurs. Elle avait été chassée de chez elle sans un sou et séparée de ses enfants. Cette histoire m’a remplie de terreur et d’étonnement. Ce qui suscitait mon intérêt n’était pas tant les détails de cette relation, que le fait qu’une jeune femme religieuse, soigneusement éduquée dans les sacrosaintes rues de Jérusalem, ait pu se trouver dans cette situation. Je me demandais aussi s’il y avait dans ce monde un pardon pour une femme comme elle, de la compassion pour sa faute humaine et un moyen quelconque de regagner ce qu’elle avait perdu. Sotah est ma façon de faire cette enquête.
LE RITUEL DE L’EAU AMÈRE
Bel engagement que celui de Naomi Ragen. Installée aujourd’hui à Jérusalem avec son mari, l’écrivain engagée s’implique dans les problèmes sociétaux rencontrés par les familles juives rigoristes. Ce monde juif orthodoxe, elle joue à le confronter au monde moderne, représenté par les Juifs américains libéraux.
Pour ceux qui, comme moi, l’ignoreraient, des groupes clandestins, les brigades de la pudeur, imposent leur ordre moral – codes vestimentaires dit code de modestie, comportements – par la violence dans les quartiers ultra-orthodoxes de Jérusalem et prétendent lutter contre les mœurs dissolues et les influences extérieures. Il est difficile d’établir avec précision qui sont leurs membres et comment ils fonctionnent, même s’ils se sont donné le nom de sicaire en référence à un groupe de Juifs zélotes du Ier siècle. Mais il faut noter que la majorité des ultra-orthodoxes désapprouve ces débordements, jugeant cette instrumentalisation de la religion injustifiable et contraire au judaïsme. Si ces milices sont illégales, la police israélienne rencontre toutefois de grandes difficultés à enquêter dans ce milieu fermé, où règne l’omerta.
J’ignorais aussi que le terme Sotah désignait un traité entier du Talmud, consacré aux femmes soupçonnées d’adultère. Une Sotah pouvait voir ce soupçon levé grâce à un rituel spécifique, le rituel de l’eau amère. Des Mishnayot sont consacrées pour l’essentiel à une définition exacte des règles de procédure dans le cas d’une femme réellement ou prétendument infidèle : par exemple, la femme devait avoir les cheveux desserrés pendant le rituel de l’eau amère, cela étant considéré comme un symbole de la prétendue honte de la femme, et la Mishna disait encore que les vêtements de la femme devaient laisser voir sa poitrine nue. Beaucoup ont considéré cette épreuve comme une méthode de pression sur la femme et la pratique a été abolie dans le courant du premier siècle sous la direction de Yohanan Ben Zakai, au motif que les hommes de sa génération n’étaient pas au – dessus du soupçon d’impureté.
Naomi Ragen, militante active de l’égalité des sexes et des droits de l’homme, mène un combat contre la séparation des hommes et des femmes que les plus intransigeants veulent instaurer dans les autobus des quartiers ultra-orthodoxes, combat qui a été relayé dans la presse internationale et lui a valu le surnom de Rosa Park israélienne.
Sotah reste hélas toujours d’actualité: notre rédactrice en chef Sylvie Bensaïd vient de me rapporter le suicide, cette semaine, d’une femme orthodoxe qui, pour avoir décidé de sortir de cet « enfermement », a vu ses enfants la répudier. Son enterrement, hier 28 juin, fut a la fois laïc et religieux.
Sotah, la femme adultère, c’est un peu Orgueil et préjugés à Jérusalem, dans la mesure où chez Jane Austen aussi, à travers le portrait sensible et attachant de jeunes filles en fleur de la rigide société anglaise au tournant des XVIIIè et XIXè siècle, se posait la douloureuse problématique d’être une femme dans une société régie par les dogmes et les traditions.
Sarah Cattan
Sotah, Naomi Ragen, Yodéa éditions.
[1] Les Hassidim, chez les Loubavitch, sont appelés allumeur de réverbères, ils doivent éclairer le chemin pour d’autres. Ils sont un des sous-groupes des Harédim, ultra-orthodoxes dispensés du service militaire. Source Akadem.org