Le dialogue est un art qui se cultive.
Il donne envie d’aller au théâtre,
au concert, et de partir en voyage.

Sans vouloir tomber dans l’angélisme béat, il faut bien reconnaître que souvent, l’envie de sortir des sentiers battus nous emporte plus vite et plus loin que les petits pas de la politique.
Il parait qu’au théâtre, il y a toujours une morale qui renvoie chacun à sa propre vérité, que la musique adoucit les mœurs et que les voyages sont une rencontre pleine de surprises entre des peuples condamnés à vivre ensemble. Qui dit mieux ?
Hanokh Levin,
émissaire du dialogue israélo-arabe.
Pour le dramaturge israélien, Hanokh Levin, disparu à 56 ans en 1999, écrire pour le théâtre est une façon d’exorciser les conflits et de désamorcer les rancœurs entre bons vieux ennemis. L’humour grinçant est son ‘’arme’’ favorite.
Hanokh Levin est né en 1943 dans une famille d’origine polonaise installée en Palestine mandataire dès 1935.
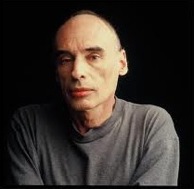
Etudiant en philosophie et en littérature hébraïque à l’université de Tel Aviv, il connait ses premiers succès dès la fin des années 1960. Mais il faut attendre les années 2000 pour découvrir en France, après sa mort, l’œuvre variée de cet écrivain prolifique traduit avec bonheur par Laurence Sendrowicz.
Hanokh Levin a donc grandi en même temps que l’Etat d’Israël s’est construit et que le conflit au Proche-Orient s’est installé dans la société israélienne. « Ce qui m’a profondément marqué dans mon œuvre comme dans ma chair » avouait-il.
Particulièrement révolté par l’antisémitisme mais tout aussi opposé à l’occupation durable des territoires conquis, et déboussolé par l’exacerbation des violences comme par la division des populations locales, il se fait le critique virulent des choix politiques de son pays dont il regrette la réalité bancale et le jusqu’au-boutisme.
Il écrit principalement pour le théâtre des satires au vitriol comme « Toi, moi et la prochaine guerre », peu de temps après la guerre des Six jours. Ses prises de position parfois ouvertement injurieuses et son audacieuse liberté de ton, notamment à l’égard de l’armée ou de la religion, provoquent régulièrement indignations et appels à la censure, jusqu’à être débattus à la Knesset.
Le théâtre de Hanokh Levin fait œuvre indispensable d’introspection critique. Distanciée de la réalité, mais jamais trop loin d’elle, chaque pièce engage à observer ses propres faiblesses, sans méchanceté mais sans concession.
A chaque fois se déroule une même logique narrative d’un grotesque implacable. L’histoire nait d’abord d’un détail insignifiant pour s’achever par une véritable catastrophe. Répliques corrosives et noirceur risible fleurtent en permanence avec un burlesque enfantin mais cruel où est soulignée l’incompréhension réciproque des personnages emportés par une mécanique infernale. Le rire exutoire, poussé à l’extrême, défoule et apaise.
Dans Popper, écrit en 1976, l’humour décalé côtoie le cynisme ravageur. Par un savant cocktail de révolte et d’absurde, cette petite pièce corrosive devient une critique de la haine gratuite.

Parce qu’il est toujours là où il ne faut pas, le gentil mais naïf Popper est rejeté par un couple d’amis qui souhaite sa mort. Malgré ses efforts pour échapper à son destin et être heureux, Popper tombe malade sans raison et agonise longuement, ou plutôt se laisse mourir pour convenir au rôle tragique qu’on lui fait porter. Son monologue de fin, directement adressé au public qu’il prend à témoin, souligne avec sarcasme la morale de son histoire :
« Vous souffrez de constipation ? Offrez-vous Popper. L’ennui vous gagne ? Tirez sur Popper. Vous ressentez un manque que vous n’arrivez pas à combler ? Vous le comblerez en mettant Popper dans le trou ».
Autrement dit : « vous voulez passez vos nerfs, venez taper sur un juif au théâtre, ça vous évitera de le faire ailleurs ! » Mais chez Levin, l’ambiguïté du propos révèle toujours un sens caché qui en dit long : laisser aux autres le soin de vous haïr est une façon d’accepter la souffrance. Et de leur donner raison !
Le Talmud pense comme Levin.
Si le théâtre est jugé « idolâtre, magicien et moqueur » (Sonia-Sarah Lipsyk, centre Aleph, Montréal), il a néanmoins une irremplaçable fonction cathartique qui libère les pulsions, exorcise et désamorce les querelles. Mieux vaut mimer la guerre que de la faire, comme il est préférable de montrer la violence et la mort (pour de faux) plutôt que les voir (pour de vrai).
Déjà dans l’Antiquité, le théâtre aidait les Juifs à lutter contre l’intolérance à leur égard.
Le drame en cinq actes d’Ezéchiel d’Alexandrie, l’Exagoge (IIème siècle avant JC), dont on a conservé à ce jour quelques fragments, évoque l’exode hors d’Egypte et les hauts faits de Moïse. Les Grecs d’alors, prétentieux et ignorants, pensaient que « les Hébreux n’ont pas d’histoire digne de ce nom ». Dans une sorte de stratégie identitaire, Ezéchiel fait un récit glorieux qui apporte un démenti splendide. Comparant l’épopée collective de la Bible aux exploits héroïques des tragédies grecques, il désactive les tensions, conduit à un dialogue culturel, et lutte avec tact contre les attaques antijuives.
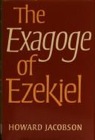
Longtemps résident au Cameri Theater de Tel Aviv puis dramaturge attitré de l’Habima, théâtre national d’Israël, Levin a été un véritable émissaire du dialogue israélo-arabe. Il a reçu de nombreux prix en Israël et à l’étranger. Il est aujourd’hui régulièrement joué dans de nombreux festivals, comme celui du ‘’Printemps des comédiens’’ qui a lieu chaque année à Montpellier (3 au 29 juin 2014).
celui du ‘’Printemps des comédiens’’ qui a lieu chaque année à Montpellier (3 au 29 juin 2014).
Un orchestre pour la paix
Dans son livre paru chez Fayard en février 2014 « La musique est un tout », le chef d’orchestre Daniel Barenboïm explique que les Palestiniens et les Israéliens ont des destins inextricablement liés et qu’ « en s’écoutant, ils peuvent créer ensemble quelque chose de beau ».
Le West-Eastern Divan Orchestra est une formation composée d’environ 80 jeunes musiciens israéliens et arabes. Depuis quinze ans, elle promeut chaque été la paix au Proche-Orient à travers la musique classique.
En 1999, Daniel Barenboïm en était à l’origine avec son ami Edward Saïd (décédé en 2003).
Edward saïd se voulait le digne représentant d’un « humanisme laïque ». Il se disait lui-même « chrétien libano-américain », et affirmait dans le journal Haaretz « je suis un intellectuel juif et palestinien ». Il était surtout profondément opposé à toute forme de manichéisme qui nous fait tomber dans le piège sartrien de ‘’l’enfer, c’est les autres’’ (Karim Emile Bitar, ENA, décembre 2003). « Dans le langage universel de la musique, disait-il, on arrive à se connaître, à s’apprécier, à surmonter les préjugés, (…) à s’expliquer mutuellement nos angoisses respectives ».

L’été dernier, le Divan Orchestra donnait un concert en Provence, au festival de La Roque-d’Anthéron (Tribune Juive, 13 août 2013).
Pour Daniel Barenboïm, grand chef d’orchestre israélo-argentin qui dirige cette formation, jouer les plus grands noms de la musique classique comme Wagner, Berlioz, Verdi ou Beethoven, n’est pas contradictoire avec la politique. Il y a plusieurs façons de dire non à la guerre.
Le plaisir communicatif qui s’empare d’un public dans une salle de spectacle, dit-il encore, provient de cette émotion innée qui rassemble des individus très différents. Chacun a sa propre manière d’entendre la musique.
La recherche (vaine) d’un consensus est vouée, selon lui, à un échec désastreux qui ne mène qu’à une forme de défaitisme, lequel sentiment entretient l’exaspération et le rejet. On peut se comprendre sans forcément être d’accord, le contradicteur oblige simplement à expliquer sans chercher à convaincre, à argumenter sans prétendre persuader. « Nous avons le même pourcentage d’admirateurs et de détracteurs dans les deux camps. Cela montre qu’il y a quelque chose que l’on fait bien ».

Chacun peut se révéler à la fois ouvert aux autres sans jamais rien céder de sa propre identité. Il appartient aux deux peuples de faire des efforts : « Aux Palestiniens d’admettre que la violence n’est pas une solution (…) Aux Israéliens de mettre fin à l’occupation et démanteler les colonies. Si personne n’a moralement le droit de dénier à un autre peuple le droit de revenir dans sa patrie [il faut] cesser de croire à « la légende nationaliste israélienne » qui prétend que la Palestine était « une terre vide » » (entretien avec Olivier Bellamy, Huffington Post, 9 avril 2014).
Renvoyer chacun dos à dos est parfois la meilleure façon de se retrouver … en tête à tête.
Parce que « les positions militantes sont coupables de l’enlisement », Barenboïm invite les jeunes à abandonner « les dogmes du passé » pour regarder mieux vers l’avenir.
‘’Trip joint project’’
Avec le groupe éducatif Tiyul-Rihla, les voyages ‘’des deux côtés du mur’’ conduisent étudiants juifs et arabes à se découvrir conjointement pour avoir plus de chances de dissiper les malentendus.
Tiyul-Rihla organise des voyages éducatifs dans des musées et des sites historiques israéliens et palestiniens. Le but est de mieux faire connaître la culture de chacun et de créer le dialogue par une découverte réciproque. Les voyages, de deux ou trois jours, sont préparés par des guides professionnels bilingues qui alternent les excursions en Israël et dans les territoires palestiniens. Ce qui favorise un rapprochement qui n’est certes pas magique, mais suscite une progressive envie d’en savoir plus. La méconnaissance de l’autre étant souvent la première raison de la violence.
« Ça change des pierres ou des bombes » dit l’un, « des soldats ou des colons » réplique l’autre.
Ce type de ‘’trip joint project’’ (programme de voyage mixte) est né en 2010 d’une rencontre inattendue. Un jeune juif s’aperçoit qu’un étudiant palestinien n’a jamais vu la mer. De cette rencontre faite d’abord d’appréhension et de suspicion s’est développé Tiyul-Rihla (‘’Voyage’’ en hébreu et en arabe) dont le concept diffère sensiblement des autres projets du même type. Ici, pas question de discuter politique et de débattre avec des mots qui se ressemblent mais, selon les points de vue, veulent dire souvent des choses différentes. Parler sans fin est un écueil à éviter : au lieu de se dissiper, les incompréhensions se renforcent, les efforts et la bonne volonté paraissent inutiles.
Prendre conscience de l’héritage de chacun est une forme de rencontre bien plus efficace
« S’intéresser à la culture et à l’histoire, c’est faire reculer l’ignorance mais surtout l’aliénation qui en découle. Pour faire un pas en avant, il est préférable de faire un pas dans le passé » (The Jerusalem Post, 20 septembre 2012).

Au cours d’un voyage à Acre, Haïfa et Jérusalem, les jeunes de Tiyul-Rihla ont visité le nouveau musée de Yad Vashem, ouvert en 2005. L’objectif était de mettre fin aux fréquentes idées reçues sur l’Holocauste. Le seul guide parlant arabe interrogé à ce sujet précisait qu’il faut particulièrement souligner l’aspect exceptionnel et unique du génocide des Juifs d’Europe dont les raisons étaient purement idéologiques. « Les Juifs n’étaient pas les ennemis du peuple allemand, ils ne représentaient aucune menace pour Hitler » (Haaretz, 19 septembre 2012).

Des initiatives du même genre se multiplient, souvent sous la direction des présidents d’université. Un groupe de 30 étudiants palestiniens de l’université d’Al-Qods a visité pour la première fois Auschwitz il y a quelques semaines, dans le cadre d’un voyage en concertation avec les universités Friedrich Schiller d’Iéna en Allemagne, et Ben Gourion du Néguev (Beer-Sheva).
L’ambitieux programme intitulé « de réconciliation et de résolution du conflit » s’est donné pour but « d’éveiller la conscience historique » (Haaretz, 28 mars 2014).
Une semaine auparavant, le groupe d’étudiants israéliens avait pour sa part visité le camp de réfugiés de Dheisheh, au sud de Bethléem. Ce camp est l’un des premiers de Cisjordanie. Il a accueilli les familles palestiniennes venant de Jérusalem-Ouest et de Hébron dès 1949 (1ère guerre israélo-arabe).
A l’issue de ces expériences culturelles mais aussi émotionnelles, des psychologues ont cherché à évaluer, à travers les réactions des deux parties, l’impact positif de ces rencontres. S’il ne s’agit que d’un début, les avancées semblent tout à fait encourageantes.
Elles devraient se multiplier dans l’avenir. A Ramallah, une première auberge de jeunesse a ouvert ses portes l’année dernière. Elle ne désemplit pas.
Qu’on se le dise : il n’y a jamais de causes désespérées.
Utopique ? Eh bien justement ! Le dialogue est un art … qui se rêve.
Jean-Paul Fhima



Poster un Commentaire